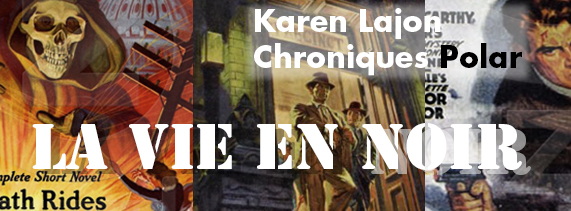Cumulus, nimbus, strates, tout le monde connaît ces mots, même les enfants de primaire. Mais en 1802, on ne plaisante pas avec la langue de Shakespeare. Alors, quand un Quaker un peu fou se met en tête d’étudier les nuages puis de leur donner des noms latins, il n’en faut pas plus pour que les services de renseignements du pays se mettent en chasse. Gare à celui Who does not speak English ! Ne serait-il pas un espion à la solde de ces maudits Français !
Où va se nicher le nationalisme dans ces années-là, quand l’Angleterre redoute Napoléon et la reprise des combats. Un homme se tient très loin de toutes ces considérations politico- guerrières, Luke Howard, jeune apothicaire quaker passionné de météorologie depuis son enfance. Une double offense. Celle faîte à son père, très stricte dans son obédience à ce mouvement religieux né en Angleterre au XVIIe siècle, et celle adressée à l’influente Askesian Society lorsqu’il présente devant ses vénérables membres une théorie inédite de classification des nuages. Mais non content de leur parler du ciel et de ses éléments, il ose en outre choisir le latin, langue universelle selon lui, afin de décrire petites choses virevoltantes qui apparaissent et disparaissent au gré de vents capricieux. Ce génie méconnu déclenche une tempête.
Deux hommes s’affrontent en coulisse. Deux patrons de presse. Alexander Tilloch du Philosophical Magazine et Markham du Gentleman’s Magazine. L’un va porter aux nues la découverte de Howard, l’autre n’aura de cesse de la discréditer. L’histoire est vraie. Merveilleuse trouvaille de Frédéric Chignac reporter et scénariste qui signe son premier roman. On découvre ainsi le monde fermé des Quakers, ces femmes et ces hommes vêtus de noir qui tutoient tout le monde sans aucun sens de la hiérarchie, et qui se réunissent une fois par semaine de façon très démocratique, assis en cercle, dans le cadre de ce qu’ils appellent La Réunion des Amis. Les questions sont autorisées après la prière puis l’assemblée passe au vote. Ce jour-là, George Gatlin, un menuisier âgé demande haut et fort : « Je voudrais parler des nuages. Leur observation scientifique est-elle compatible avec notre conception divine du ciel ? » Ce jour-là, il y aura un vote mais pas d’unanimité. Et le groupe entier dira: « Alors remettons la décision à un autre jour. Qu’il en soit ainsi« . L’ombre du père de Luke plane au-dessus de lui et il l’entend comme s’il était près de lui. « Je t’avais pourtant bien prévenu« .
Affrontement parent-enfant, affrontement religieux, politique et scientifique. Le personnage de Luke Howard illustre cette terrible équation. Tout chez lui est atypique. Il est marié à Mariabella qui l’aide à la boutique. Mieux ou pire, elle pratique aussi une forme de médecine. Elle est le moteur du couple, celle qui ne dira jamais non à son époux, bien au contraire, quitte à rompre avec une communauté étriquée et bornée. Un couple d’une modernité impensable pour l’époque.
Luke est un pur chercheur. La tête dans les nuages. Au sens propre. Il fait la connaissance d’un Français, Paul Gascogne, un entrepreneur, industriel de génie dans son genre. Il construit des montgolfières. Convergence des talents. Le Français est le seul à pouvoir aider Luke Howard dans sa quête de connaissances. Il lui reste à étudier la grêle. Mais pour cela, il doit s’élever haut dans un ciel où nul homme ne peut survivre longtemps parce que privé d’oxygène à une certaine altitude. Gascogne pieds et poings liés avec les espions de la Couronne n’aura d’autre choix que d’accéder à la demande de ce génie insolite.
Une découverte scientifique se fait toujours dans la douleur. Qui aurait imaginer que ces termes latins allaient entraîner un cataclysme sémantique et nationaliste ? Que ce pauvre Howard, âprement désireux de tout savoir des nuages dans le ciel, et rien d’autre, serait le jouet de sombres manipulateurs avec des dessins autres que l’avancée scientifique. On sourit évidemment à la lecture de ce combat, le jugeant un tantinet absurde. Mais des années plus tard, d’autres remettront en question des certitudes que l’on croyait acquises. Le Londres de l’époque est un champ de bataille culturel, une ville industrielle en plein essor, l’argent, les idées circulent, les poètes comme Goethe y résident, avides de s’imprégner de cette atmosphère bouillonnante. Une cité où tout semble possible mais où les intérêts d’un pouvoir en place sont coûte que coûte préservés de façon sauvage. Le roman de Frédéric Chignac nous fait prendre de la hauteur et on tutoie autant les nuages que les étoiles. Magique.
Le dernier nuage de Frédéric Chignac, Éditions Hervé Chopin, 352 pages, 19.50 euros.