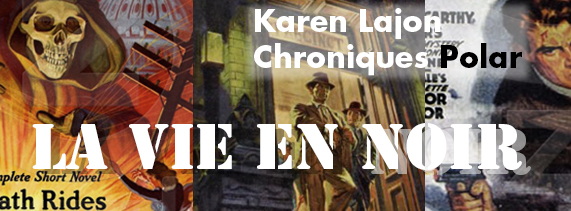Une existence toute entière basée sur le mensonge. Au pluriel. Qui a vraiment été Mook Miran ? Esclave, reine de l’évasion, espionne, meurtrière, terroriste, amante ou mère ? On lui demande de se définir en trois mots. Mission impossible pour cette femme de près de cent ans. Lee Sae-ri a pour mission de rédiger la nécrologie des résidents de la maison de retraite, The Golden Retirement Home. Cette Mook Miran l’intrigue. Elle fait plus jeune que son âge, elle refuse de se définir par trois mots, elle en propose huit. Elle se montre effrontée et acerbe. Faut-il se fâcher ou au contraire écouter cette conteuse fantasque ? Lee Sae-ri opte pour l’écoute. Inconsciente de l’extraordinaire voyage qui l’attend.
Lee Sae-ri est rigide. Elle a un plan avec une ligne directrice. Elle s’accroche à ses trois mots. Mook Miran s’amuse, lui concède avoir trois nationalités : Japonaise de naissance, Nord-Coréenne une bonne partie de sa vie et enfin Sud-Coréenne en cette fin d’existence. Mais la vieille dame s’impatiente, « se détourne tel un pigeon qui s’éloigne en hochant la tête », et lance un regard torve à cette jeune sotte. « Huit, alors, je vais vous donner huit mots… madame l’écrivaine». Nous aussi, nous voilà harponnés. Doit-on croire sur parole cette Mook Miran ? Meurtrière, dit-elle, mais encore ? Pas si vite, la vieille dame entend mener la danse. À son rythme, dans le désordre, insolente jusqu’au bout parce que Mook Miran est sans pitié. Si la jeune femme veut savoir, il va falloir qu’elle écoute très attentivement. Et qu’elle commence, au fond, par ne rien comprendre.
Comme cette histoire de La Cinquième Vie qui se passe à la frontière nord-coréenne, en 1961. Le point de vue est celui d’un jeune garçon. La narratrice est perdue. On passe ensuite au chapitre de La Première Vie. Fondamental. On remonte le temps, on est en 1938, la vielle dame explique : « Je mangeais de la terre quand j’étais jeune… De temps à autre, mon corps avait soif de terre, et je n’avais d’autre choix que d’accéder à sa demande ». Seule sa mère tolère cette curieuse habitude. Après tout, les Français mangent bien des escargots. Mais le père ne l’entend pas de cette oreille. Un exorcisme, voilà ce qu’il lui faut à cet enfant. « Je fus jetée au milieu du jardin, ligotée comme un poulet que l’on plonge dans une soupe bouillante ». Le père est alors désigné par la fillette comme le monstre. Les mots sont des armes, lui dit sa mère. Elle a raison. Celui de SEX va précipiter le drame. Cette fois, la fillette cherche l’odeur. Celle de l’herbe médicinale, sahwa, la fleur du serpent. Celle qui tue. Le monstre ne reviendra pas. Et l’enfant cesse de manger la terre qui a pris la couleur du sang. Celle du pêché.
Chaque chapitre est aussi prétexte à situer les événements dans un contexte historique précis. Le troisième revient en arrière, en 1950, en pleine Guerre de Corée. La fillette a bien grandi, et a décidé de se faire passer pour un garçon. Elle est revenue dans son village natal, elle a vu les Yankees et les soldats du Sud sillonner les rues dans leurs camions militaires, elle a poursuivi sa route. Tout est brûlé, estropié. Elle rencontre un soldat blanc, lui dit qu’elle parle anglais, et qu’elle, il, s’appelle, Yongmal. « Ce n’était pas mon prénom, ni d’ailleurs un nom de garçon ». Le Yankee l’emmène à La Maison. « Un lieu de vie pour douze femmes sans domicile… On leur donne une seconde chance pour qu’elles puissent servir leur vrai pays auprès de soldats de son plus grand allié, les forces américaines, les héros qui sont venus les sauver des mains diaboliques des communistes ». À La Maison, on soigne les filles qui viennent de La Station de réconfort. Le détachement quasi clinique de la vieille dame à raconter cet épisode de sa vie est vertigineux. La Station abrite une usine, non pas de biens matériels mais de soldats imbibés, assoiffés de chair. On injecte des tas de choses dans le corps de ces filles, du mercure, de l’opium mais aussi de la pénicilline afin qu’elles puissent servir jusqu’à l’épuisement fatal. L’endroit appartient à une certaine Yongmal… Il brûlera.
Et puis on repart sur La deuxième Vie, en 1940. Les Japonais appâtent les jeunes filles, bourse universitaire, salaire, travail ou sucreries. En réalité, ils changent les patronymes et exigent qu’elles oublient le Coréen et apprennent le Japonais. La suite est banale en temps de guerre. « La journée, nombreux étaient les soldats qui tiraient de moi du réconfort – environ cinquante par jour en semaine, deux cents le week-end. Lorsque je perdais connaissance, ils me jetaient un seau d’eau glacée pour que je me réveille et que j’accomplisse mon devoir jusqu’à la nuit tombée ». Il y a une certaine Yongmal qui raconte des histoires avec tant de talent… La terre est sombre. «J’attrapais une poignée, et l’avalais ».
Si La Deuxième Vie nous plonge en enfer, La Quatrième Vie nous transporte. Un grain de beauté et des chaussures. L’amour inconditionnel d’un homme envers sa femme. Yongmal est revenue. Disparue depuis deux ans, enlevée par les Japonais, emmenée en Indonésie, la revoilà différente, marquée, encore plus belle, pense, Young-min, l’époux. Ses mains effleurent le corps meurtri de la revenante, il l’avait connue enfant, il la retrouve femme. La ville de Pyongyang est le paradis des travailleurs sur terre. C’est du moins ce qu’affirme Kim II-sung, le père fondateur de la divine nation. « La tromperie, comme l’amour, est un acte qui se joue à deux. Pas de duperie sans dupé ».
Madame Mook aurait donc vécu tous ses drames. Le titre original, 8 Lives of a Century-Old Trickster, nous met sur la piste. Trickster en anglais veut dire filou, escroc… Il faut lire les chapitres comme des nouvelles dans lesquelles la romancière glisse des indices qui donneront le sens final au roman. L’héroïne, librement inspirée de la grande-tante de l’autrice, change de peau, son identité est un patchwork de sentiments, elle subit autant qu’elle force le destin. À travers elle, Mirinae Lee nous parle aussi de mémoire collective, de fusion. Entre mythe et réalité, le roman décrit avec une délicatesse précieuse la capacité d’un individu à survivre et se réinventer avec « une langue recouverte d’une couche de terre, tel du sucre acidulé sur un bonbon ».
Les 8 Vies d’une Mangeuse de Terre, de Mirinae Lee, traduit de l’anglais (Corée du Sud) par Lou Gone, Éditions Phébus, 320 pages, 22,50 euros.