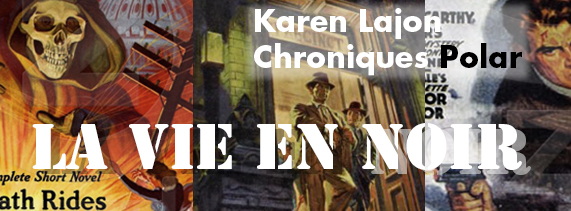Une fillette de 12 ans a disparu. Albert Soleilland, 26 ans, qui l’accompagnait à un spectacle de music-hall au Ba-Ta-Clan, arpente les rues adjacentes comme un fou, encore hébété de l’avoir perdue. Nous sommes en 1907. La mode est aux moustaches en guidon de vélocipède et aux rouflaquettes. Albert, ébéniste, porte l’habit de sa profession : chemise blanche, pantalon de drap brun et veste de velours. Les vendeurs de journaux, l’édition du soir sous le bras, ne crient pas encore à la disparition de l’enfant. Bientôt La Disparue du Boulevard Voltaire fera la Une du Petit Parisien et aura même un impact sur une décision politique et sociétale majeure.
Paris, LE personnage en toile de fond de l’impeccable roman de Pierre-Étienne Musson. On est transporté dans le quartier populaire de ce onzième arrondissement de Paris, à l’époque où les fiacres, les charrettes encombrent encore la chaussée. Marie-Cyrille Erbelding, ou Marissi comme on la surnomme, habite au 76 de la rue Saint-Maur, avec son mari Antoine qui ne quitte plus son lit après un accident. Marissi est d’origine alsacienne et les Alsaciens sont appréciés dans la capitale. Ses parents, fuyant l’annexion prussienne, ont trouvé refuge à Paris venant ainsi grossir une petite communauté alsacienne. Et faire sa scolarité à l’École alsacienne n’est pas encore le summum du chic, comme aujourd’hui. Marissi est l’incarnation de la femme dévouée et de la mère aimante avec ses cinq enfants. La disparition de sa fille Marthe est un choc. Mais pas une minute, elle ne doute d’Albert, leur grand ami.
La loi est incarnée par le commissaire George Hacquart. Il est le dernier d’une lignée de policiers, sa femme n’ayant mis au monde que des filles. Dieu soit loué, pense-t-il, le monde étant fou selon lui, et l’institution policière n’accueillant aucune dame dans ses rangs, ses filles n’auront pas à souffrir de ce triste spectacle. Il est sans fausse pudeur favorable à la peine de mort. Il aimerait bien que ces Messieurs les députés viennent traîner leurs fracs dans ce qu’il considère comme « la lie de la société : le triangle Bastille-La villette-Nation ». Il est le premier à recevoir Albert et Marissi. C’est un homme charitable et qui a du métier. Il rassure la maman et l’ami. Dans un premier temps.
La presse. Avec une star, Le petit Parisien. Six pages, cinq centimes, deux éditions quotidiennes, un million d’exemplaires, «le plus gros tirage des journaux du monde entier », rien que ça. Le tsar du fait-divers : Arsène Ruffian qui en vieux français veut dire « proxénète ». Pour le public, c’est juste un fouille-merde. Le jour où il tombe sur ce qui deviendra un feuilleton national, il s’intéresse mollement à une lingère massacrée à coups de tisonnier par son mari, après une nuit d’ivresse. Mais son sixième sens l’emporte quand son « indic » de la police lui parle de « cette histoire de gamine », ce qui est toujours bon pour les affaires d’Arsène. Il sent qu’il tient une bonne histoire et qu’il va encore une fois battre le concurrent Le Petit Journal. Et damner le pion à une police qui piétine avec ses révélations à venir.
La peine de mort. L’autre grand thème du récit. L’auteur s’est inspiré d’un fait réel. En cette année 1907, l’Assemblée et les Français sont secoués par un grand débat : doit-on ou non abolir la peine capitale ? Que vaut la volonté politique face à l’opinion publique relayée par une presse toute puissante ? Le Petit Parisien ira même jusqu’à lancer un référendum populaire à propos du maintien ou non de la peine de mort qui recevra plus d’un million de réponses, avec une écrasante majorité favorable à cette sanction définitive. Le président Armand Fallières, que le commissaire Hacquart déteste dans le roman, et appuyant des idées abolitionnistes, gracie certains condamnés à mort, ce qui déclenche un tollé populaire. Soleilland condamné à la peine capitale le 24 juillet 1907, voit sa peine commuée en travaux forcés à perpétuité le 13 septembre 1907. Le roman historique de Pierre Étienne Musson retrace cette enquête de la Belle Époque avec beaucoup de réussite. Qui se souvient aujourd’hui de cette histoire et du président Fallières. L’homme avait des convictions. « Il n’en est pas moins un animal politique. Il sait que gouverner, c’est aussi ménager les susceptibilités et savoir attendre son heure ». Elle ne viendra jamais. Mais en 1981, un autre président, François Mitterrand, abolit la peine de mort. Un sondage montre pourtant que plus de la moitié des Français est contre cette décision. Le roman de Pierre-Étienne Musson vaut par la justesse de la reconstitution précise et précieuse de ce Paris populaire qui vécut ce drame comme les montagnes russes : tantôt avec effroi, soulagement ou encore indignation. Mais toujours sous la houlette d’une presse encore lue et entendue. Un autre temps…
La Disparue du Boulevard Voltaire de Pierre-Étienne Musson, Éditions Black Lab, 296 pages, 21,90 euros.