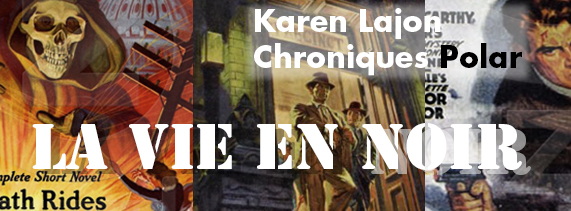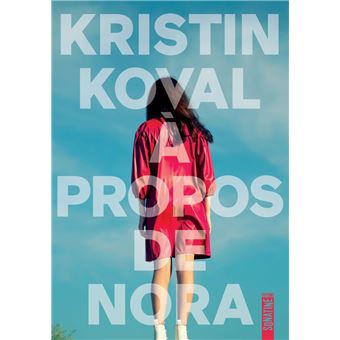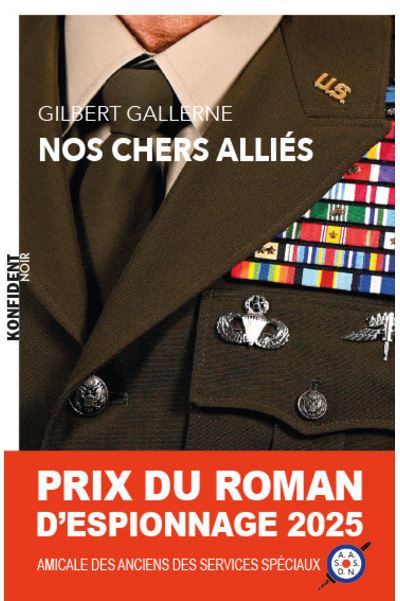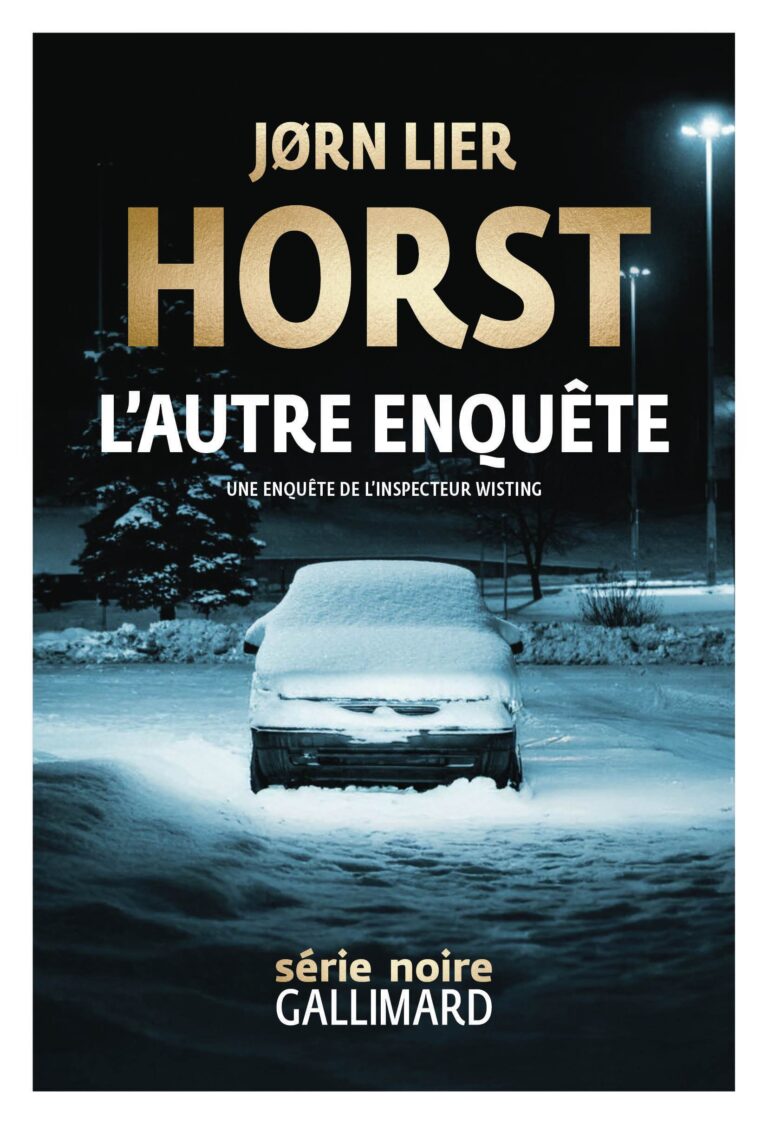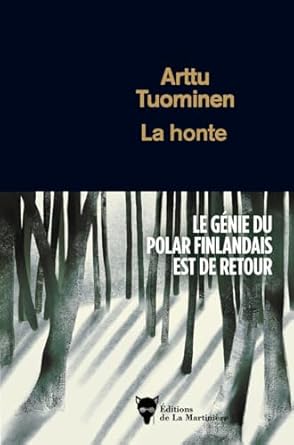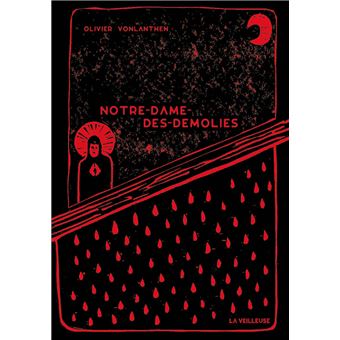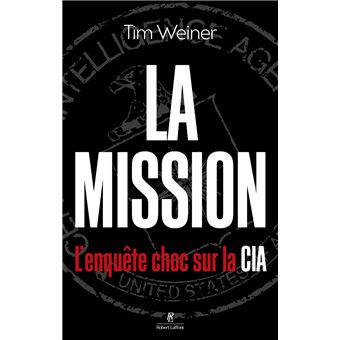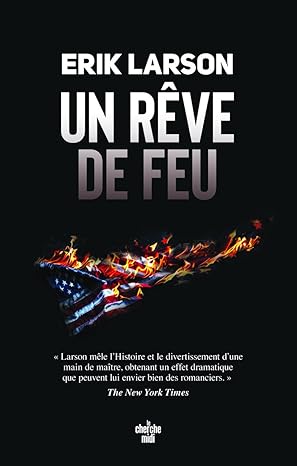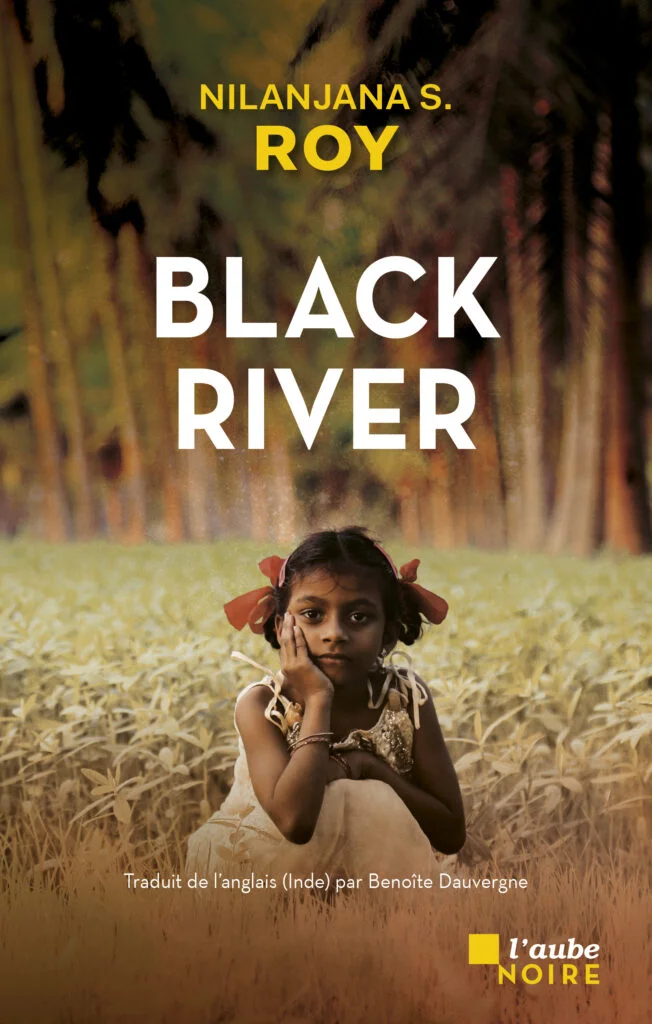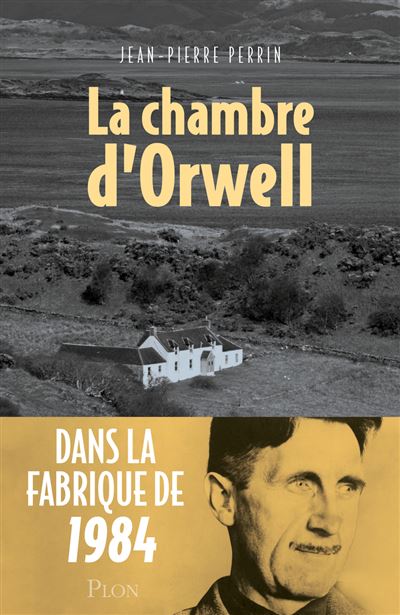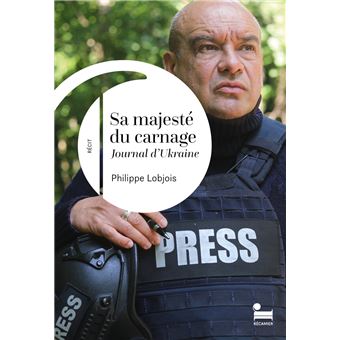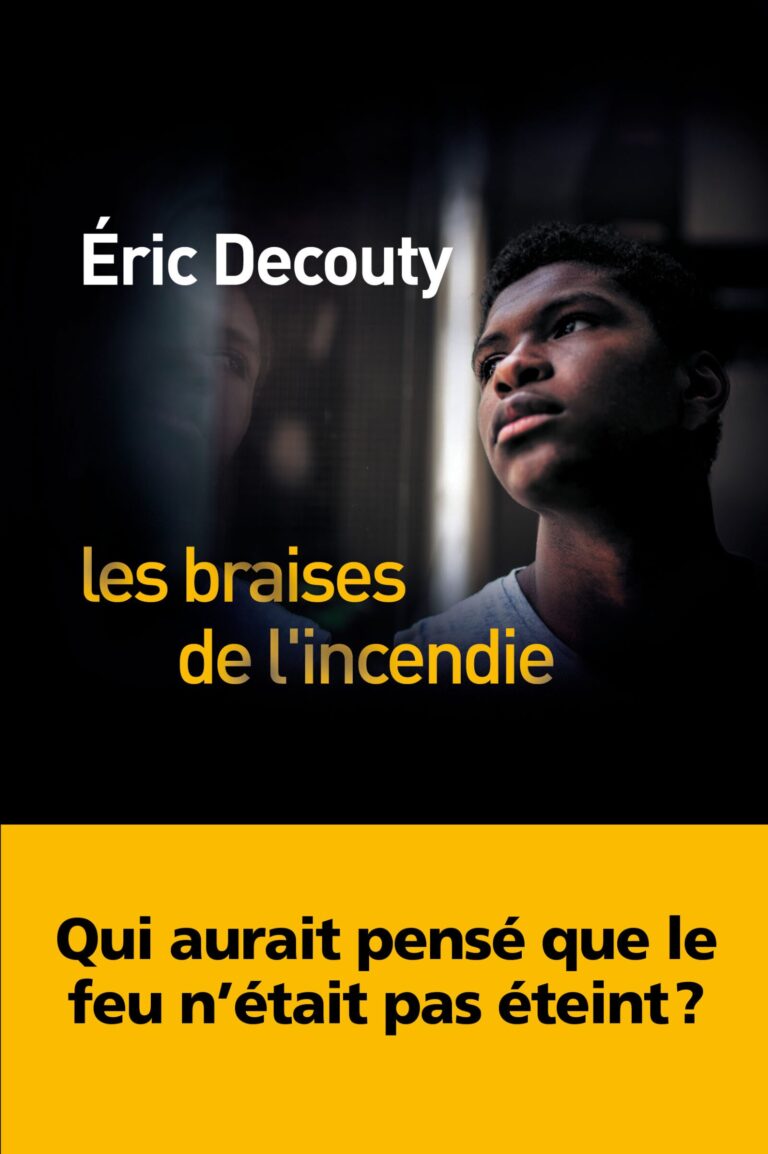Une tragédie à tiroirs. L’une chassant l’autre. La plus grosse, celle qui sert de détonateur au roman : Nora Sheehan, 13 ans, tue son frère Nico atteint de la maladie de Huntington. Énorme. Mais pas assez pour la romancière Kristin Koval, qui au fil des chapitres de cet intense thriller psychologique, s’évertue à secouer le lecteur en multipliant les désastres. Plus rien ne peut être normal après un tel drame, se dit-on. En réalité, rien ne le fut jamais dans cette histoire où la faute et le pardon se heurtent page après page entre personnages coupables et innocents.
Avant le drame, il y en eut un autre. Celui qui appartient au passé. Julian Dumont et Angie DeLuca font du ski. Le Colorado est une terre de glisse. Et lorsqu’on habite Lodgepole, la neige est un terrain de jeu évident. Mais tout à leur bonheur adolescent, ils délaissent Diane, la petite sœur de Angie. Alcool et joint et c’est la mort. Mais la mort comment ? Qui est responsable de ce dramatique accident ? La réponse est enfouie dans le cœur et l’âme de Julian. Des années d’alcoolisme serviront d’exutoire funeste à ce jeune et brillant avocat devenu new-yorkais qui cherchera la rédemption dans les cas les plus désespérés de la justice américaine. Martine Dumont n’hésite pas. Elle envoie son fils Julian loin de Lodgepole. Loin de la pression, du regard accusateur de Livia, la mère d’Angie et de Diane. Elle tient Julian pour responsable de la tragédie.
Si elle savait ! Que sa fille et Julian s’aiment, pire vivent même ensemble. Ils partagent aussi la même culpabilité. Les chapitres s’ organisent en va et vient temporels. On navigue entre présent et passé. On assiste au naufrage programmé de ce couple uni par une faute. La mère de Julian est aussi avocate. Mais lorsqu’elle reçoit l’appel de David, le père de la petite Nora, elle comprend tout de suite qu’elle aura besoin de ce fils avocat qui s’est éloigné au fil des ans. Le droit pénal n’est pas de son ressort, son fils, lui, ne fait que ça. Julian Dumont accepte de l’aider. Cela veut dire revoir Angie qui l’a quittée quelque temps après le 11 septembre 2001.
Comment ont-ils pu imaginer que leur histoire marcherait ? Angie et Julian unis dans le déni. Kristin Koval qui signe son premier roman, ne nous raconte pas un conte de fée. Il y a une gamine de 13 ans qui tue ce frère qu’elle adore, il y a un décès qui appartient au passé, un couple qui a explosé, une femme qui s’est mariée, Julian, a épousé David l’homme qui aime la nature. Un taiseux, un bon catholique, croit savoir l’implacable Livia, un être patient qui attendait Angie. Ils auront deux enfants. Nico désormais décédé et Nora en prison pour avoir fait feu trois fois sur l’aîné.
Le procureur est en période d’élection. L’indulgence ne figure pas dans son carnet de bal. Il veut faire juger cette enfant comme une adulte alors qu’elle souffre de troubles schizophréniques. Le combat entre lui et Julian et sa mère est âpre, tendu. Cela ne passe guère mieux avec Angie qui ne voulait pas de l’aide de son ancien amour. Mais David a insisté, elle s’est soumise. Elle qui a tant de mal à pardonner à sa propre fille. Le roman interroge sur le lien maternel. Pourquoi David fait-il d’emblée les trois heures de route pour aller voir sa fille et pourquoi au début, Angie a tant de mal à s’y plier? David ouvertement si proche de Nora, la seule qui aimait aller à la chasse avec son père. Anatomie d’une descente aux enfers pour un couple dont l’un des protagonistes ne jouait peut-être pas le jeu. Mentir par amour, mentir pour épargner l’autre, Angie s’est persuadée que c’était LA solution. Mentir pour se punir d’une faute jamais soldée.
À propos de Nora décortique le système judiciaire américain et le dénonce. Mais c’est aussi un roman sur l’amour et ses voies sans issues, sur le pardon qui ne vient pas, sur la vengeance qui s’est nourrie du mensonge de l’autre. Un roman sur la vérité. Celle qui nous pousse à faire des choix que l’on s’obstine, tel un cheval qui renâcle devant l’obstacle, à ne pas faire. Convaincu d’épargner l’autre. Nora ne se souvient pas. Nora ne veut pas se souvenir. Parce que se rappeler veut dire ne pas pouvoir réparer. Sa mère a menti, sa fille a choisi d’oublier. Kristin Koval n’épargne personne.
À propos de Nora de Kristin Koval, traduit de l’anglais (États-Unis) par Héloïse Esquié, Éditions Sonatine, 464 pages, 23 euros.