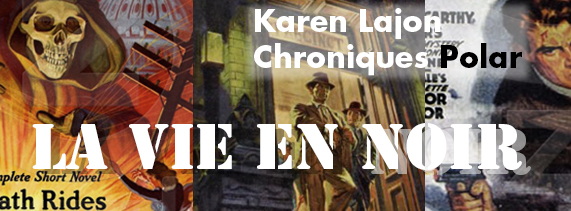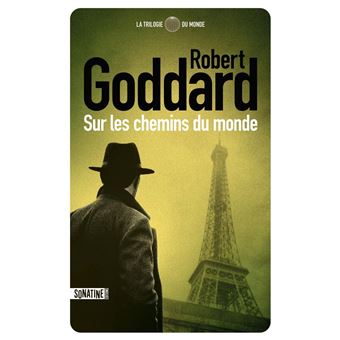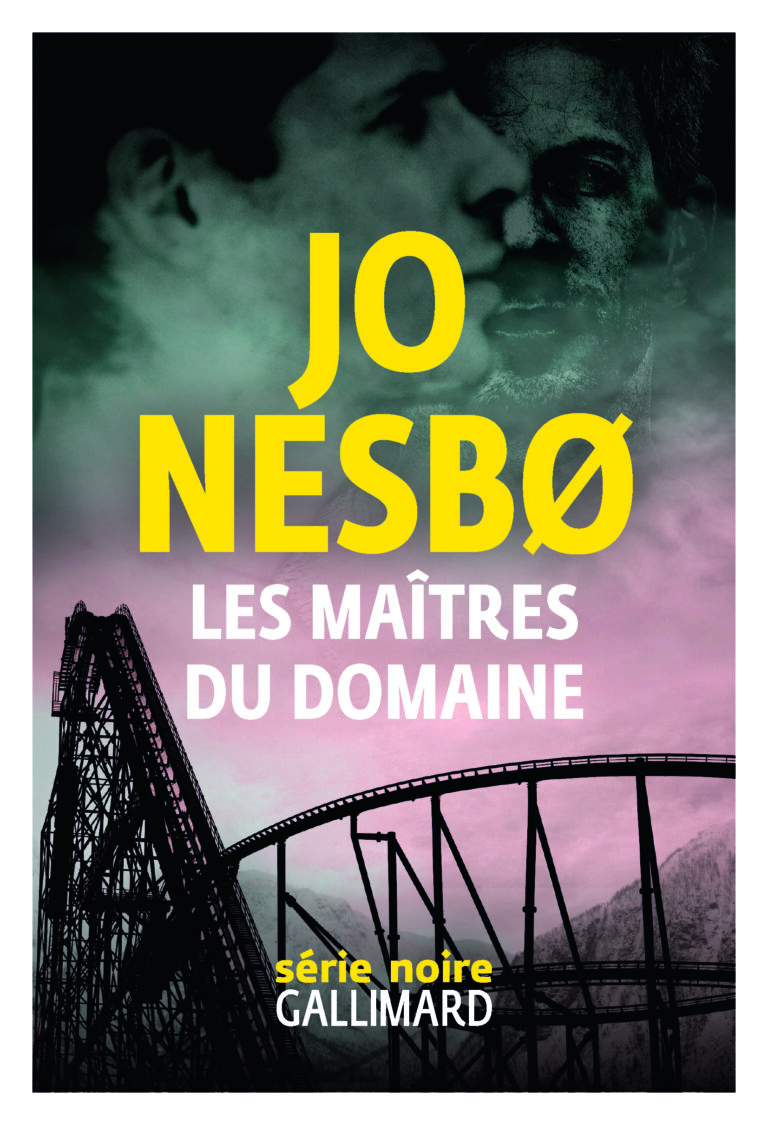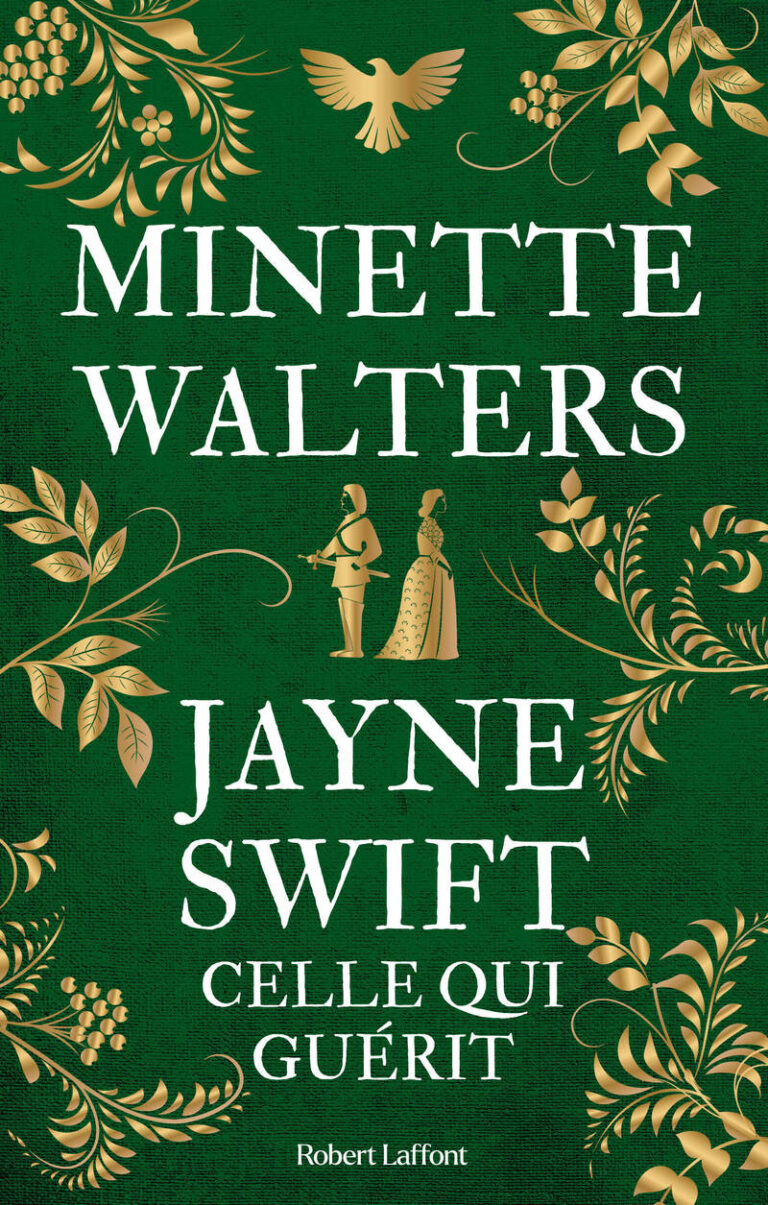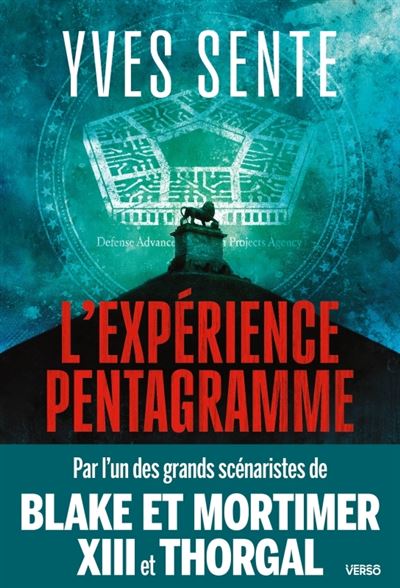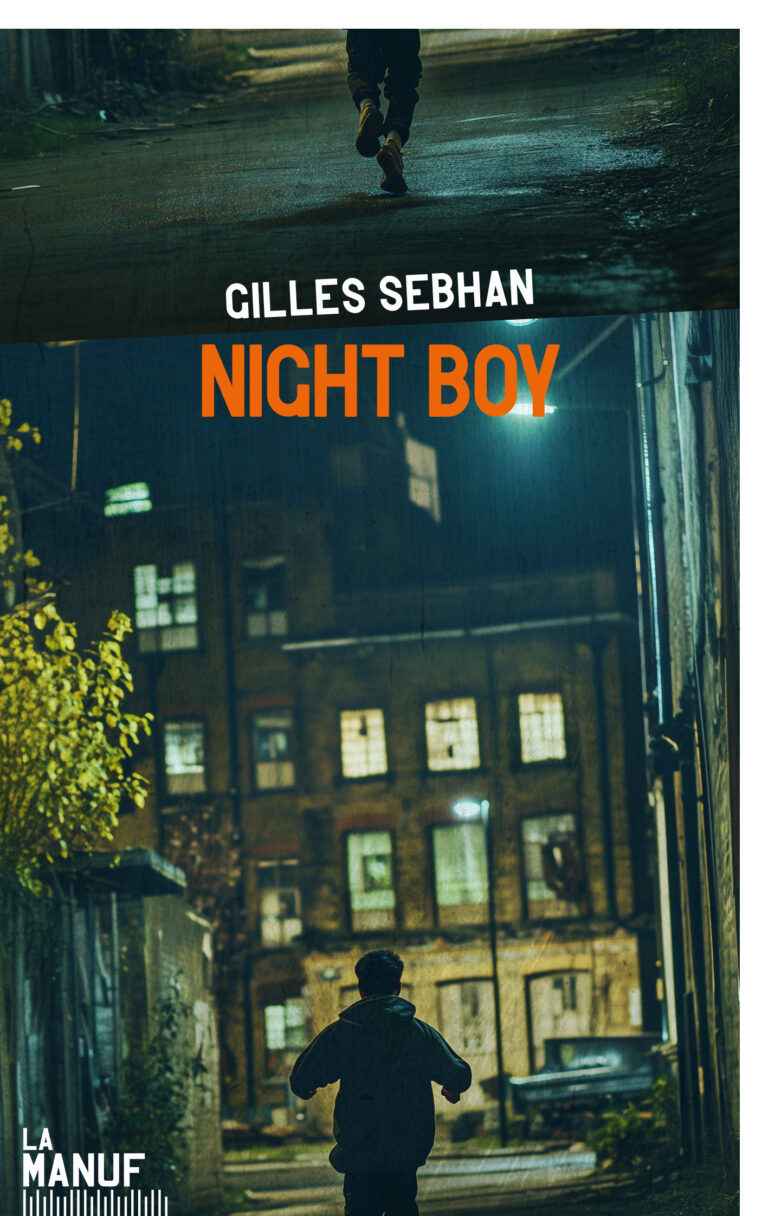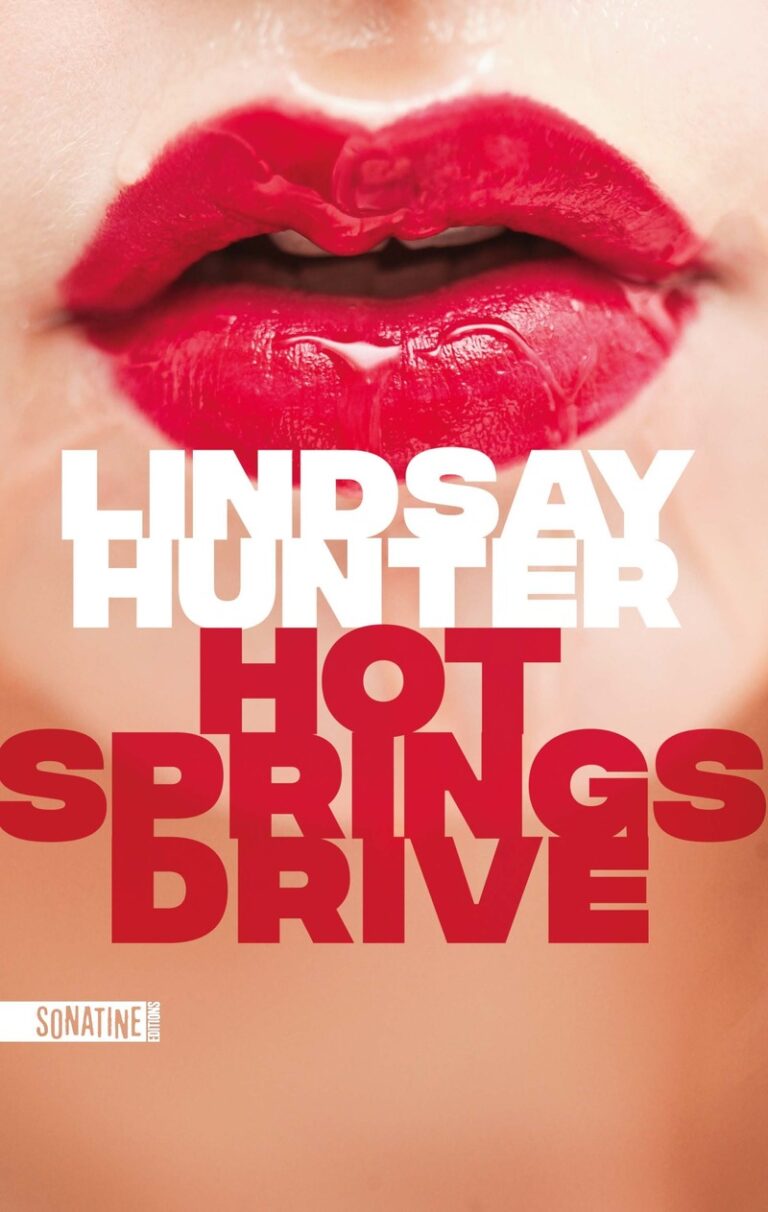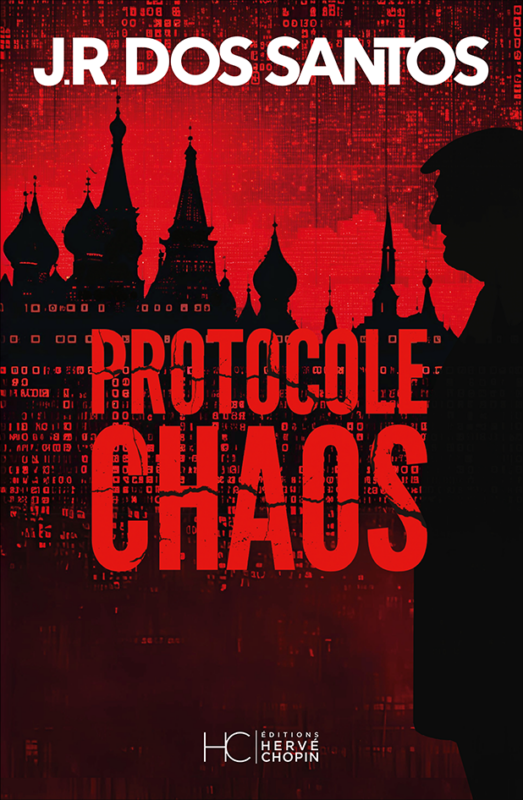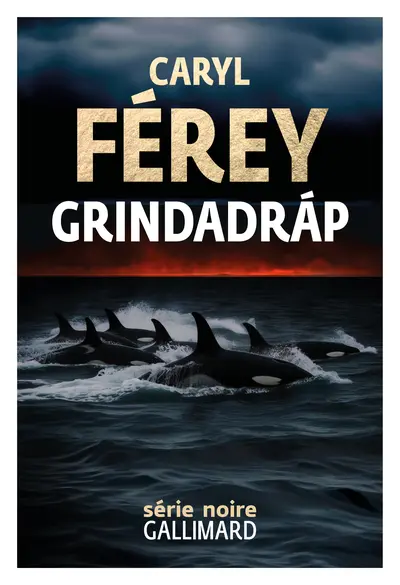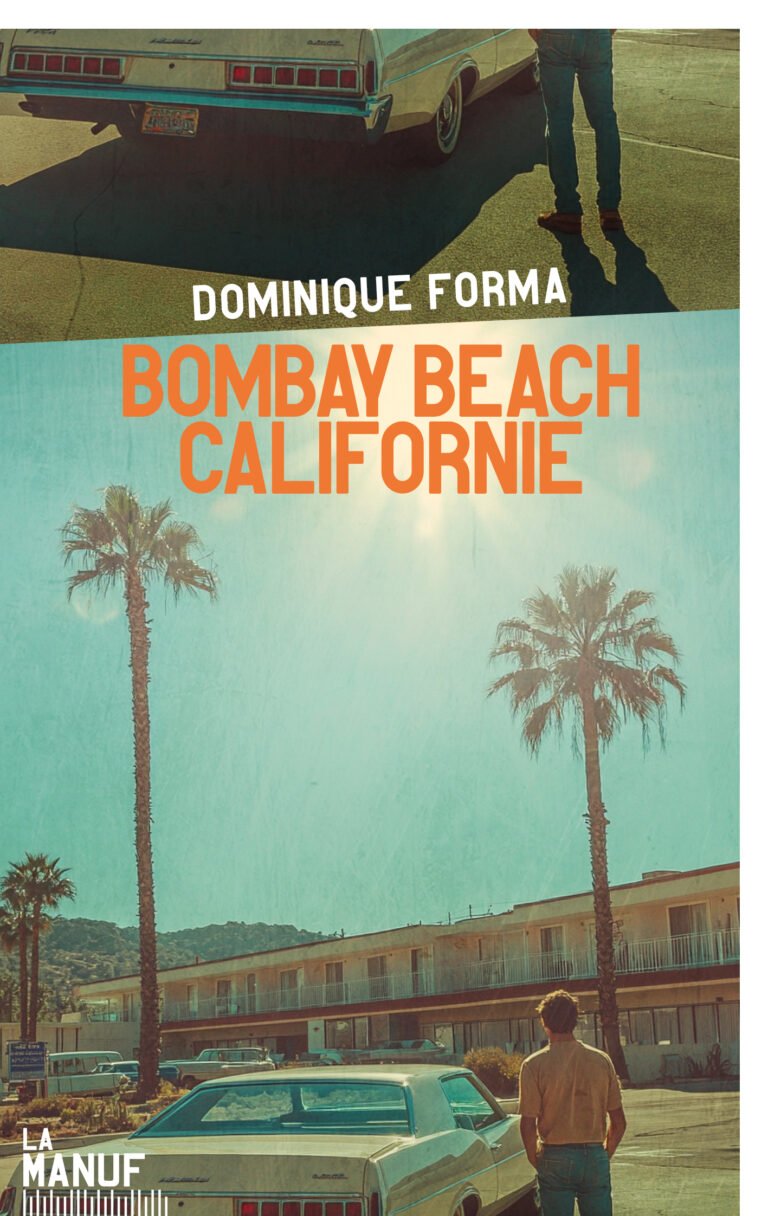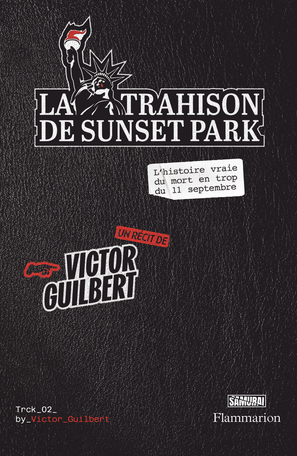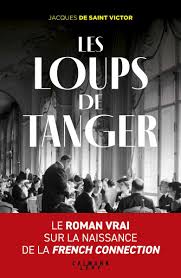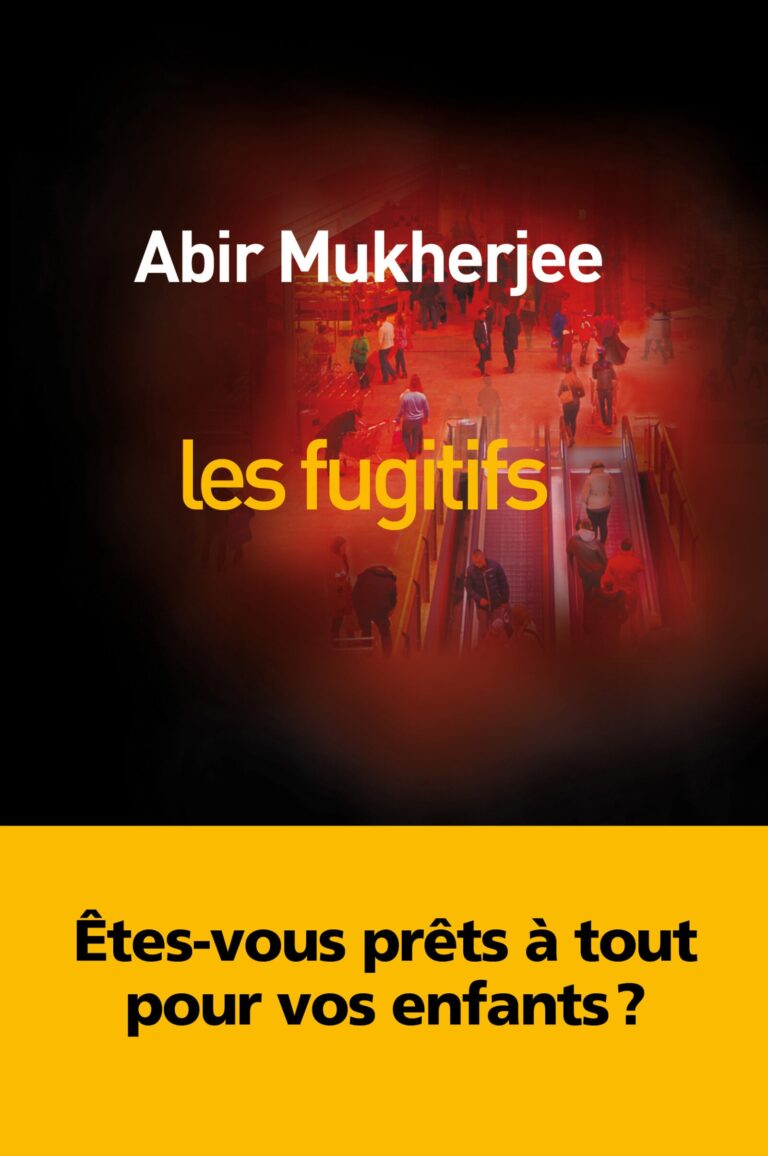Délicieusement suranné. Le dernier roman de Robert Goddard nous transporte dans le temps. Nous sommes en 1919 à Paris où se tient la Conférence de la Paix entre vainqueurs et vaincus de la Première Guerre mondiale. “Sur les chemins du Monde” est le premier volume d’une trilogie historico-polar qui s’annonce passionnante.
L’écrivain a l’air de bien connaître notre pays. Ou tout au moins son histoire. L’Algérie était au cœur de son précédent ouvrage. Cette fois, on est bel et bien sur le sol français et un peu sur la terre ferme de la perfide Albion. Le héros, James Maxted, apprend que son père, Sir Henry Maxted, a été retrouvé mort alors qu’il séjournait dans la capitale française. Il se rend immédiatement sur place avec son frère Ashley. Les deux hommes ont peu en commun. Si James considère la disparition de leur père comme étrange, Ashley ne songe qu’à une chose : en finir au plus vite afin de régler la question de la succession. Inutile de préciser qu’il est persuadé d’être l’exécuteur testamentaire des volontés paternelles. Ce qui lui permettrait de disposer comme bon lui semble des terres familiales et ainsi empêcher James de transformer une partie du domaine en terrain d’aviation. Comme si ces engins avaient le moindre avenir.
Mais la mort de Sir Henry dont le dernier poste d’ambassadeur a été Petrograd, va rebattre les cartes. Pas seulement celles de la famille mais aussi celles d’un Grand Jeu diplomatique que l’ancien pilote anglais James va découvrir à ses risques et périls. Que faisait donc son père à Paris ? Les frères découvrent qu’il avait une maîtresse. Une Française dont il semblait sincèrement épris. Premier choc. Mais surtout qu’il avait l’air de naviguer dans les eaux troubles de l’espionnage. Deuxième choc. Si Ashley ne pense qu’à la réputation de la famille et de leur mère, James veut coûte que coûte découvrir qui a assassiné leur père. Parce que c’est de cela qu’il s’agit, d’un meurtre. Il en est persuadé.
À l’heure où le personnage de Sherlock Holmes entre à la Pléiade et où les romans d’espionnage du grand maître du genre, Graham Greene, ressortent avec de nouvelles traductions signées Claro, on ne peut que savourer la performance littéraire de Robert Goddard. Dans une veine à l’identique, et dans les coulisses de la grande Histoire, le romancier britannique a créé un personnage d’époque qui aborde la vie et la mort non sans une panache propre aux gentlemen de l’aristocratie anglaise. Il y a du David Stirling chez James Maxted. Une forme de pseudo nonchalance sophistiquée qui cache un véritable courage de héros.
Nous voilà entraînés dans une capitale où tous les James Bond de la terre se sont donnés rendez-vous. Les méchants et les gentils. Traduisez ceux qui travaillent du bon côté et les autres. Le roman « Sur les chemins du monde », coïncide avec une période charnière dans l’histoire des services secrets britanniques encore jeunes mais déjà actifs dans les coulisses de la diplomatie britannique. Lord Harding of Penshurst, sous-secrétaire d’État permanent aux Affaires étrangères de Sa Majesté a supervisé la création de cette nouvelle entité en 1909 qui s’occupe de l’espionnage extérieur. Le fondateur du MI 6 s’appelle Mansfield Cumming. C’est le fameux C. Il plane dans tout le roman. Max réalise que derrière son ambassadeur de père se cachait bel et bien un espion et qu’il était l’un des rares à savoir à quoi ressemble le redoutable Fritz Lemmer, homme de l’ombre numéro 1 du Kaiser. « Il est notoirement insaisissable, et se méfie des appareils photos. Il y a vraiment très peu de gens qui savent à quoi il ressemble. Il se trouve que Henry était l’un d’entre eux ». Est-ce lui qui l’aurait tué ? Qui va retrouver l’autre en premier, et Max se rend-il compte que sa vie va changer de trajectoire.
Robert Goddard a planté le décor de son héros naissant. Le rythme est volontairement lent, un peu à l’image de l’époque. On est encore loin de la frénésie d’un Jason Bourne. Entre géopolitique et espionnage, entre les secousses d’un drame familial dans l’aristocratie britannique et les convulsions du monde au lendemain de la Première Guerre mondiale, le roman comme souvent avec son auteur, est une magistrale leçon d’histoire déguisée. Avis aux amateurs.
« Sur les chemins du monde « de Robert Goddard, traduit de l’anglais par Claude et Jean Demanuelli, Éditions Sonatines, 528 pages, 24.90 euros.