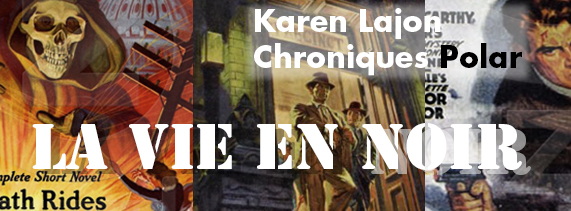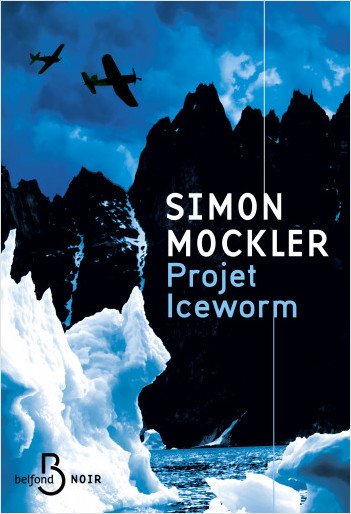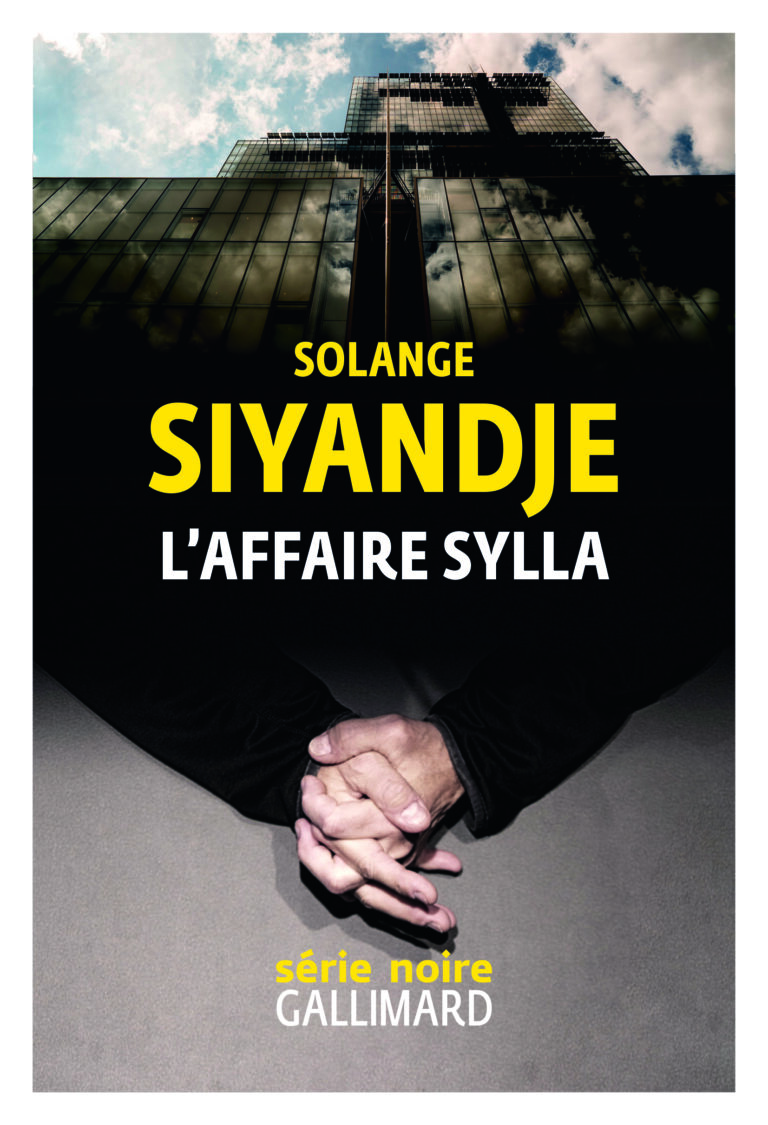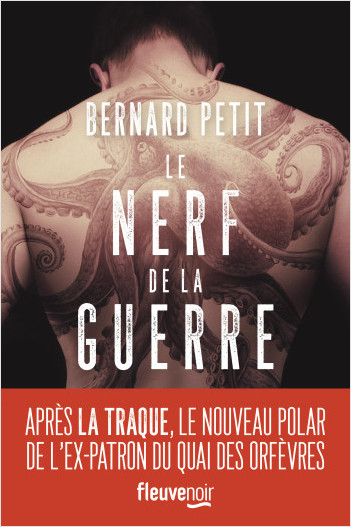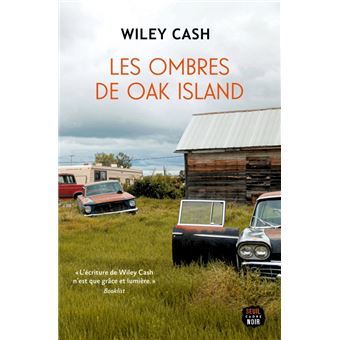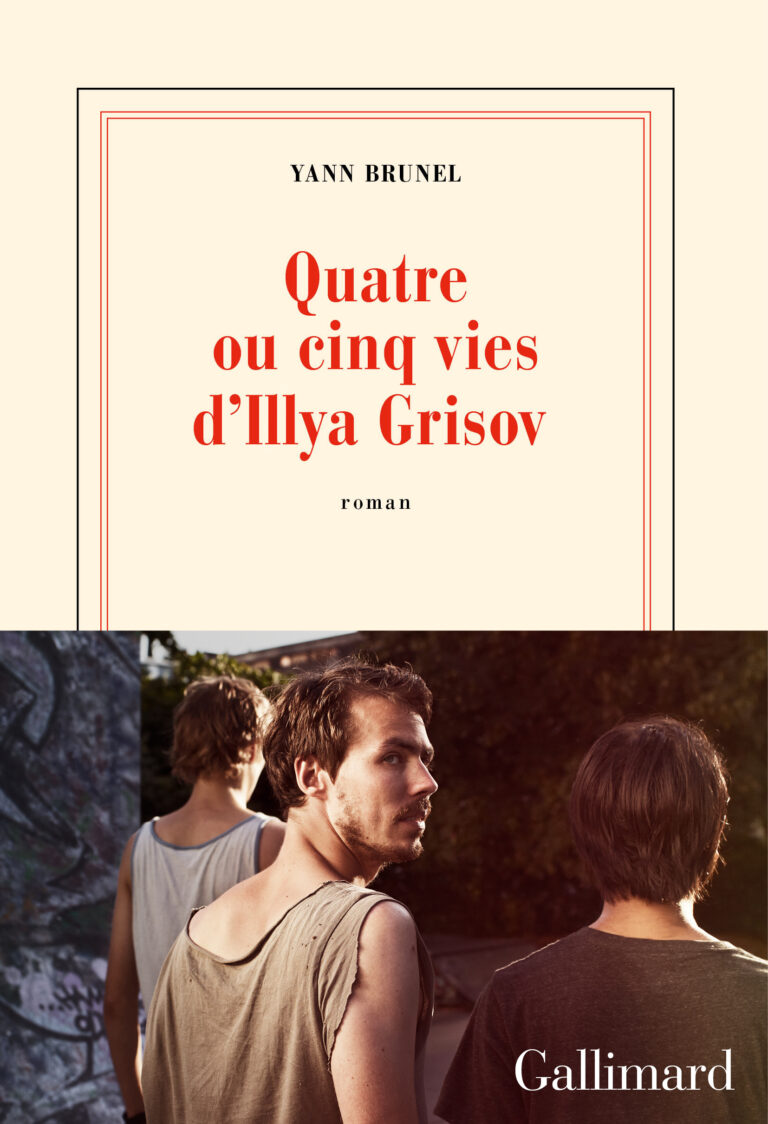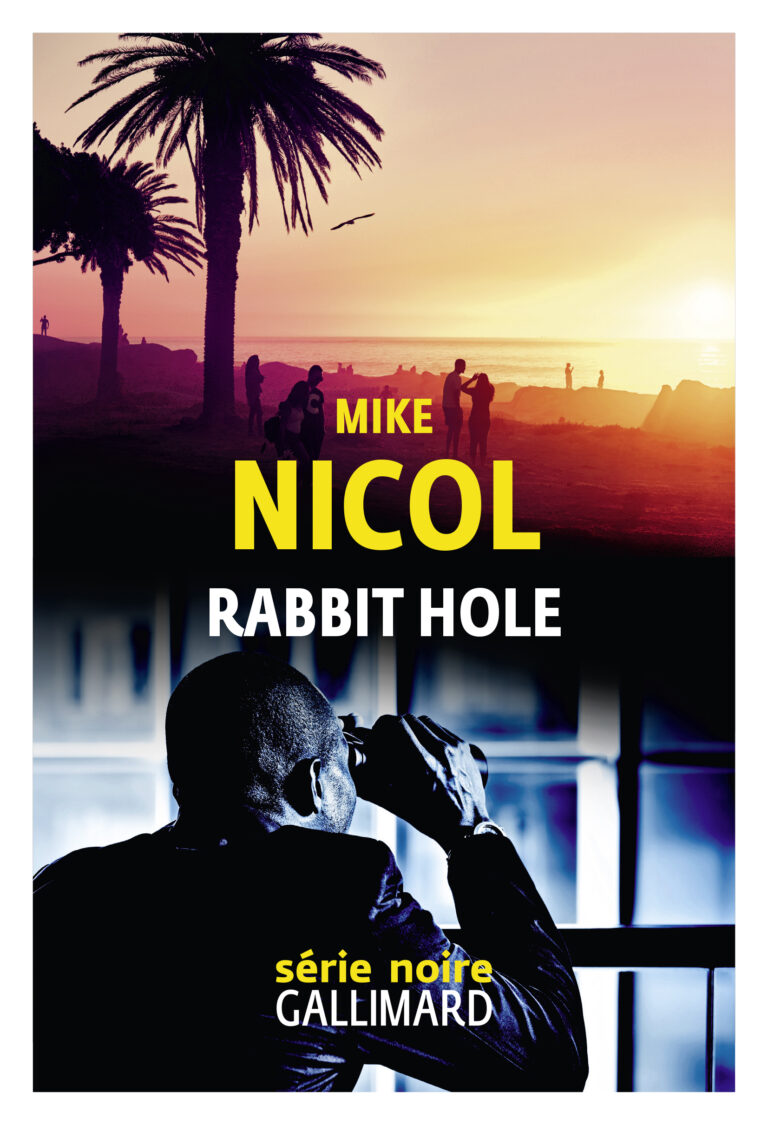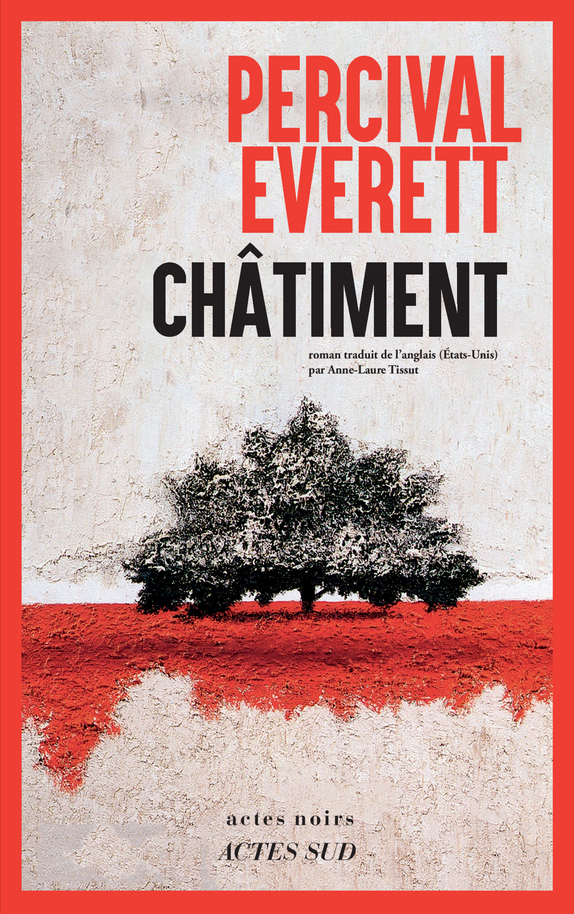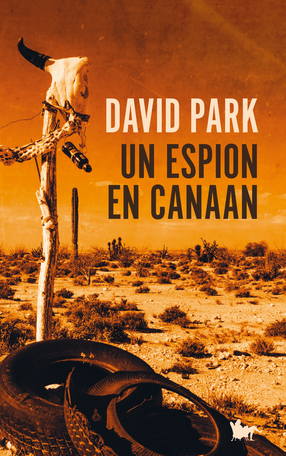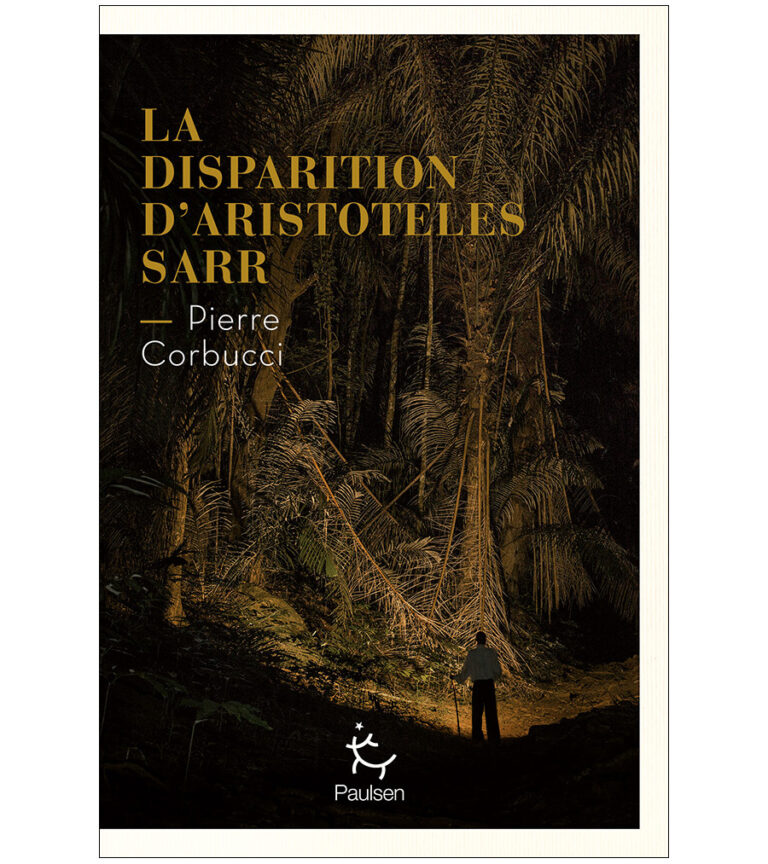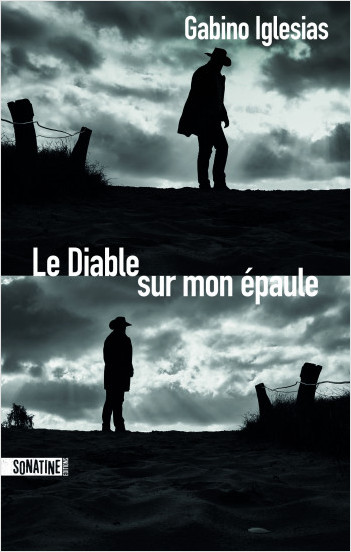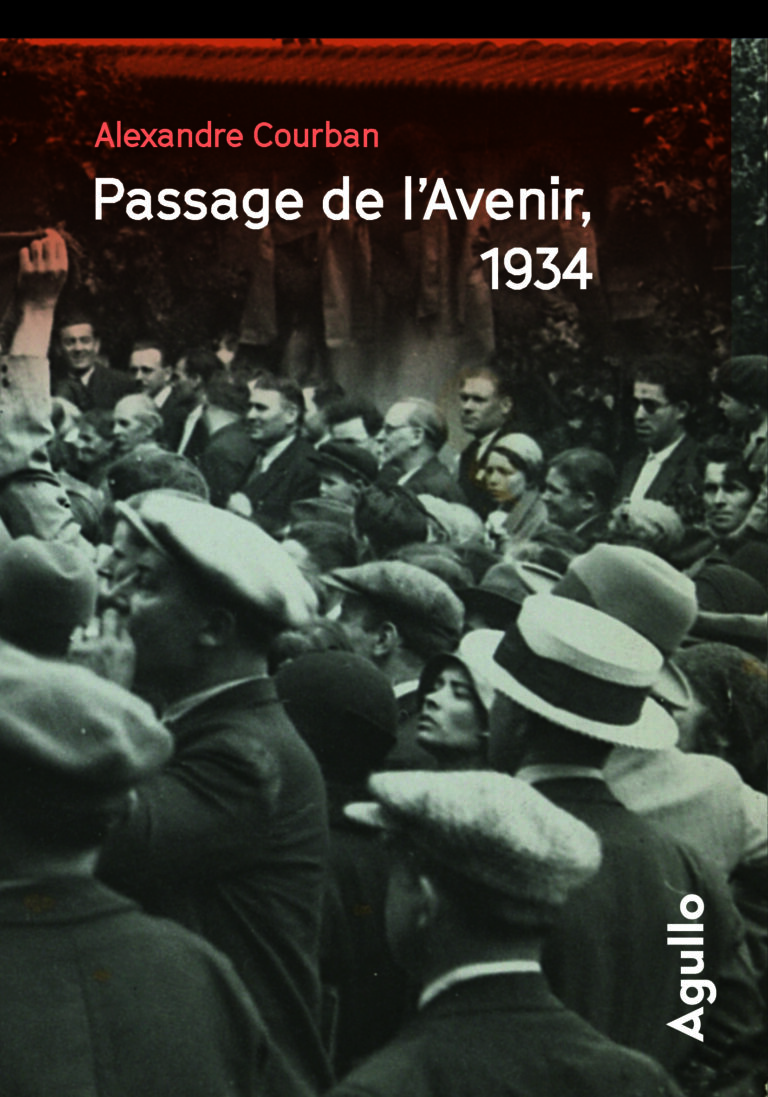Le Groenland a le vent en poupe en ce moment en littérature. Et quand en plus la CIA s’en mêle, alors là… Hiver 1967, trois soldats américains se retrouvent piégés dans l’incendie d’une base nucléaire dans cette région polaire. Un seul survit. Le corps quasi-totalement brûlé. Le rescapé affirme néanmoins ne se souvenir de rien. Le psychiatre Jack Miller entre en scène. Il a l’habitude de travailler avec la célèbre agence de renseignements. Mais cette fois encore, la vérité aura un prix.
« Projet Iceworm » de Simon Mockler est un classique du genre mais inspiré de faits réels. L’opération fut bel et bien menée secrètement par les militaires américains pendant la Guerre froide, dans les années 1950-1960. Une époque où tout était permis et l’argent dépensé sans compter, au nom de l’affrontement auquel se livrait les deux grands ennemis. Le Camp Century abrite alors un arsenal nucléaire dissimulé sous la calotte glaciaire du Groenland. Méga ingénieux. Trente kilomètres de tunnels abritent des installations de soutien essentielles, notamment des logements pour le personnel militaire, des laboratoires de recherche, des entrepôts pour les fournitures et des générateurs électriques, permettant à la base de fonctionner en totale autonomie pendant de longues périodes. Une vie souterraine à rendre dingue le maître du Tai chi en personne. Surtout quand la glace se met à bouger. De la matière première hors pair pour un écrivain malin.
Simon Mockler n’a pas laissé passer l’occasion. Un climat claustrophobique, la CIA, un personnage principal Jack Miller, psychiatre new-yorkais qui émarge aussi pour l’Agence. A lui d’essayer de faire parler le survivant, Connor Murphy, après six jours de tempête arctique. Ses compagnons, Owen Stiglitz et Henry Carvell, ont péri dans d’atroces conditions, brûlés par un feu carnivore. Un drame qui n’émeut pas plus que ça la CIA parce que dans ce trio d’aventuriers du grand Blanc, il y a un espion à la solde de l’ennemi soviétique. On a fait appel à Miller parce qu’il passe ses journées à écouter des gens lui raconter des salades. « Personne ne commence par dire la vérité dans un cabinet de psy. La plupart du temps, ils ne se rendent même pas compte qu’ils mentent. Ils disent juste ce qu’ils voudraient qui soit vrai, et dans leur tête, ça revient au même. » Des subtilités dont se moque la CIA. Ce qu’elle veut, c’est que Miller découvre ce que Connor dissimule. Il se rend à plusieurs reprises à son chevet afin de le pousser dans ses retranchements mutiques. Connor n’était qu’une petite main, un simple ouvrier en ingénierie et maintenance. Le grand savant, c’était Stiglitz, un gars pas sympa du tout. Il existait une tension réelle entre lui et Henry. Miller insiste, tente de décortiquer le drame qui s’est joué, la dynamique qui s’est installée lorsque l’armée a décidé de quitter la base parce que devenue trop dangereuse. Et que le trio bancal faisant partie de la dernière fournée à évacuer, s’est retrouvé piégé à cause d’une tempête hivernale monstrueuse. Une semaine de huis-clos avec deux hommes qui se détestent. Cela ne pouvait pas bien se finir.
L’affaire est tordue. Miller se fait attaquer chez lui, il est suivi, il est clairement en danger. Le psychiatre décide alors d’enquêter comme un détective qu’il n’est pas. Chaque chapitre correspond à son itinéraire. « Centre médical militaire Walter Reed, 27 décembre, 9 h 30. » « Langley, bâtiment B, 27 décembre, 15 heures. Vol à destination de New-York, 28 décembre, 9 heures. » On le suit ainsi à la trace de Manhattan en Virginie en passant par le Maine, et enfin au Groenland, dans un final spectaculaire. Le roman est truffé de rebondissements qui nous empêche de le lâcher. La reconstitution des mœurs de l’époque est savoureuse. Les contraintes sanitaires qui existent aujourd’hui n’étant pas encore d’actualité. Ainsi Jack Miller fume -t-il comme un pompier, que ce soit au bar, dans son cabinet ou même au chevet des malades à l’hôpital. S’il a remarqué que son copain et interlocuteur de l’Agence, Paul Coty est alcoolique, lui-même ne dédaigne pas les verres de whiskey. En quantité. Simon Mockler a imaginé un personnage qui veut guérir les cerveaux et qui travaille pour ceux qui les triturent. Un grand écart dont il se sort avec brio. Du romanesque au service d’une autre cause, plus diffuse mais bien réelle : le climat. Quel est l’impact aujourd’hui de ces bases abandonnées du projet Iceworm alors que la fonte glaciaire se vit en accéléré. Comment nettoyer ces lieux mystérieux qui libèrent chaque jour des contaminants radioactifs ? Encore une fois, le polar a rempli sa mission : divertir et alerter.
« Projet Iceworm » de Simon Mockler, traduit par Chloé Royer, Éditions Belfond/Noir 368 pages, 21 euros.