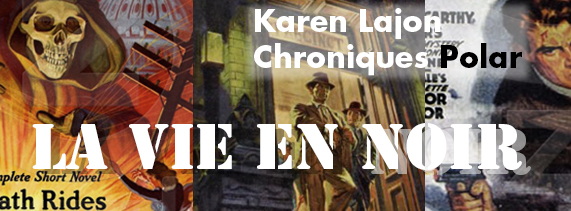Il était tellement gentil l’oncle Claudio qu’au début, c’est même elle qui demandait à aller chez lui. Les prédateurs ont toujours su y faire. Et puis un jour, elle n’a plus voulu. Personne n’a cherché à comprendre. Ni la mère, ni le père, chacun empêtré dans une vie propre qui allait les conduire au divorce. Virginia Belén López Peiró a cessé d’être une enfant joyeuse. Les gros doigts de son oncle étaient entrés en elle.
La confession qui fut tout autant une déflagration eut lieu en 2022. L’Argentine Bélen López Peiró ose raconter cet oncle et les viols qui seront disséqués ad nauseum plus tard, dans un premier livre, « Pourquoi tu revenais tous les étés » (Éditions Globe). « Là où je n’ai plus pied » nous emmène sur le chemin tortueux de la bataille judiciaire. La jeune femme va parler jusqu’à plus soif. Dans les grandes lignes, dans les détails et encore plus de détails. Une fois, dix fois, cent fois, neuf ans. Une locomotive puis un train lancé à grande vitesse balayant tout sur son passage. Parce que dans ce genre d’affaires, il y a les faits et les dégâts collatéraux. Il y a soi et les autres. Et ils ne sont pas rien, les autres. Ce ne sont pas eux que les gros doigts de l’oncle ont touchés. Surtout pas, ils n’en veulent pas. Entre les soutiens, les détracteurs et les accusateurs, ces moments de violation de l’intime échappent et deviennent la propriété de tous. Un enfer qui tourne en boucle indéfiniment.
Lorsque le processus de la parole est enclenché, il y a le soulagement. De courte durée. Parce qu’en réalité, rien ne change. La peine, la blessure, la honte, rien ne part jamais. Alors, on franchit un autre océan, on saisit la justice. On est déjà allé au commissariat, on a porté plainte et on a décidé d’aller plus loin. On veut que l’oncle soit reconnu coupable et qu’il subisse une peine. Aussi grande que la sienne. Impossible, jamais, alors on se contentera d’une privation de liberté.
Le texte de Belén López Peiró est polyphonique et rythmé par l’insertion des procès-verbaux. La voix du père traduit l’incrédulité, celle du frère le fait qu’il n’ait rien vu, celle de la fille de l’agresseur est synonyme de colère et de déni tout comme celle de l’épouse. Le premier avocat est aussi convié à se faire entendre dans cette symphonie discordante. C’est donc une narration hachée, inventive où sont insérés des SMS, des définitions de mots trouvés sur Internet. Sans oublier les réseaux sociaux. Le viol est une arme vieille comme le monde. C’est le fusil de l’homme faible. Il peut être inconnu mais il peut aussi être le voisin, le père, le frère ou l’oncle. Il échappe à l’usure du temps, il a une capacité de renouvellement infini. Comment en parler en réinventant sa narration ? Comment capter l’attention pour partager une douleur commune à toutes les victimes ?
La journaliste argentine de formation nous emmène dans ce labyrinthe émotionnel et judiciaire et nous fait vivre cette double peine que s’infligent parfois certaines victimes. Il y a de grands moments de découragement, d’envie de renoncement tout au long de la préparation du procès. « Je ne vais plus à la fac, je ne me présente pas à mon dernier examen de master ». On lui propose une procédure abrégée. Elle a déjà mis cinq ans à trouver une avocate, une représentante et une commission capable de l’accompagner. Et voilà qu’on lui propose une solution. « Oublier? Lâcher ? Laisser tomber ? Est-ce qu’on peut réparer le corps comme on répare une tasse ébréchée ? »
2023, c’est fini. Un dossier de 500 pages, deux avocats, une représentante, une commissaire judiciaire, quinze ans de thérapie, la famille coupée en deux et le village qui couvre l’abuseur. Quand le procès s’ouvre enfin, il dure cinq jours et la sentence tombe : dix ans de prison. « À partir de maintenant, je vais commencer à écrire autre chose ».
» Là où je n’ai plus pied », de Belén López Peiró, traduit de l’espagnol (Argentine), Éditions Globe, 384 pages, 24 euros.