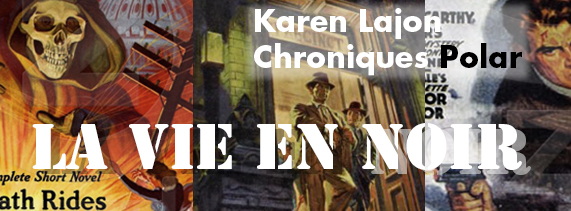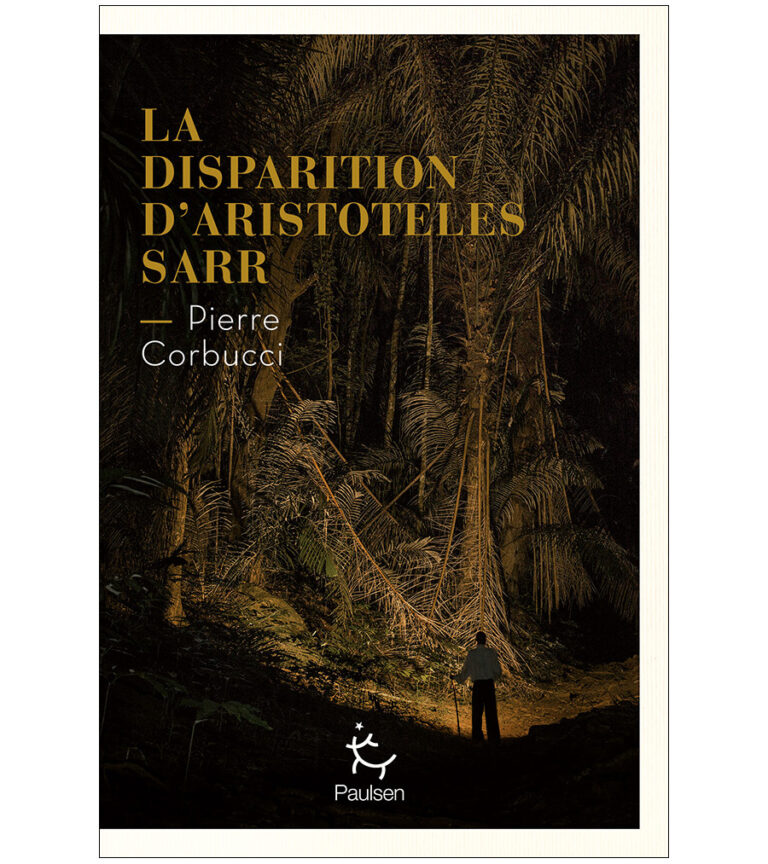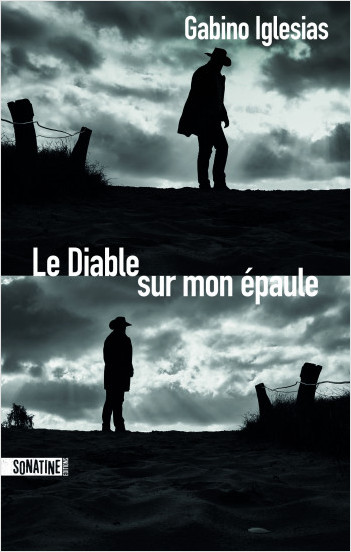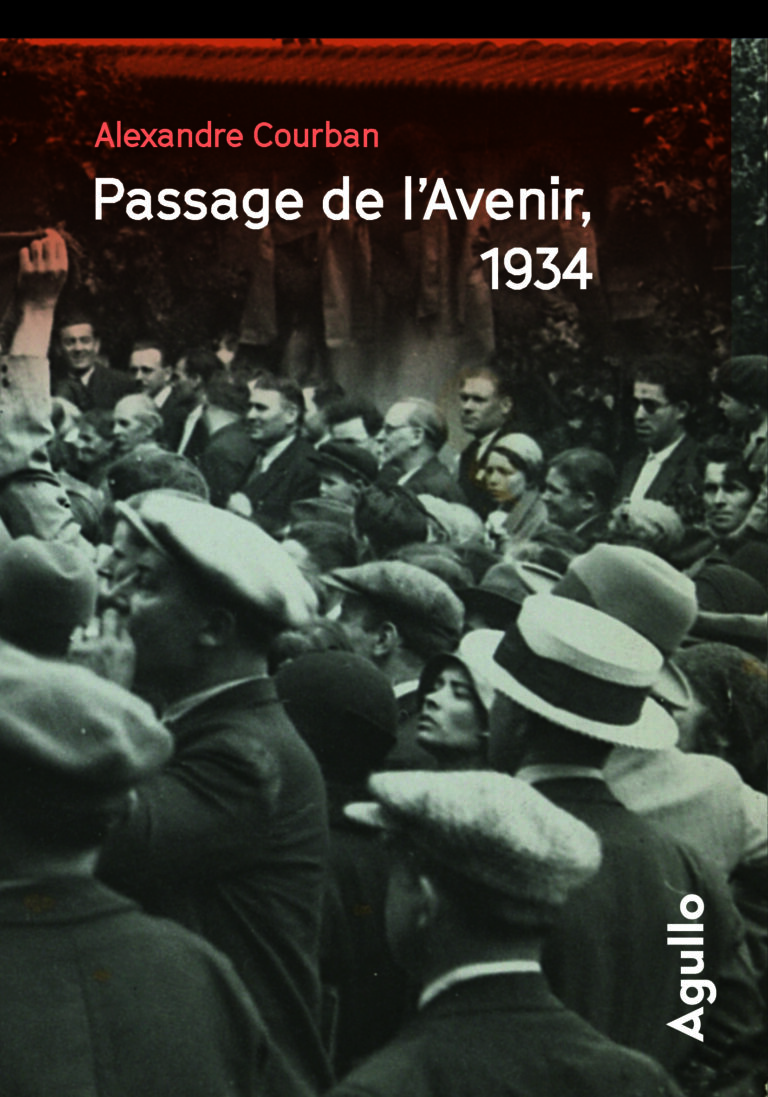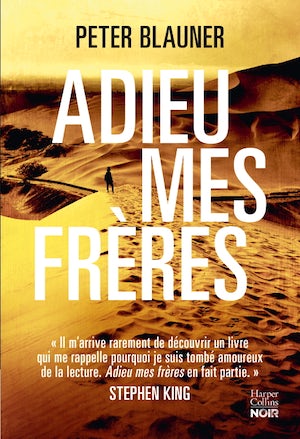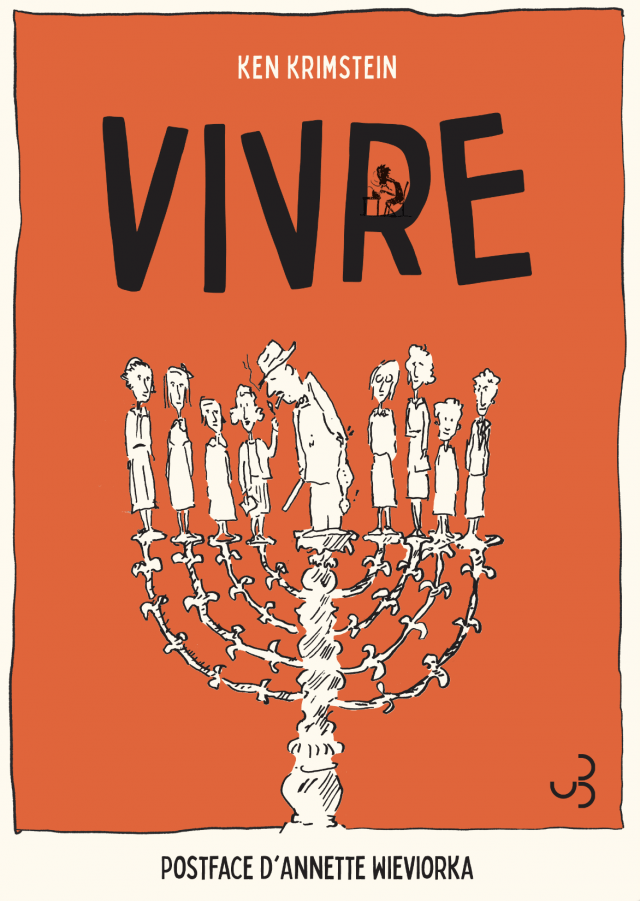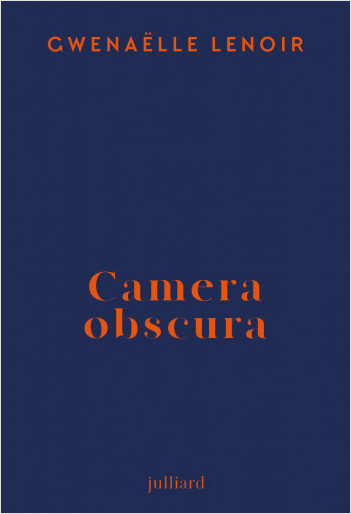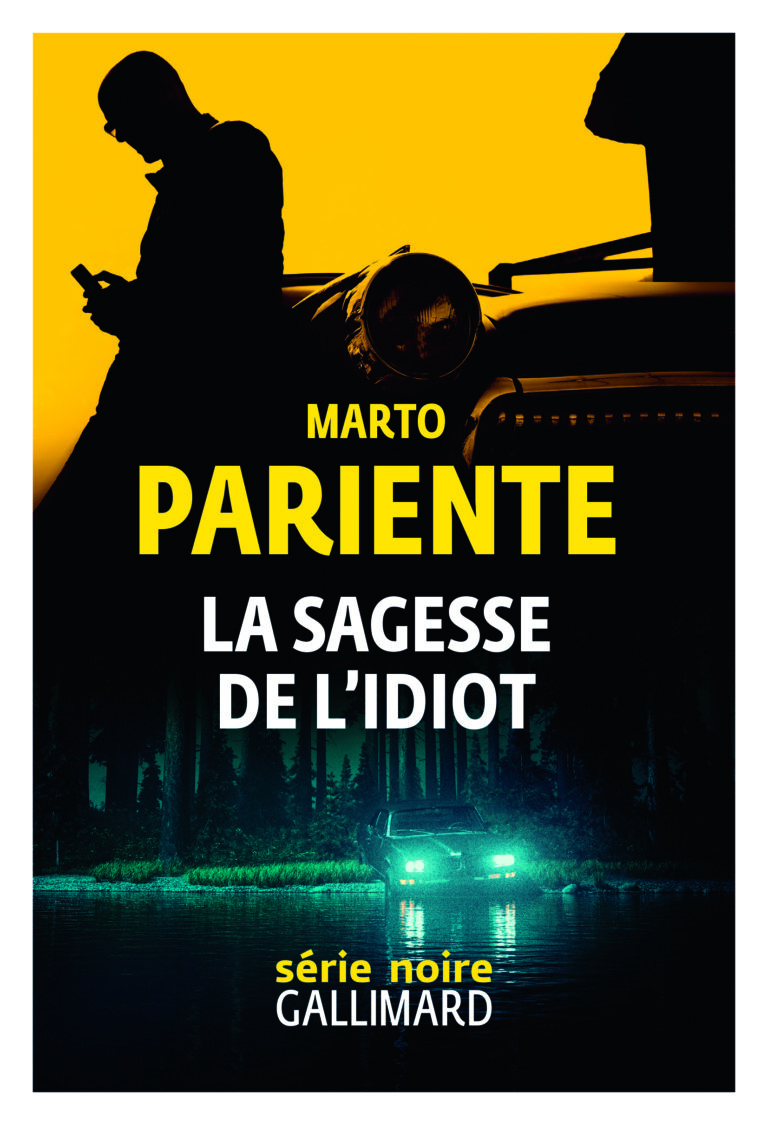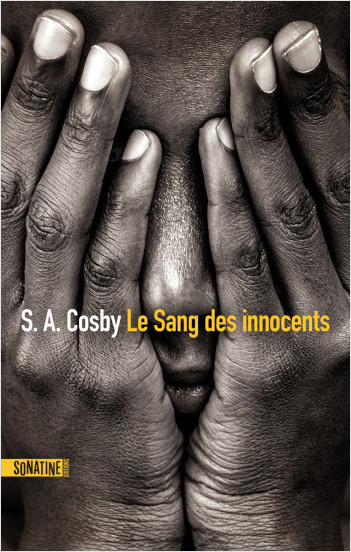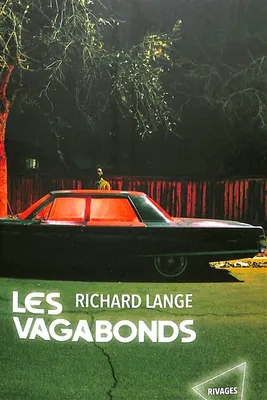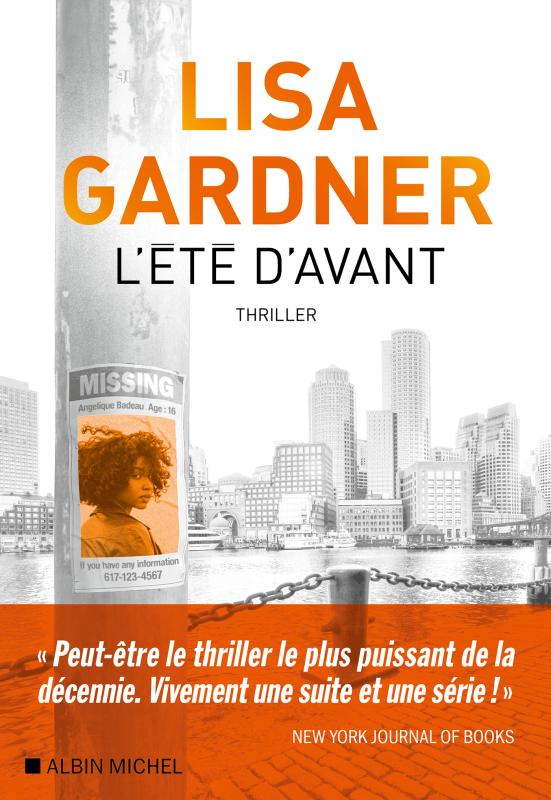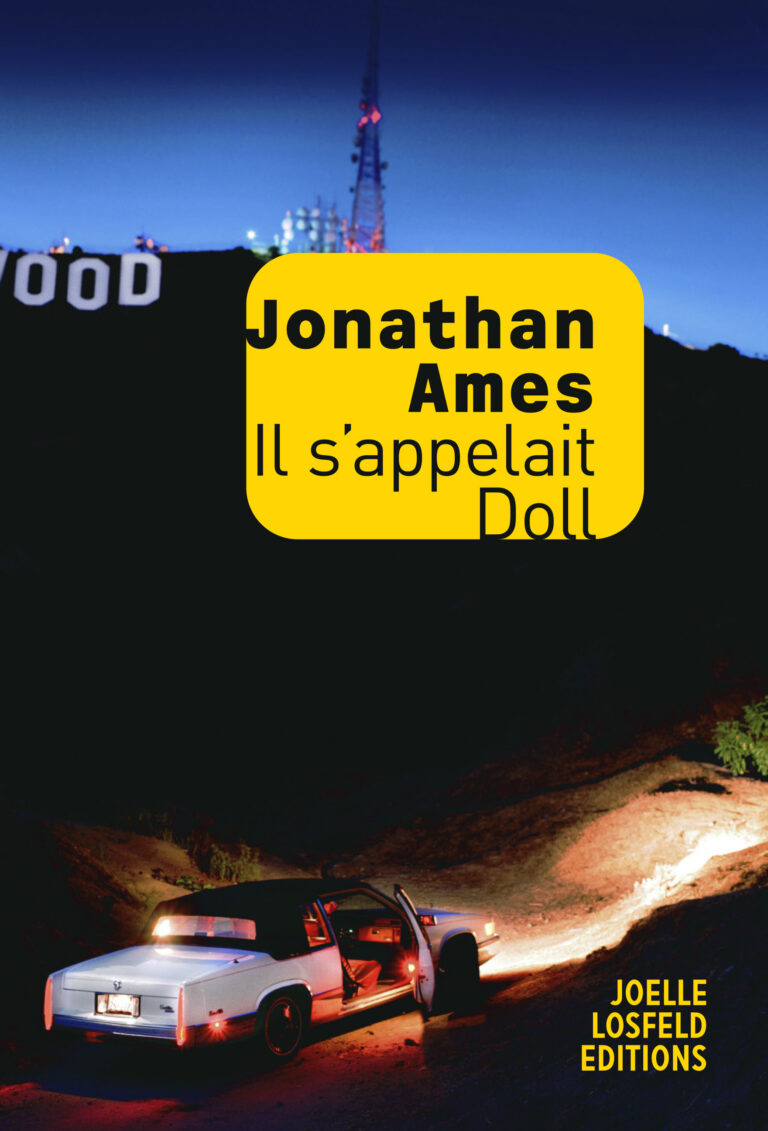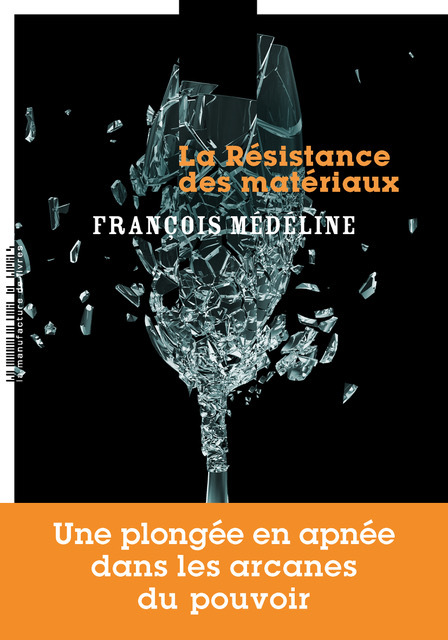Il s’appelle Aristoteles Sarr y Leon. Il est lieutenant du génie dans l’Armée de Libération Nationale. Il a une mission à accomplir. Il se doit de ne pas décevoir sa mère, cette femme qui a toujours fixé les limites de son univers. Il est chargé d’aménager une piste d’atterrissage au cœur de la forêt amazonienne. Un périmètre jamais cartographié et qui doit permettre de prolonger le chemin de fer. Aristoteles est l’un de ces magnifiques héros guindés qui traversent la littérature. Cette fois, on le doit à Pierre Corbucci ancien professeur d’histoire et voyageur accompli. Noyé dans une jungle de verdure parmi des êtres à la dérive, le jeune homme aussi innocent que l’enfant qui naît, se détachera de son ancien moi au terme de tourments auxquels il ne comprendra pas grand-chose.
Dès le début, il se prend clairement pour « L’homme nouveau, celui du XXe siècle triomphant à qui rien ne résiste. » Nous sommes dans les années 20, en Amérique du sud. Aristoteles est pétri de convictions et de certitudes, il part à l’abordage d’un monde moite et opaque, fermé sur lui-même et peu désireux d’ouvrir les bras et d’accueillir l’étranger. Il lui en faut du courage, lui qui déteste la forêt. « Le lieutenant avait grandi dans un monde d’angles et de lignes. Un monde droit, à la nature contrainte et ordonnée, remodelée par la main de l’homme, et où la courbe était une audace. » Le défi est donc majeur. Mater une forêt imprenable et sauvage. Dompter un lieu où le temps n’est plus une valeur fiable. Parce que dès le départ, son voyage prend du retard. Il se dirige en bateau vers La Huanca, les terres du sénateur Armindo Casar. Une sorte d’aventurier qui a mis sur pied un empire grâce au caoutchouc. Il a fait construire un palais fantôme, il l’appelle la Domus Aurea, la maison d’or, une folie architecturale dessinée par des architectes français et italiens. Avec des plans identiques à ceux de l’empereur Néron. C’est un dédale de couloirs et de coursives, une rotonde sous une coupole, Aristoteles s’y perd. Il regrette l’absence de crucifix au-dessus de son lit.
Son hôte le reçoit enfin. Il le trouve « à la fois absolument quelconque et absolument exceptionnel. » Le dîner est servi par des indigènes muets. Mais tout ça importe peu au lieutenant qui déroule son discours. « La piste doit être aménagée d’ici huit semaines au plus tard. » Casar l’écoute, lui met à disposition un homme qui s’appelle Ris, « un vrai fils de La Huanca » et qui connaît la jungle. Néanmoins, il le met en garde. Son fils Carcalla a disparu depuis plusieurs jours. « Certains de nos hommes sont mobilisés pour poursuivre les battues. » Aristoteles comprend qu’il faudra faire avec cet imprévu. Encore un. Casar lui fait faire le tour de la propriété. Lui montre son plus grand trésor : Incitatus, un Akhal-Teké, un cheval né au Turkménistan et qu’il a fait venir jusqu’ici. « Sa robe semble être de soie dorée. Aristoteles n’a jamais vu un animal aussi beau. » Pour Casar, il incarne « l’éclat de la perfection brute sur cette terre maudite. » Le sénateur a souffert. Il a perdu une femme qu’il aimait, une autre s’est enfuie, maintenant, c’est l’un de ses fils que l’on ne retrouve pas. Le malaise du lieutenant grandit.
L’autre fils, Riobaldo Casar est d’une beauté confondante. « La Grâce incarnée ». Les deux hommes se lient d’amitié. Dans cet univers crépusculaire rongée par une nature abrasive, des femmes tracent leur voie. Il y a Magdalena Böers qui voue un culte infini à Riobaldo. Et surtout, il y a Inca, la domestique indigène qui a « l’arrogance de ses seins hauts et fermes. » Inca aussi est animée d’une mission à accomplir dans cet Apocalypse au vert brouillé. Tous ses personnages se percutent, prisonniers de leurs désirs fous et de leurs rêves impossibles. Ils se découvrent au fil des pages, se débarrassent de leurs habits. Le lieutenant succombe à la chaleur, n’écrit plus à sa mère tous les jours comme il le faisait avant. Il croit encore qu’il vaincra la forêt, qu’il lui tordra le bras, le progrès est à ce prix, rien n’arrête le progrès. Sauf Inca qui lève le voile sur une utopie, une mascarade de Blancs. Et elle est là, droite, prête à venger les siens, à protéger la jungle. « A quoi vous vous attendiez », interroge le colonel Kurtz, dans Apocalypse Now. On entend presque sa voix qui murmure dans les feuillages. Pas à ça, a dû se dire Aristoteles.
« La Disparition d’Aristoteles Sarr », par Pierre Corbucci, Éditions Paulsen, 378 pages, 21 euros.