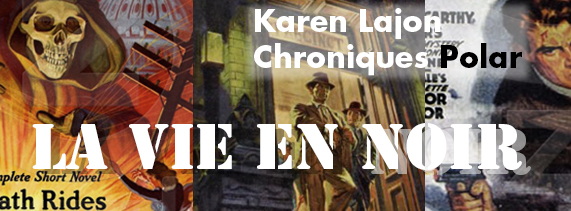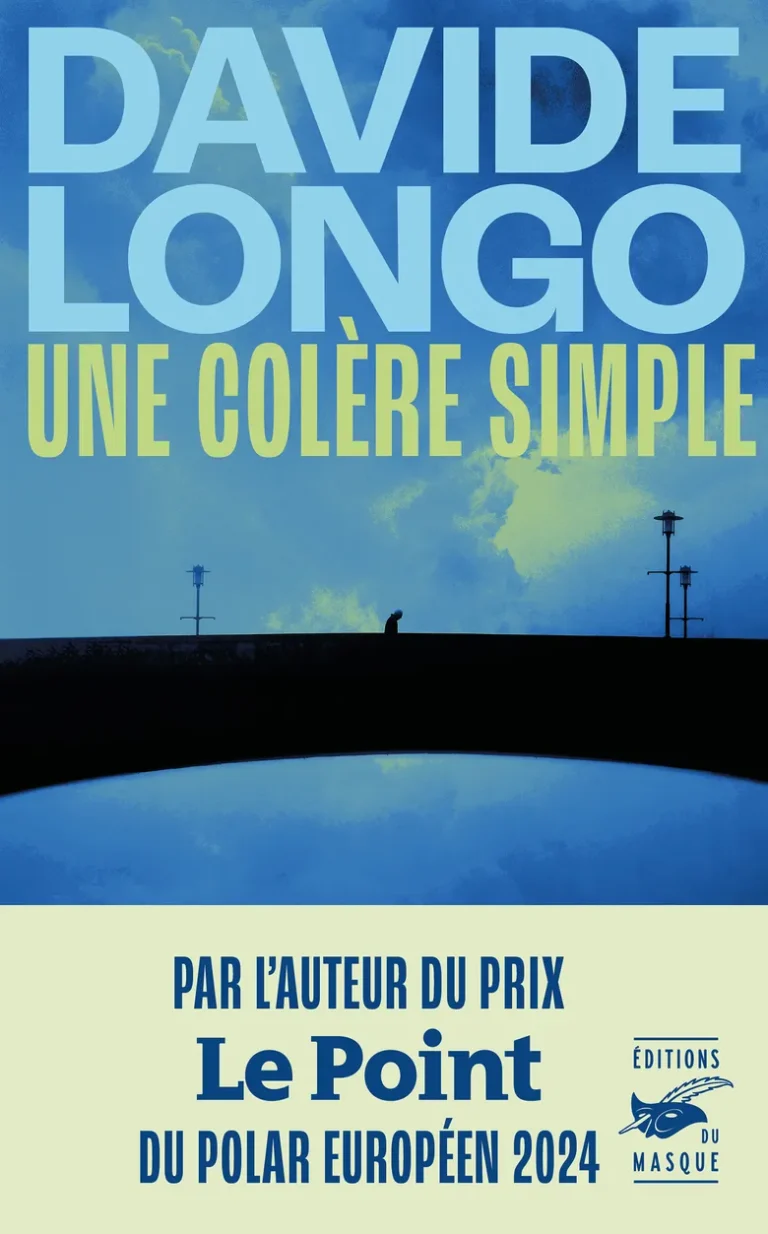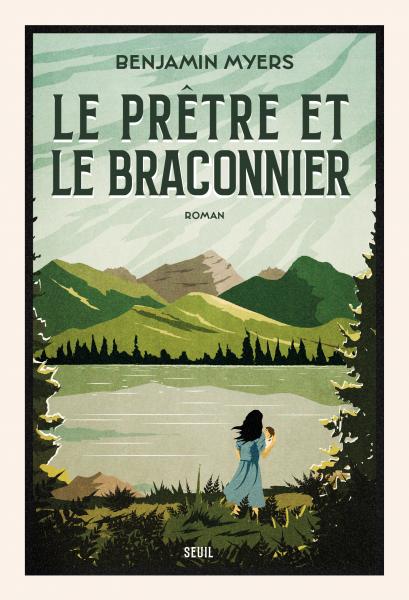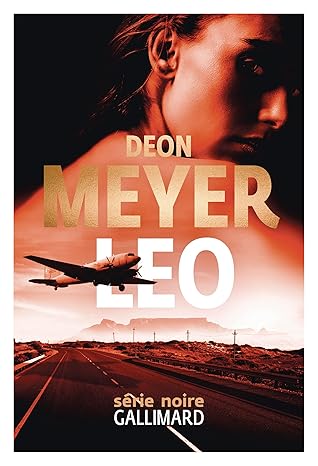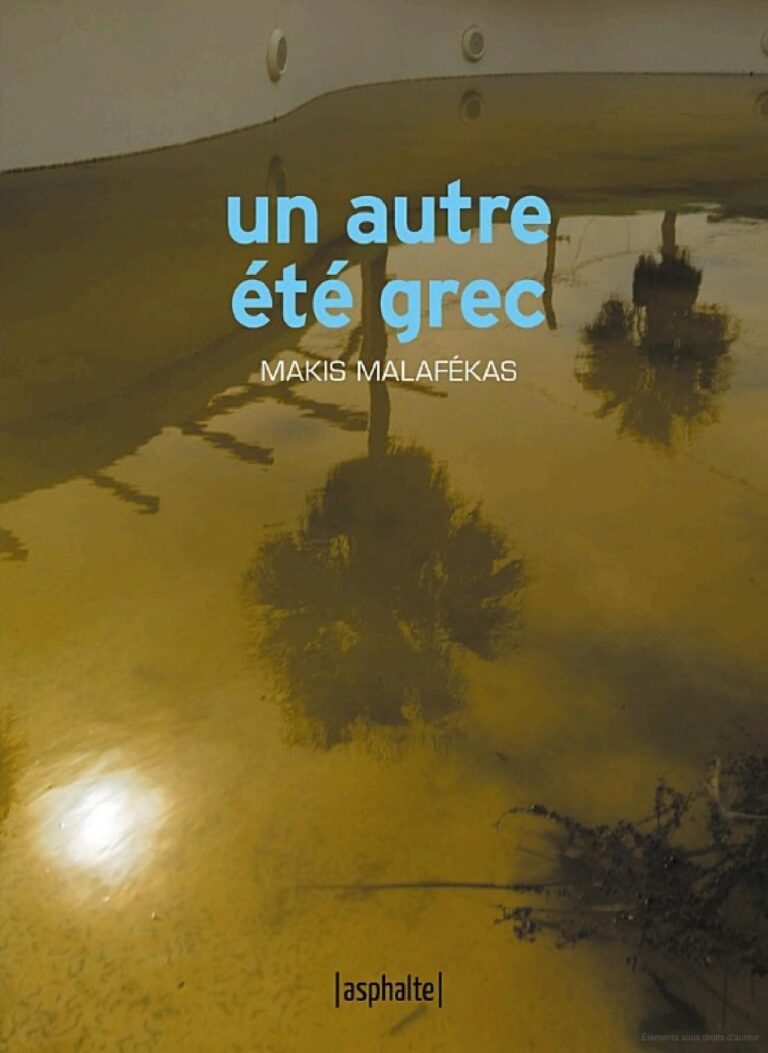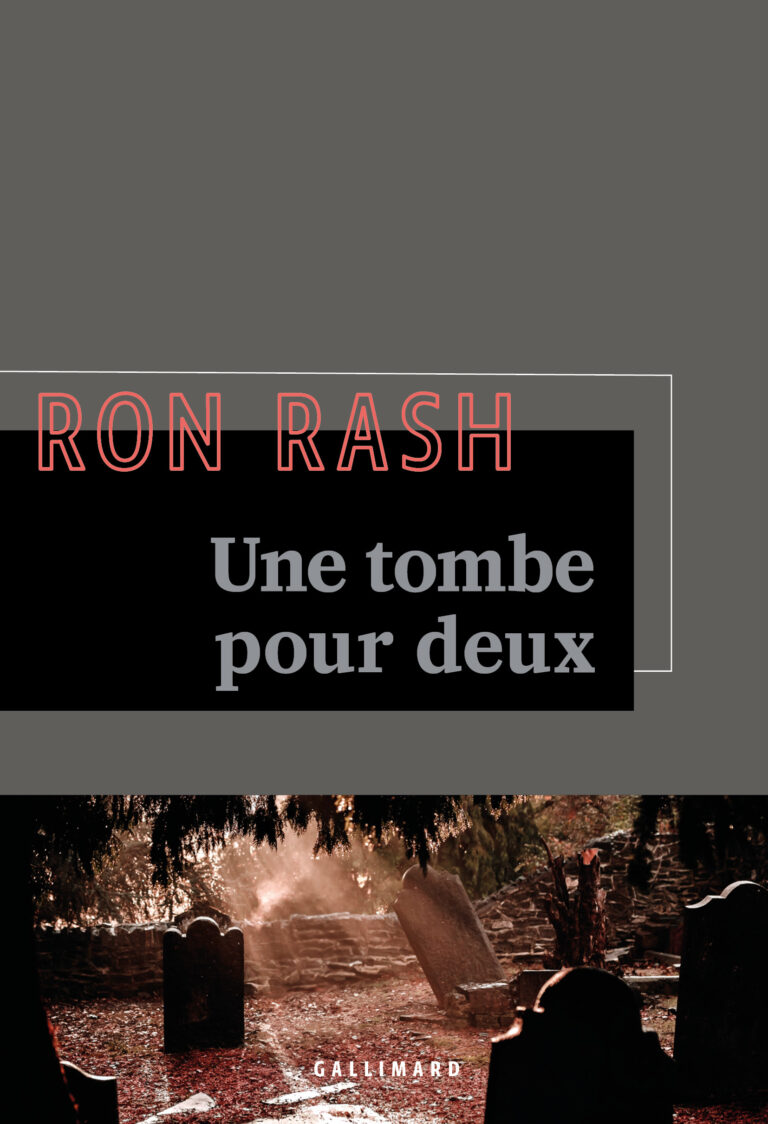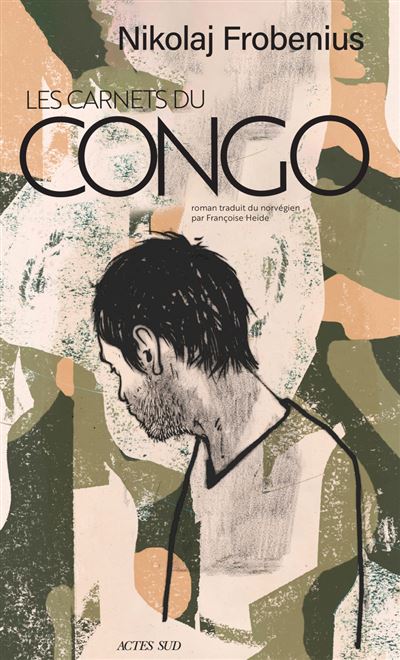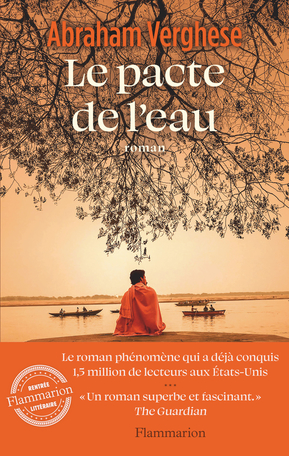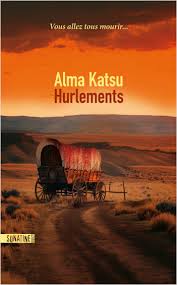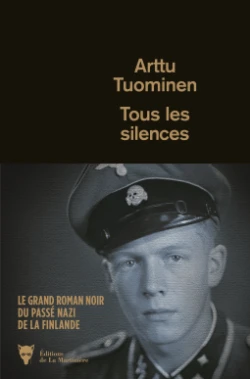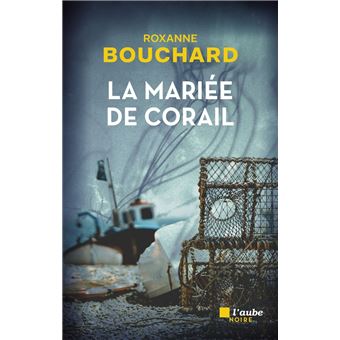Une saga familiale épique, quasi biblique, une fable où les personnages sont emportés dans le tourbillon infernal de romances sucrées, salées. Une vie ailleurs dans la moiteur d’une Inde des traditions où l’eau respire, étouffe, donne et reprend. Une vie faîte de cycles plus ou moins longs. Le roman d’Abraham Verghese est lumineux et splendide. Loin des clichés ou du regard étranger qui cherche toujours à transcender des choses qui ne peuvent l’être. On est dans le sud-ouest de l’Inde, dans ce qui est aujourd’hui le Kerala. “ Le premier État au monde, qui sera à un moment donné de son Histoire, dirigé par un gouvernement communiste porté au pouvoir non par une révolution sanglante, mais par un scrutin démocratique. “
« Elle a douze ans, et demain elle sera mariée. Mère et fille sont allongées sur la natte, joue contre joue, le visage baigné de larmes. Le jour le plus triste de la vie d’une jeune fille est celui de son mariage, lui souffle la maman. Ensuite, si Dieu le veut, les choses s’améliorent. » Héritage maudit transmis de génération en génération entre femmes, et conséquence directe d’un système impitoyable de castes dans un pays qui refuse obstinément de bouger. Nous sommes en 1900 et nous allons la suivre sur sept décades. Le romancier qui est aussi médecin et professeur à l’université de Stanford en Californie, dramatise volontairement le début de son roman. Comme pour mieux faire diversion. Parce que de cette tradition ancestrale perçue avec horreur par l’Occident, naîtra l’une des plus jolies histoires d’amour comme peut en produire la littérature de qualité. Molay s’appelle encore Molay et elle va épouser un homme de 40 ans, veuf, taiseux et qui craint l’eau. « Cette région est façonnée par l’eau, et ses habitants unis par une langue commune : le malaylam. » Plus tard, ces territoires seront regroupés pour former l’État du Kerala. C’est aussi ici que saint Thomas convertit les premiers chrétiens en l’an 52. Ainsi, « deux descendants de ces premiers convertis Indiens, une jeune fille de douze ans et un veuf de dans la force de l’âge, viennent de se marier. » Les us et coutumes seront respectés à la lettre. Le mari ne touchera sa femme que lorsqu’elle aura atteint seize ans et un an plus tard, elle donnera naissance à son premier enfant, une fillette, Bébé Mol. Quelques-uns des protagonistes de cette première partie de l’ouvrage nous accompagneront jusqu’en 1977. Molay deviendra maman une seconde fois, d’un fils Philipose, qui lui-même épousera Elsie, la fille d’un Indien riche et personnage haut en couleur.
Une vie est traversée de joies et de drames. Celle de Molay qui deviendra Big Ammachi, n’échappera pas à cette équation. Premier bonheur : ce mari beaucoup plus âgé qui se révélera attentionné et bon. Elle sait lire mais pas lui. Il laisse le journal, le Manorama, sur la table. Une complicité se forme, une habitude, elle lui lira les nouvelles. Ce geste est d’une modernité absolue dans un pays où les femmes vivent, respirent selon le bon vouloir de l’époux. On comprend très vite que le romancier n’a pas l’intention de nous conter une histoire atroce qui pourrait alimenter tous nos fantasmes sur une Inde répressive (souvent réelle) envers les femmes. Abraham Verghese a choisi la nuance, la bienveillance. Et parfois, l’amour qui peut naître entre deux personnes contraintes par une société toute puissante. On vit au rythme de leurs malheurs et de leurs bonheurs, enchantés par les barrissements de Damodaran (Damo), l’éléphant qui s’installe toujours près du plus vieux palmier. Il est capricieux. Contrairement aux chèvres ou aux vaches, il refuse de manger dans les excréments. Il s’approche, et c’est tout nouveau, de la cuisine, la preuve qu’il aime bien Molay. Le jour de ses seize ans, l’animal s’enhardit davantage. Le soir, son mari vient la chercher. Le pachyderme avait deviné. « La vie se poursuit à son rythme habituel. Bouches à nourrir, mangue à cueillir, riz à vanner, Pâques, Onam, Noël, un cycle qu’elle connaît sur le bout des doigts et qui l’aide à mesurer l’écoulement des jours. En apparence, rien n’a changé. Mais après cette nuit-là, toute distance entre mari et femme s’évanouit. » Et puis, ce sera le chagrin. Une petite fille qui le restera toujours. La découverte de la Malédiction qui provoque la mort de Jojo, le fils de son mari et de sa première épouse décédée, noyée dans les eaux. Il l’appelait l’enfant tigre parce qu’il adorait grimper aux arbres. Mais il est mort noyé dans un fossé d’irrigation. La Malédiction a réclamé son dû. Molay s’interroge : « Est-ce une fatalité, un fléau divin, ou une simple maladie ? »
Madras, 1933. Un jeune médecin, Digby Kilgore, originaire de Glasgow en Écosse, est sur le point de débarquer après avoir traversé la Manche, la Méditerranée, la mer Rouge et l’océan Indien. Des étendues marines à l’infini. Étourdissantes, éprouvantes. Mais il arrive à bon port et prend ses fonctions à l’hôpital Longmere où il espère acquérir un savoir-faire de chirurgien. Il est doué et prometteur. Il découvre le service réservé aux indigènes, celui des Anglo-Indiens et celui des Britanniques. Ce dernier est la chasse gardée du docteur Claude Arnold. Un incapable, raciste, alcoolique et mondain. Les autres sont à la charge du docteur Ravichandran, chirurgien indien de haute volée. C’est avec lui que Digby veut perfectionner sa maîtrise de la chirurgie. Les malheurs qui touchent les femmes et les hommes se moquent de leur couleur de peau ou de leur place dans la société. Digby a eu une enfance misérable, il était du côté des oppressés. En Inde, alors sous domination britannique, il est de facto le dominant. Abraham Verghese adore les changements de perspective. Qui est-on et quelle place occupons-nous, en fonction de l’endroit où l’on vit. Le romancier n’aime pas le noir et blanc. Il vit dans les nuances.
À quel moment, les deux univers vont-ils se percuter ? Comment Big Ammachi s’insère-t-elle dans le récit de ce Blanc venu de Glasgow. La médecine est le premier pont. Deux hommes se distinguent. Digby Kilgore et le docteur suédois Rune Orqvist, également fondateur d’une léproserie. Les opérations sous la plume de l’écrivain/médecin sont épatantes. On découvre des maladies propres au pays, on suit l’apprentissage humble et attentif de Digby avec fascination. La morve des Blancs, l’adresse des chirurgiens locaux écrasée par ces mêmes Blancs, soucieux de préserver un prétendu savoir qui leur échappe ou qu’ils dominent parfois à peine, comme ce docteur Arnold. Le deuxième lien repose sur les personnages et leur destin. Le mari de Big Ammachi est décédé. Son fils Philipose se rend à Madras. Il doit y étudier la médecine. Ce sera un échec. Il rencontre une jeune fille, Elsie, qui le dessine. Elle sera son obsession. Elle deviendra sa femme. Il lui promet la lune. Pendant ce temps, la colère gronde, explose, l’Inde acquiert son indépendance. Le livre de l’auteur n’est pas politique mais les soubresauts de la nouvelle nation sont incorporés au récit avec une adresse de magicien.
Elsie est un joyau. Philipose se transforme en imbécile. L’arbre qui assombrit la demeure ? Elle veut qu’il s’en débarrasse. Il fait traîner l’affaire. Leur fils meurt. Il n’a pas succombé à la Malédiction qui veut qu’à chaque génération un membre de la famille disparaisse dans les flots du fleuve, mais il a quand même cessé de vivre. Elle le quitte, revient, accouche d’une fille. Se rend au bord de l’eau. Et disparaît. La Malédiction ? Le deuxième échec, assurément. Abraham Verghese nous chatouille avec un suspens qui ne dit pas son nom. Il a mis dix ans pour écrire ce roman qu’il a dédié à sa mère, Mariam. On arrive à 1977. La petite-fille de Big Ammachi a accompli son rêve : Mariamma est médecin. La passation de pouvoir ultime. De la femme découlera la vérité et la connaissance. « Le Pacte de l’Eau » est une saga plus féminine que féministe, écrite par un homme dont le propos initial n’était sans doute pas d’en faire un manifeste politique et genré. Il y a trop d’amour, d’intelligence et de bienveillance dans ce conte du Kerala où les rêves de gens ordinaires se transforment parfois en réalité extraordinaire. Un antidote à la morosité ambiante, à la fureur du monde qui nous entoure. Un espoir, l’assurance que l’Homme peut se montrer bon. Parfois.
« Le Pacte de l’Eau » d’Abraham Verghese, traduit de l’Anglais (États-Unis) par Paul Matthieu, Éditions Flammarion, 827 pages, 24.90 euros.