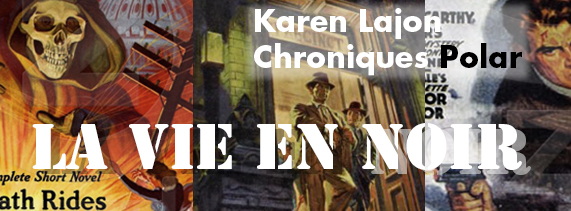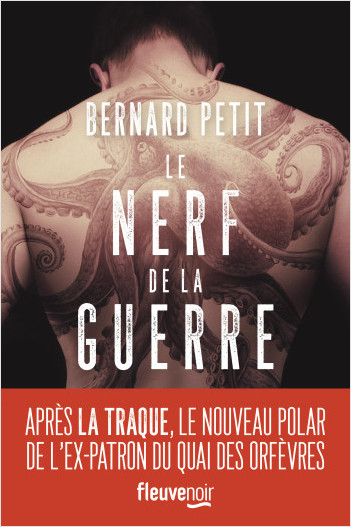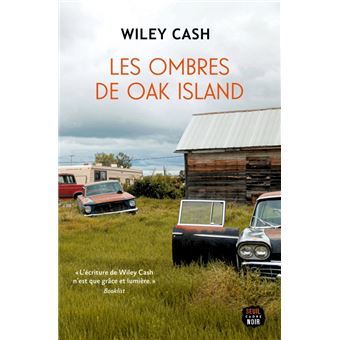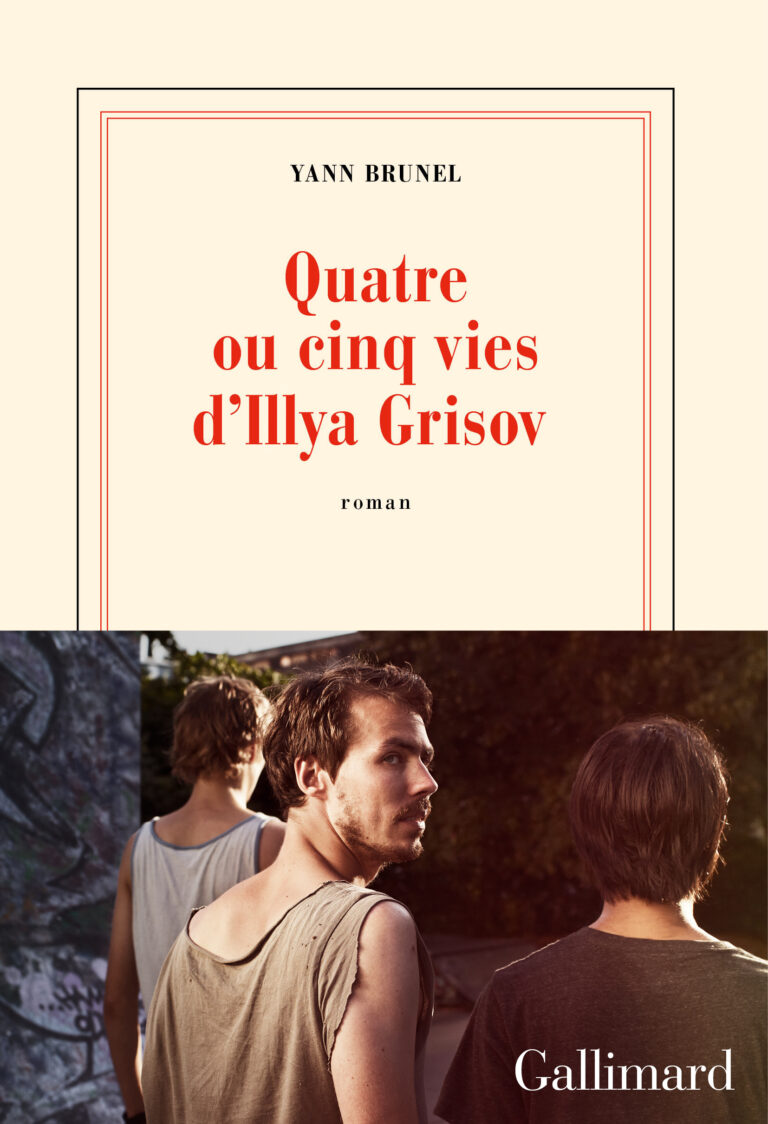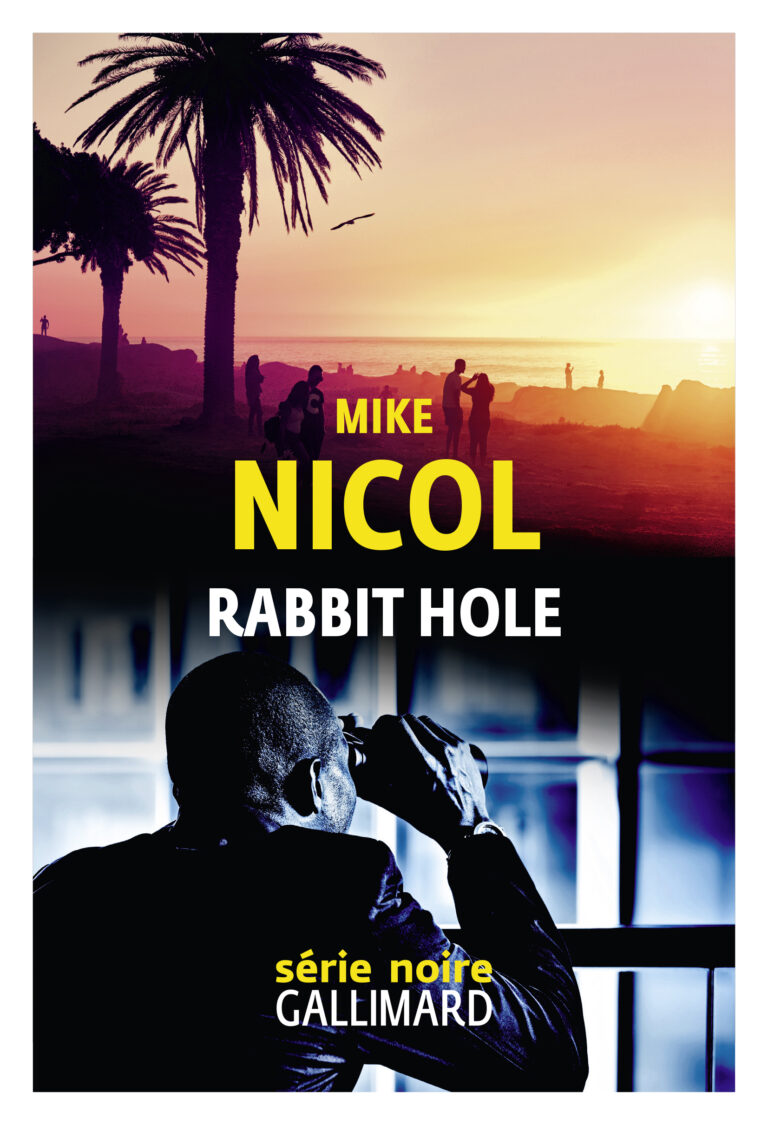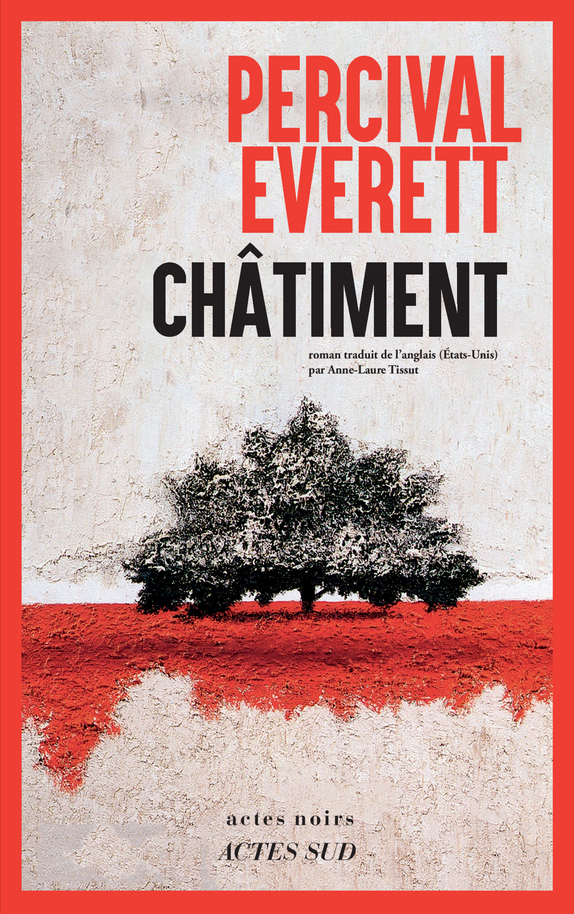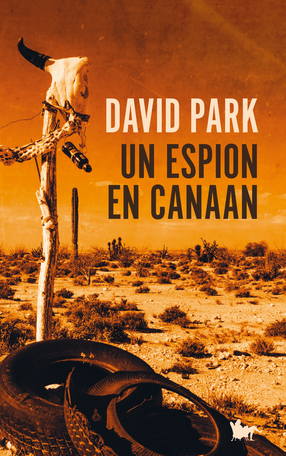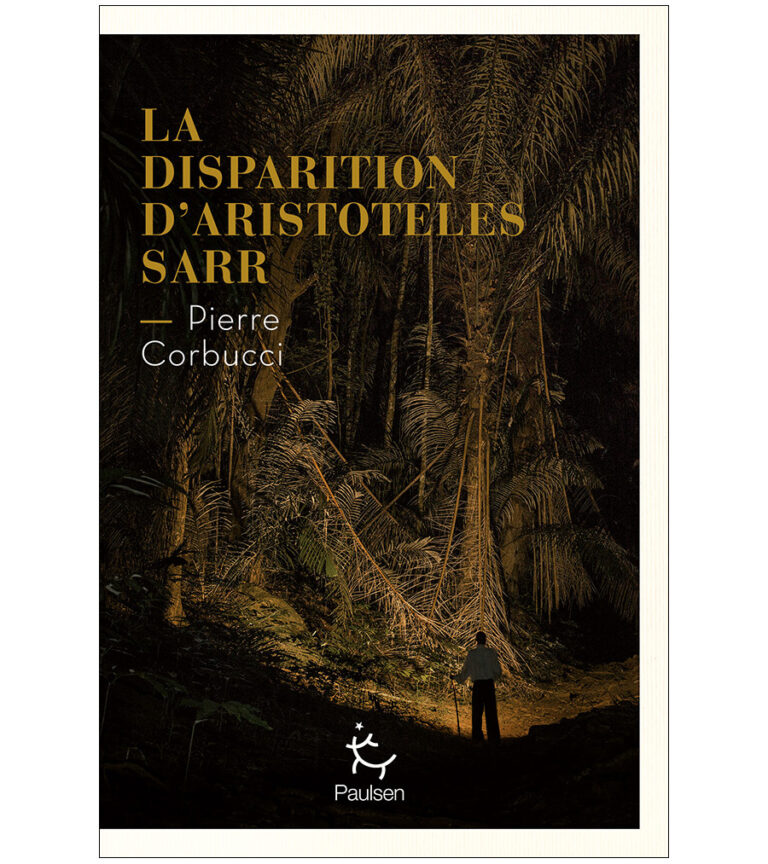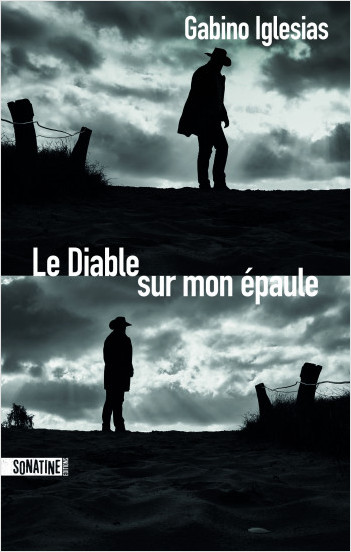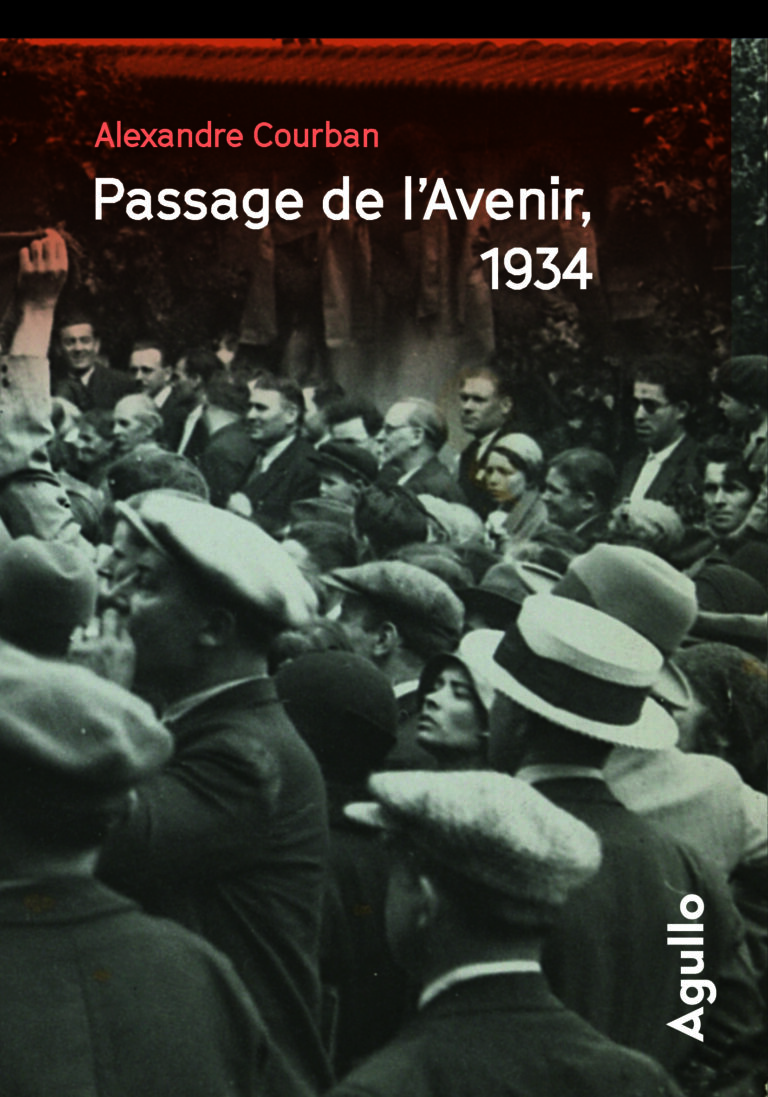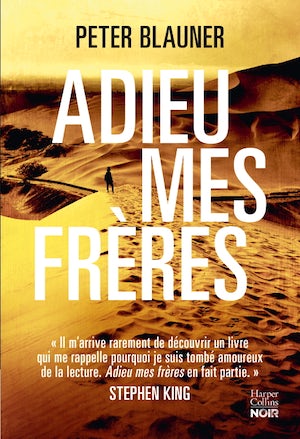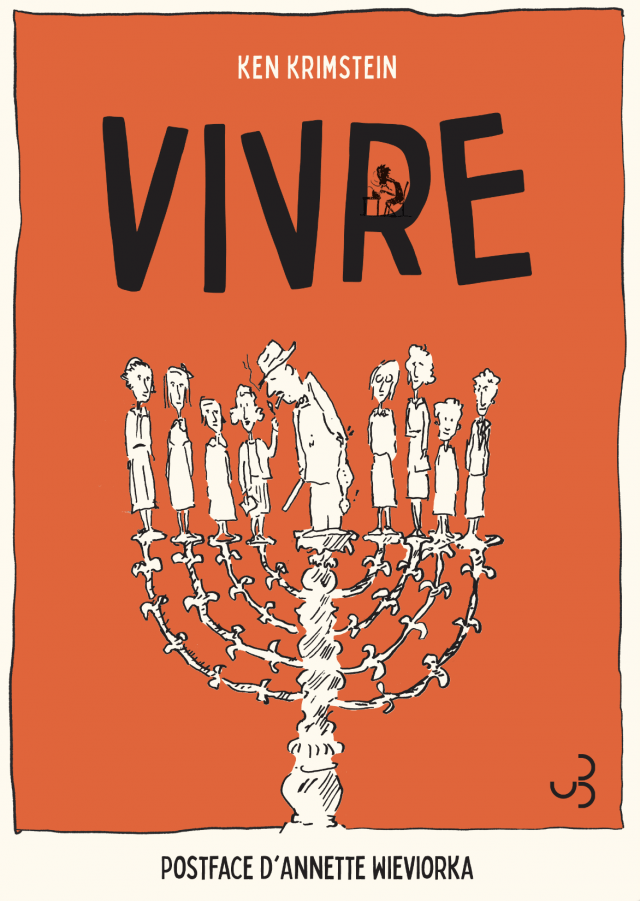Bernard Petit n’est pas un amateur dans son domaine. Il a dirigé le prestigieux Quai des Orfèvres, le bâtiment qui abrite la police judiciaire, à Paris. Fort de cette expérience unique, il en a tiré quelques leçons. Humaines et littéraires. Avec ce deuxième roman, « Le Nerf de la Guerre », l’ancien patron de la PJ prouve que la fiction est un domaine qu’il commence à sérieusement maîtriser. « Chi va piano, va, sano, e, va et lontano ». « Qui va doucement, va sainement et va loin ».
Au bas de l’échelle. C’est souvent comme ça que les grands boss de la criminalité débutent une carrière hors normes. Et c’est exactement ce qui est arrivé à Youssef Tahir, petit Marocain parmi d’autres. Le gaillard n’a pas fait de grandes études mais il est bon en maths et en logistique. La contrebande est un territoire où gagner de l’argent. Il saute à pieds joints, ce sera d’abord l’essence puis le cannabis en misant sur la proximité avec l’enclave de Melilla et l’Espagne. « Il faisait partie de ces manœuvriers recrutés pour charger les « valises marocaines » sur ce qu’on appelait « les gommes », dans le jargon, à savoir les bateaux type Zodiac. » Il se fait remarquer pour son ardeur à la tâche, son ingéniosité et sa fidélité. Le Patron demande à le rencontrer. Ce sera son mentor, celui qui lui ouvrira les portes du trafic à grande échelle et son carnet d’adresse. Il ira même jusqu’à épouser sa fille, un mariage d’amour sur fond d’activités criminelles lucratives. D’ailleurs dans son genre, Youssef devient une sorte de créateur. « Un peu comme dans une maison de haute couture. Il imaginait un modèle, ou plutôt un process, et Le Patron mettait à sa disposition tout ce dont il avait besoin pour le réaliser, assuré du génie de son protégé et des bénéfices à la clé. » Son coup de génie : « créer un flux de trafic qui prendrait à contre-pied tous les dispositifs douaniers et policiers en faisant monter des conteneurs le plus haut possible au nord de l’Europe pour faire redescendre le cannabis vers le sud, tandis que le système répressif des gouvernements avait été pensé et organisé pour lutter contre les flux montants de l’Espagne. » Très vite, la tonne se transforme en centaines de tonnes de produits illicites qui inondent tranquillos le marché européen. On appelle tout ce petit bazar Le Système. Chaque acteur de ce marché parallèle y trouve son compte. Le Patron et Youssef sont dans la logistique et entendent y rester. Leur victoire ? Celle d’avoir gagné la confiance des producteurs et des trafiquants tout en évitant les confrontations avec les uns et les autres.
« Une mécanique infernale invisible ». Qui permet de repérer les incorruptibles et de les éliminer, non physiquement mais en les contournant. Le cannabis à ce moment-là fait vivre plus d’un million de personnes et rapporte plus de 5 milliards de dirhams (500 milliards d’euros) au pays, une rente annuelle dont personne ne peut se passer. Les autorités ne sont pas en reste. Mais Le Patron est old-school. Il n’a posé qu’un seul véto : on ne sort pas du cannabis et on dézingue le moins possible. Quand il meurt et que Youssef reprend le flambeau, ce dernier applique à la lettre tout ce que son mentor lui a appris. La logistique de la dope imaginée par Youssef permet d’engranger tellement d’argent qu’ils ne savent bientôt plus comment faire pour blanchir les sommes recueillies. Il va bien falloir trouver une solution. Un nouvel acteur entre en scène : le cartel colombien qui rôde comme un vautour, aimanté par ce système de transport qu’il imagine parfait pour toute sa coke destinée au marché européen. Un saut dans le vide que Youssef hésite à franchir mais que Junior, le neveu du Patron, pousse comme un malade. La mort du tonton va précipiter le mouvement. Youssef va sortir des clous.
« Follow the money ». Bernard Petit connaît son sujet comme sa poche. Finis les petits joueurs du grand jeu et Welcome dans la cour des grands. Direction Marbella, porte d’entrée principale du sud de l’Espagne pour tout le cannabis européen. Soirées bling bling. Les grands fauves de la finance et de la criminalité se côtoient au vu et au su de tout le monde. On sort les cigares, les costumes sur mesure et les créatures de rêve. On est dans un entre-soi de pognon au nombre de zéro indécent. C’est là que Junior va sceller son destin et celui de cette entreprise si particulière. Il fait entrer dans la danse l’homme de main des cartels et le plus important : le banquier, Massimo Beneveto, directeur de la banque privée suisse Beneveto Frères, un amateur de montres Audemars Piguet. L’assurance-vie de montagne de pognon grâce à d’astucieux montages et de combines fiscales imparables au blanchiment d’argent mal acquis. Tout se passera désormais dans les salons feutrés suisses et non plus dans les villas tapageuses de la Costa del Sol. Problème. La dope n’est pas un terrain de gentlemen. Aux Pays-Bas voisin, un autre lascar entend dominer le marché européen. Pas de bonnes manières, l’animal. Du brut de décoffrage et une piqûre de rappel à toux ceux qui veulent s’en mettre plein les poches sans se salir comme Junior.
Trahison, empire et décadence, le roman de Bernard Petit se dévore. Mine de rien, l’auteur nous livre un petit cours d’histoire sur les débuts des flux et reflux du marché de la drogue sur le plan européen puis international. Il le fait de façon quasi clinique, sans pathos, ni personnages magnifiés. Pas besoin. Parce qu’il y a comme un vertige à constater l’étendue des dégâts, l’ingéniosité des trafiquants, la masse d’argent que cela génère et surtout la voracité avec laquelle les actifs participants de cette économie parallèle se jettent sur le gâteau. Le trafic de drogue repose sur un système capitaliste où la réussite passe autant par les diplômes que par une accumulation de transgressions de plus en plus violentes et où le bon vieux code d’honneur des truands d’antan a disparu. Englouti par une frénésie aussi addictive que la dope qu’ils vendent à une population en perte de repères. Toujours plus, jamais assez, la guerre américaine contre la drogue est une vaste rigolade. Trop d’argent en jeu, trop de demande. L’enrichissement personnel est devenu le nerf de la guerre, la vertu cardinale d’un mode de vie et de pensée bien compliqué à détricoter. Bernard Petit n’est pas là pour nous bercer d’illusions. Et il a bien raison.
« Le Nerf de la Guerre » de Bernard Petit, Éditions Fleuve Noir, 384 pages, 21.90 euros.