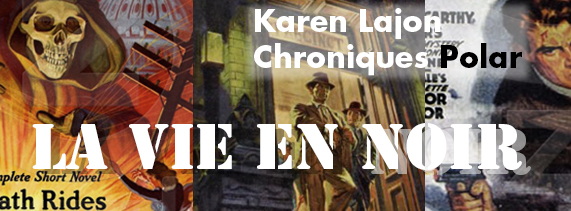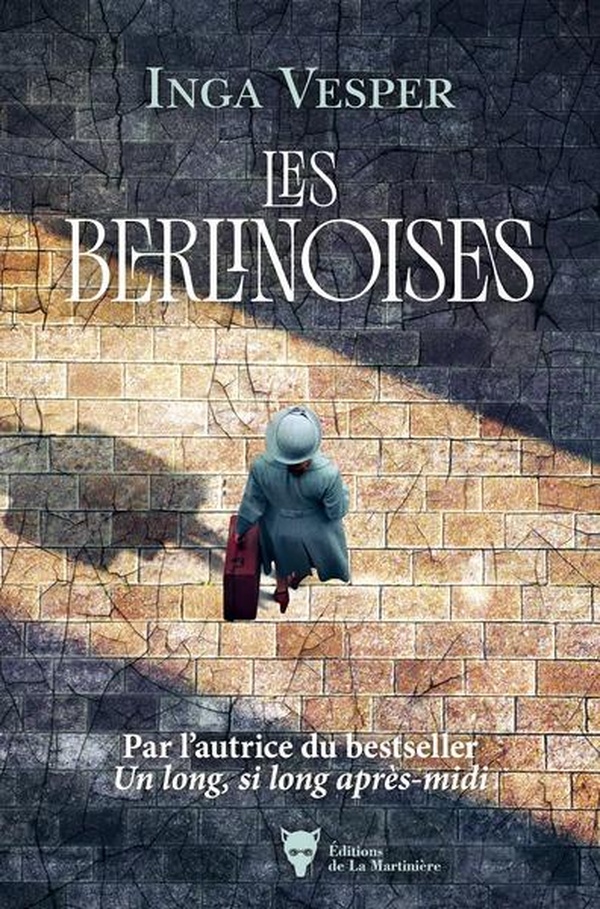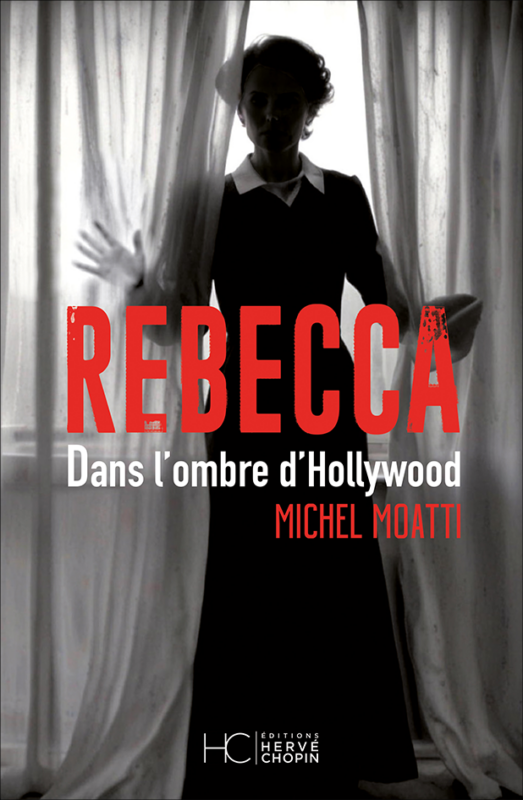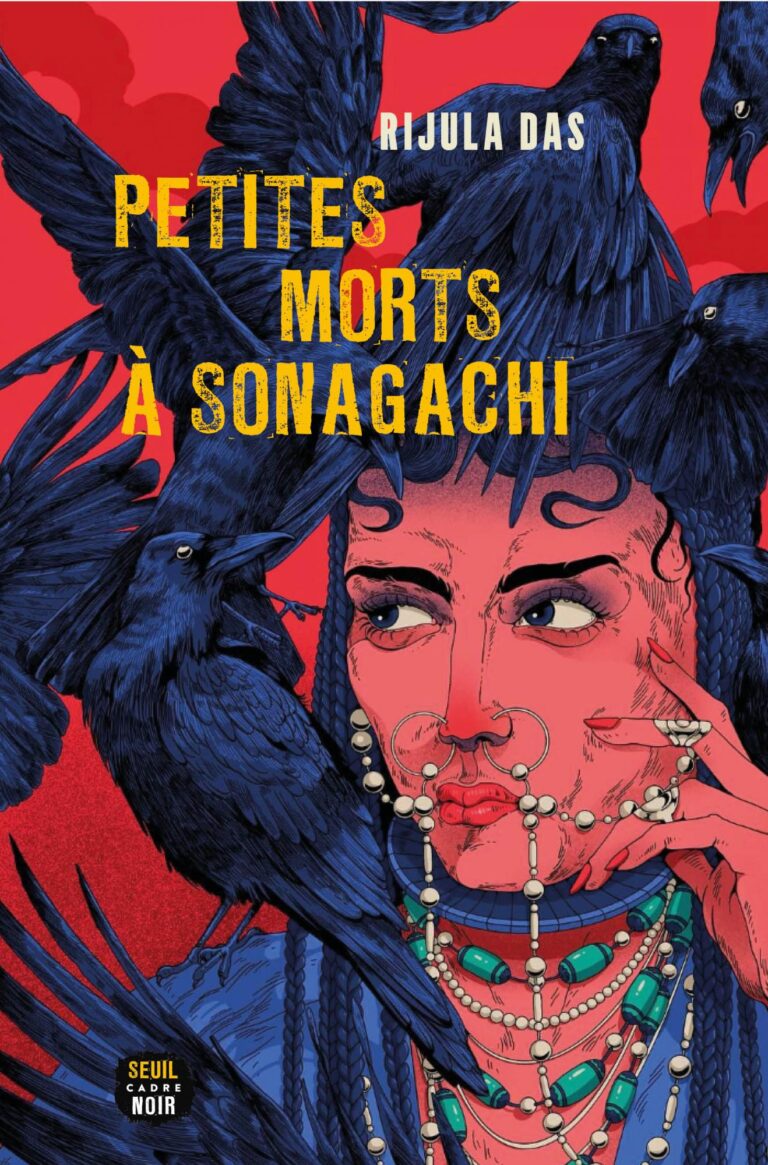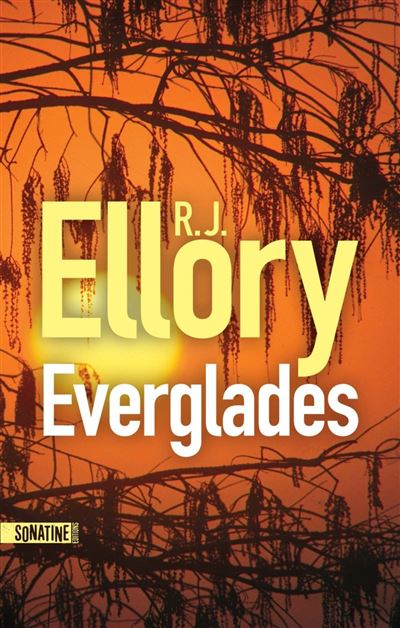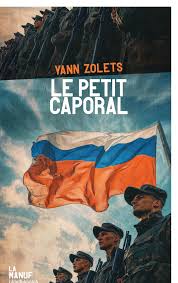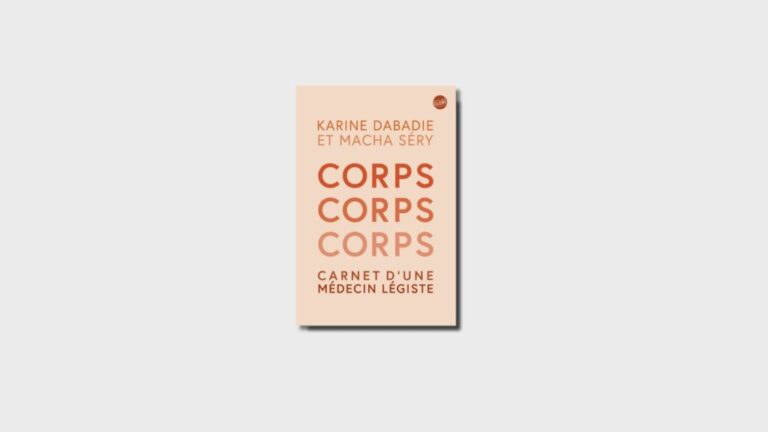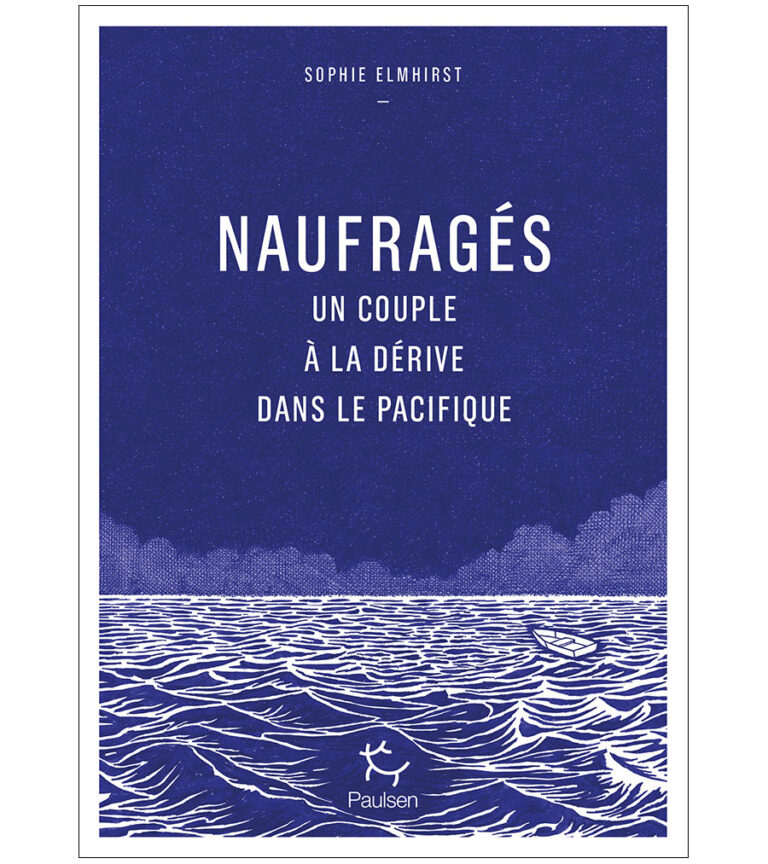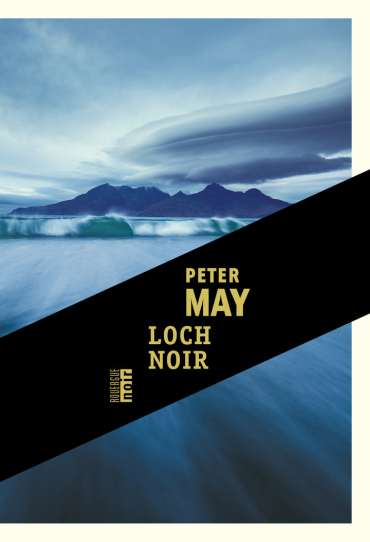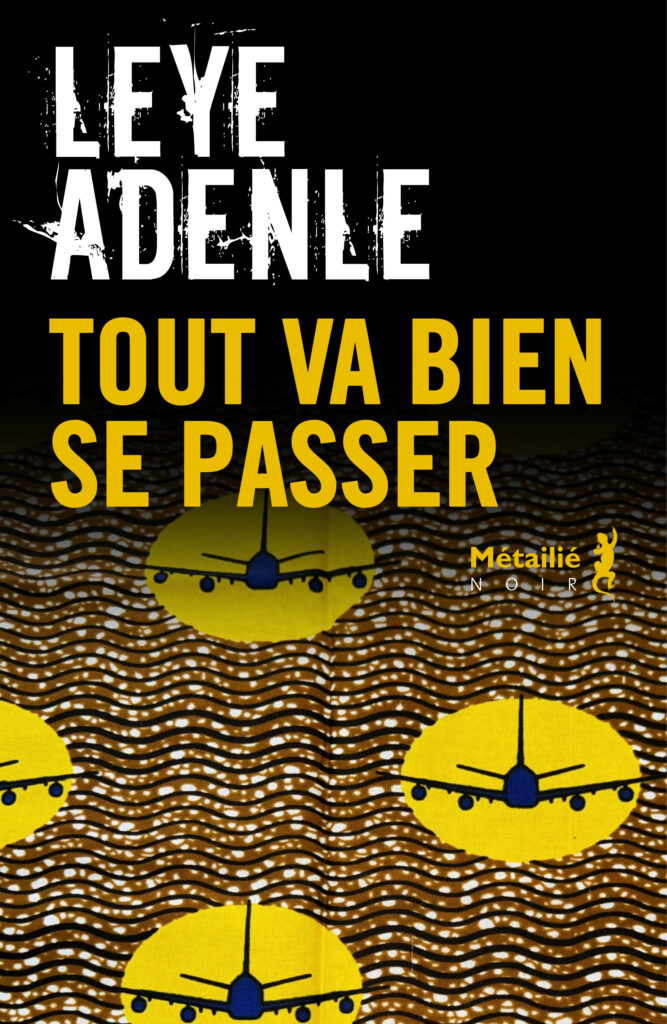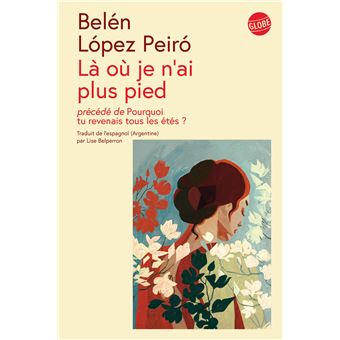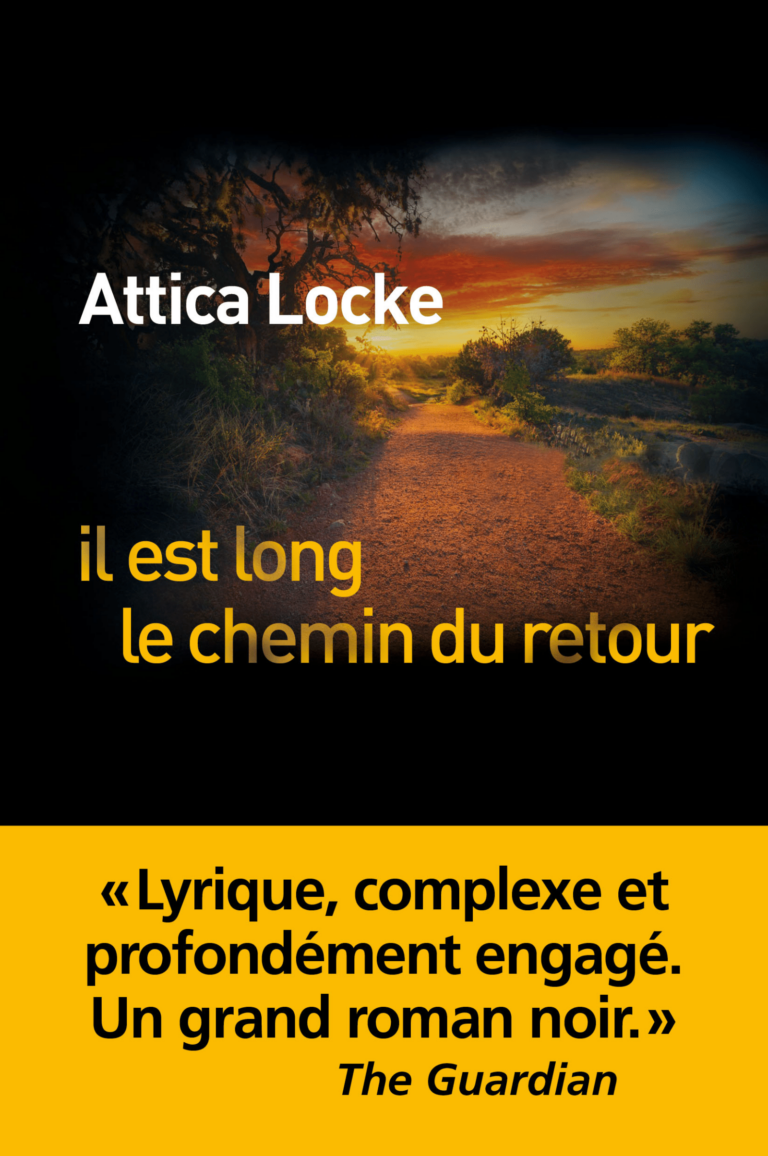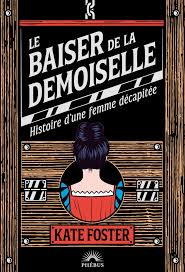Un roman sur le fil. Où la romancière oscille habilement entre souvenirs familiaux et imagination fertile. « Les Berlinoises » de Inga Vesper nous happe. Littéralement. L’écrivain Robert Goddard a été le premier à le dire. Il a raison.
Berlin, 1946. La chute, la défaite. L’Allemagne nazie est à genoux. Les Alliés se sont placés sur l’échiquier géopolitique à venir. Les Russes entrés les premiers et avec l’aval de Moscou, se sont déjà salement servis. Viols et vols, les Berlinoises les redoutent par-dessus tout. Les Américains jouent les good guys mais détestent ouvertement les Allemands. Ils ont un job à exécuter : dénazifier ce territoire pris d’une folie collective et sauvage. Vera sort justement de la caserne Roosevelt dans la zone d’occupation américaine de Berlin. Elle tient dans sa main son “certificat Persil” qui atteste qu’elle appartient à la Catégorie IV. ‘Qu’elle n’a été qu’une Suiviste du régime hitlérien. Le sergent le lui a dit. « Vous inquiétez pas, Madame Klug, vous étiez pas si mauvaise ». Atroce.
Elles sont sept. Sept femmes qui tentent de survivre dans une ville en ruines. Berlin est décrite sous toutes les coutures. Un personnage à part entière de ce roman haletant. Vera Klug est une ancienne actrice qui a eu son heure de gloire l’espace d’un malheureux film avant de disparaître dans les archives du système culturel nazi. Elle chante désormais pour les Yankees. Elle est le moteur de la maisonnée. Elle est en quête de rédemption. Pas ses camarades. Mais c’est le Nouvel An, les tensions seront pour plus tard lorsque Vera sera retrouvée morte, étranglée. Pour l’heure, elles sabrent… le lait de poule préparé avec de l’alcool dénaturé, des œufs reconstitués et autant de sucre. Infect. Mais tout est bon pour célébrer et surtout oublier. Que le froid mordille le corps jusque dans les maisons non chauffées, que la faim empêche de dormir, que le travail de nettoyage de la ville est harassant, pire, humiliant.
Le roman s’articule autour de trois personnages. Vera, mais aussi Rike et Billy. Le soldat Billy Keely tout droit sorti du Kentucky. Un nigaud qui attend tous les jours des lettres de sa Betty, la belle laissée là-bas au pays. Un nigaud raciste, empoté mais entêté. Qui a tué Vera et le sergent Coston, surnommé Le Lézard parce que quand il fumait, « il faisait glisser sa cigarette d’un coin de sa bouche à l’autre d’un coup de langue ». Il compte bien démasquer le ou les meurtriers. Il est le digne représentant d’un pays qui va remettre sur les rails une partie de cette nation dévoyée. « Soutenir la dénazification et la démocratisation de la zone occupée américaine ».
L’enquête le conduit dans cette maison où ces sept femmes ont trouvé refuge. Vera en était le poumon. Maintenant qu’elle a disparu, les couteaux sont tirés. Toutes ont quelque chose à se reprocher. Toutes ont été à minima complices tacites d’un régime barbare, et à maxima certaines ont même été actives. Tant que Vera était en vie, elles ont vécu dans l’illusion que le passé était derrière elle. Mais des hommes frappent à la porte. Et pas n’importe lesquels. Ernst Mückler, le mari disparu de Emmi et le redoutable Erich William Fischer, ex-Oberbefehlsleiter du Parti national-socialiste, section Berlin-Centre. Un gars qui pendant la période nazie en référait directement au Gauleiter Goebbels. Bizarre, les deux hommes ont l’air de bien se connaître. Les Sonderkommando, cela vous dit quelque chose ? Dans l’échelle des pourris, ils ont été Number one. Qu’allait faire Vera ? Les dénoncer ?
L’après-guerre est toujours une période de grands troubles. L’ordre passé fait place à l’anarchie. Une photo intrigue les protagonistes qui cherchent la vérité. Cela pourrait être la romancière qui elle-même, un jour, il y a bien longtemps, lorsqu’elle avait 14 ans, feuillette l’album de famille, et découvre sa grand-mère en tenue folklorique avec ses amies dans une clairière. Elles faisaient toutes le salut nazi. Ingrid interroge. « Grand-Mère, tu as été nazie » ? La réponse tombe, brutale, sous la forme d’un bruit sec. L’album que la grand-mère referme bruyamment. « Nous nous sommes bien amusés aussi, ce n’était pas si terrible ». Voilà de quoi parle le roman formidable de Inga Vesper. De la culpabilité, de la faute, la plus grande faute. Celle de nos parents et grands-parents. Et peut-être pire encore du tabou qui entoure le silence. Ne pas voir dit ou fait, ne pas avoir regardé. Avoir même été heureux. « Les Berlinoises » de Inga Vesper sont à l’image d’une partie de la population allemande empêtrée dans un passé impossible à refermer.
« Les Berlinoises » de Inga Vesper, traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Thomas Leclere, Éditions de La Martinière, 416 pages, 22,90 euros.a