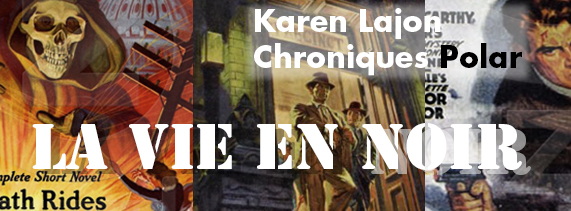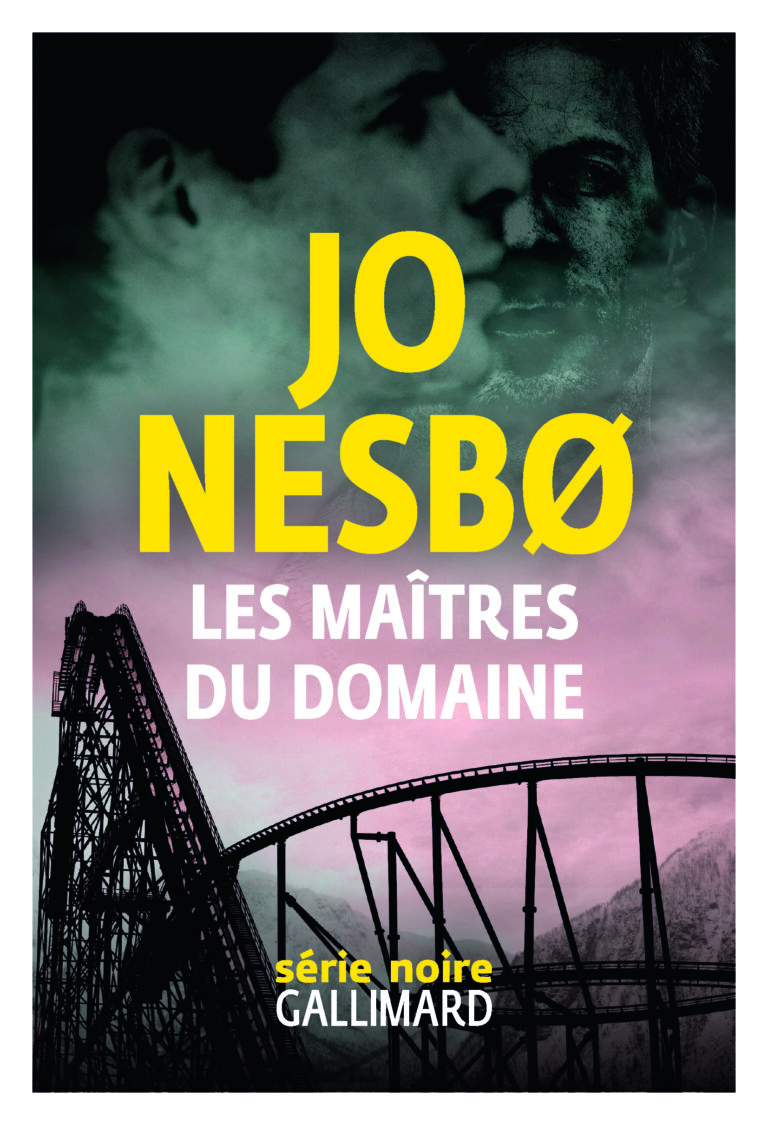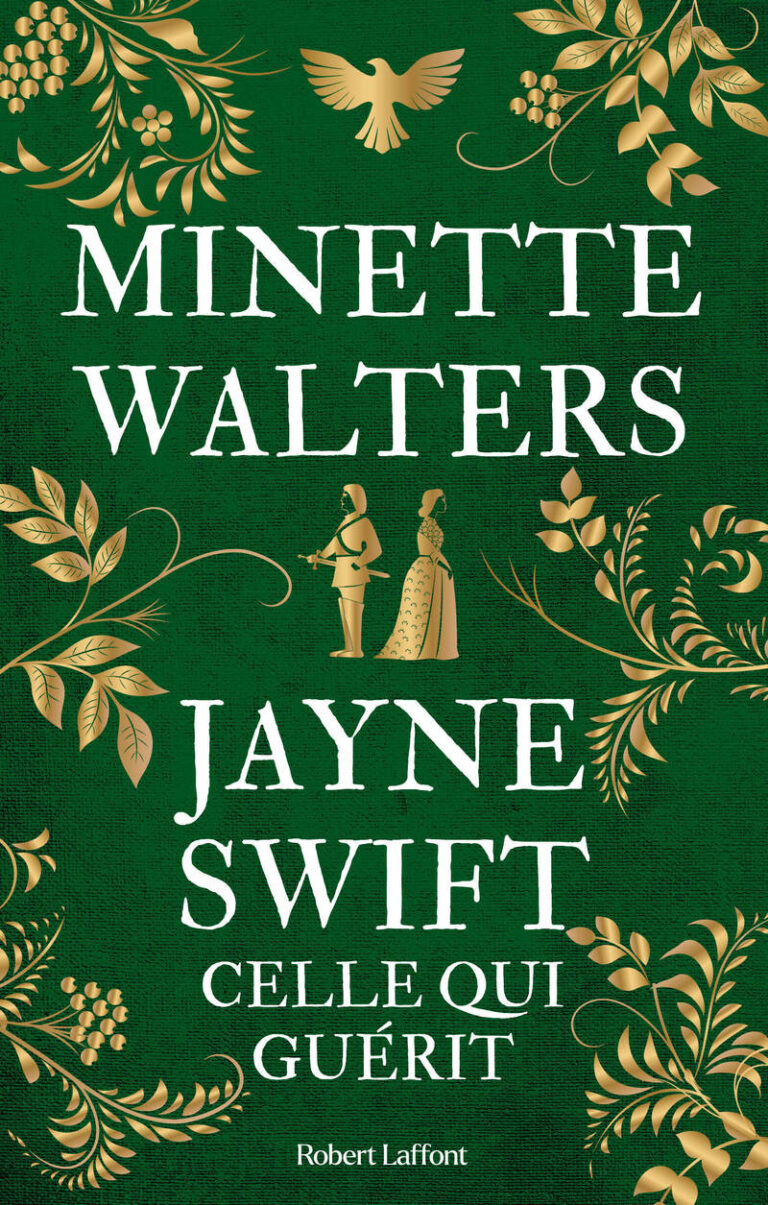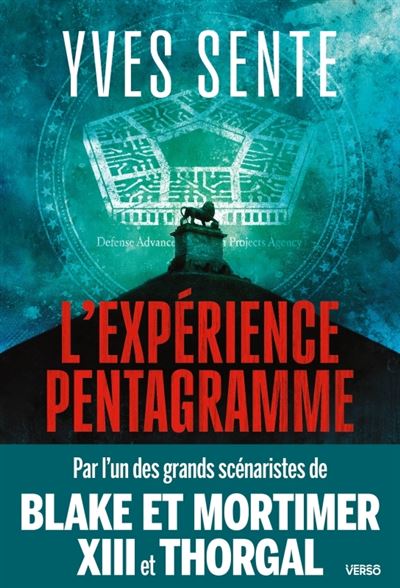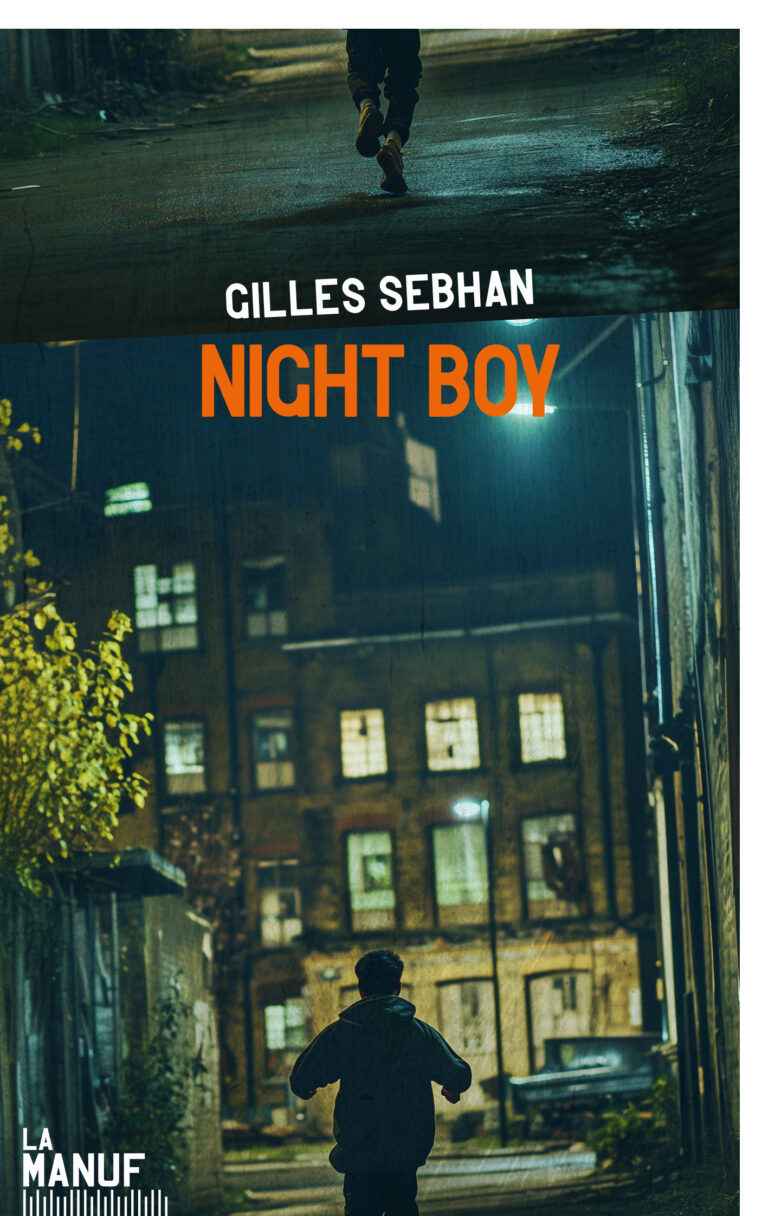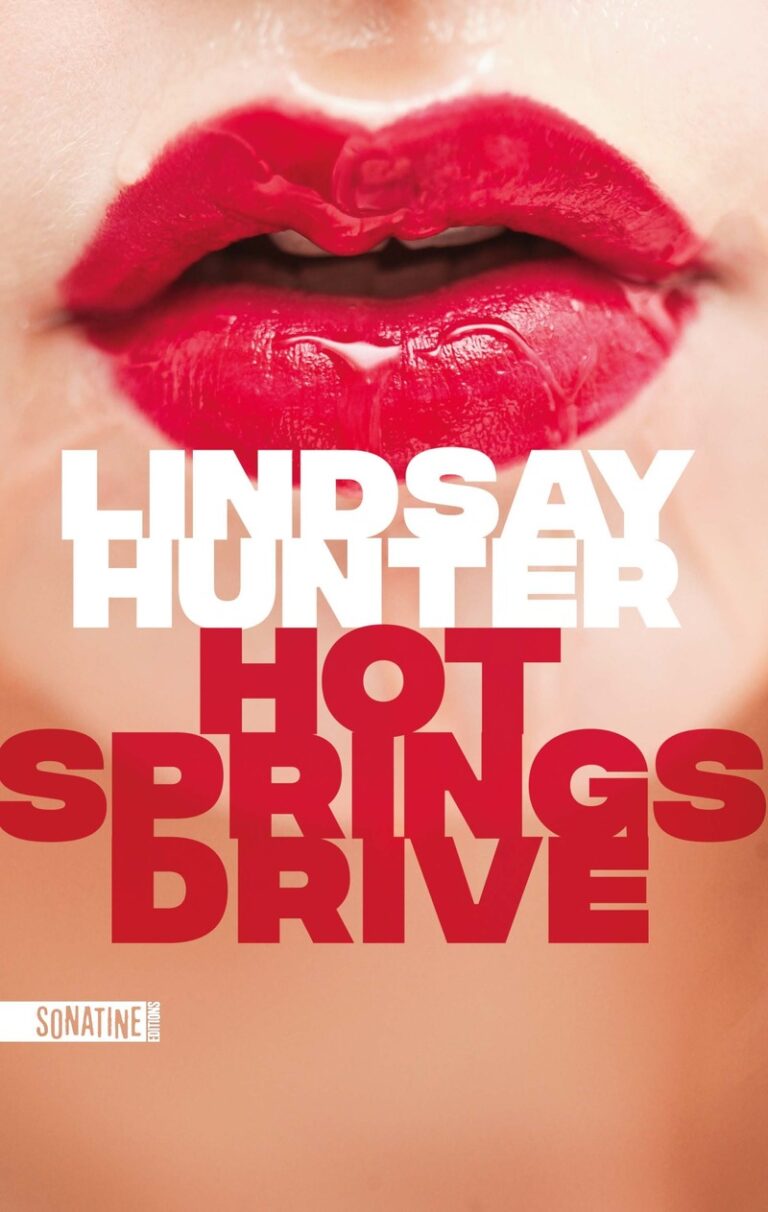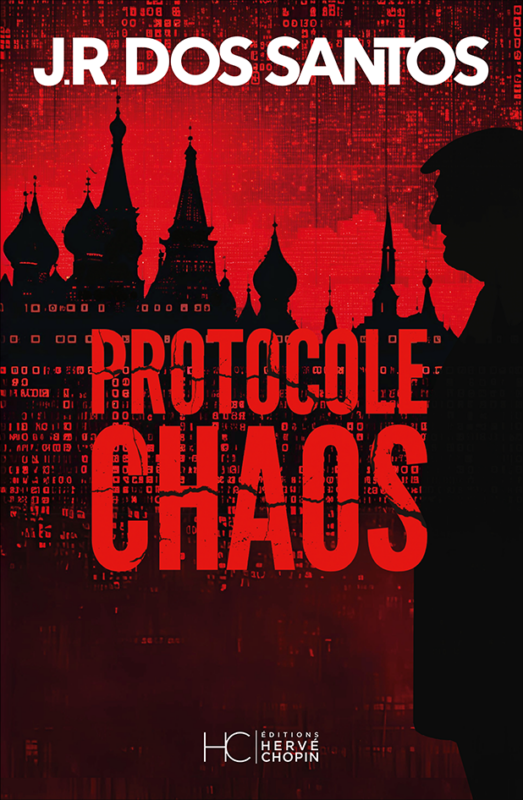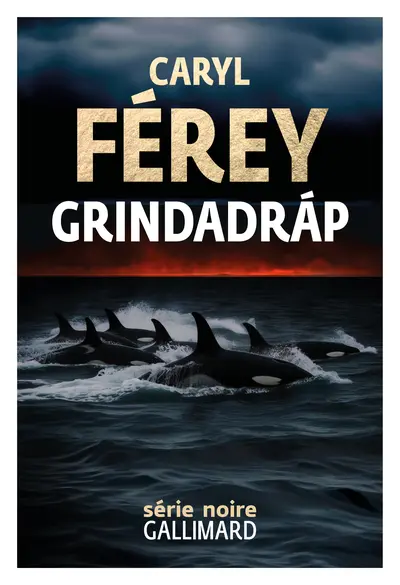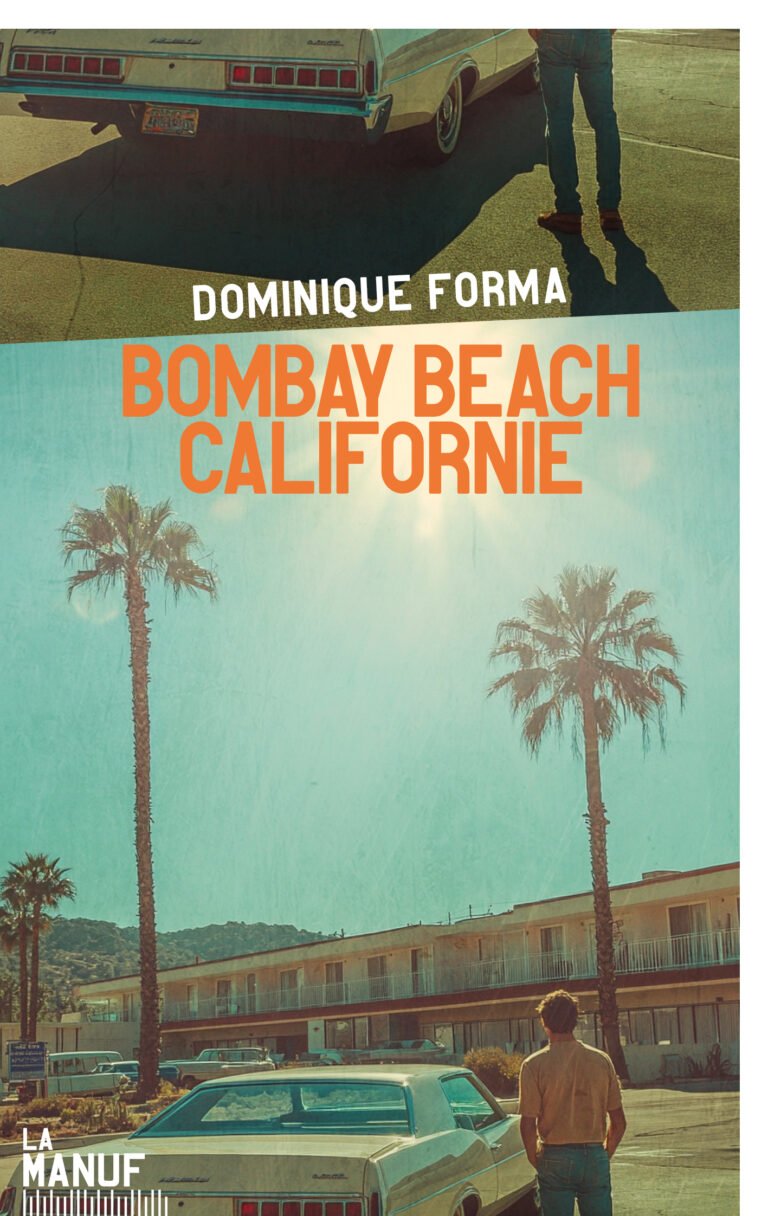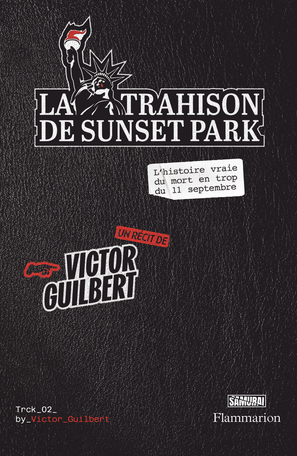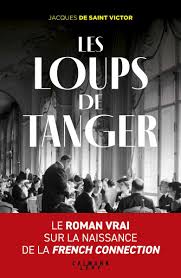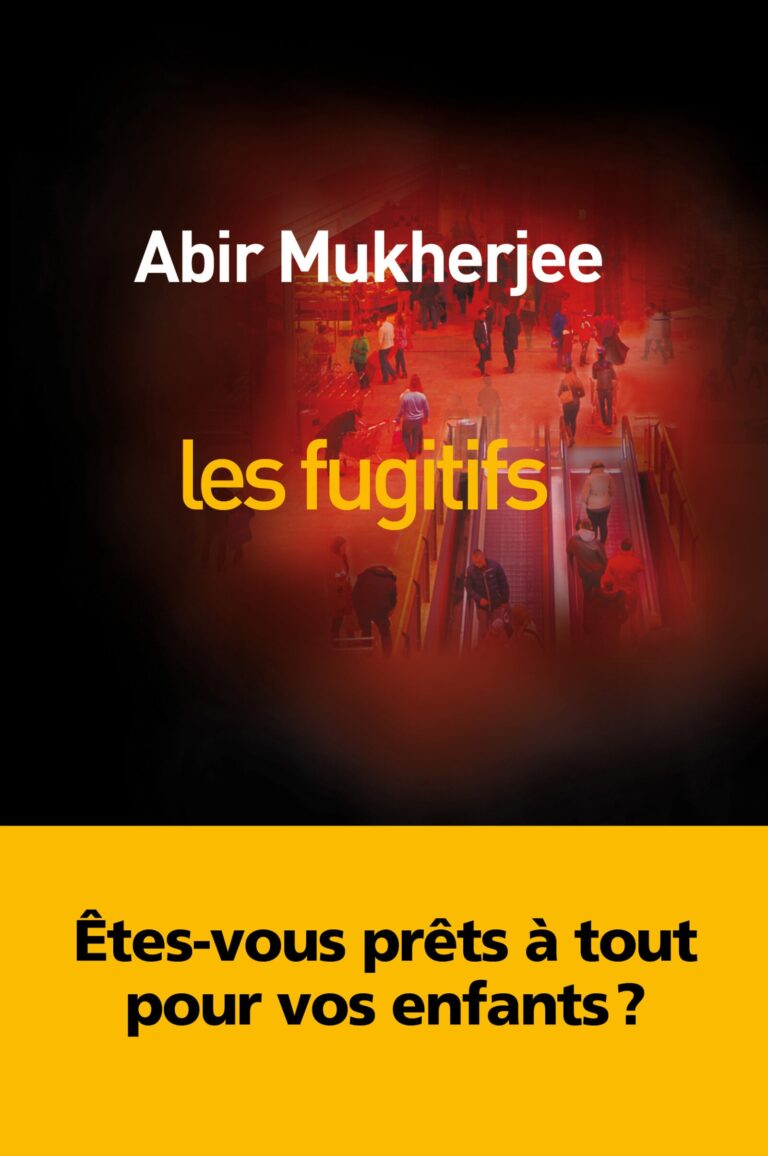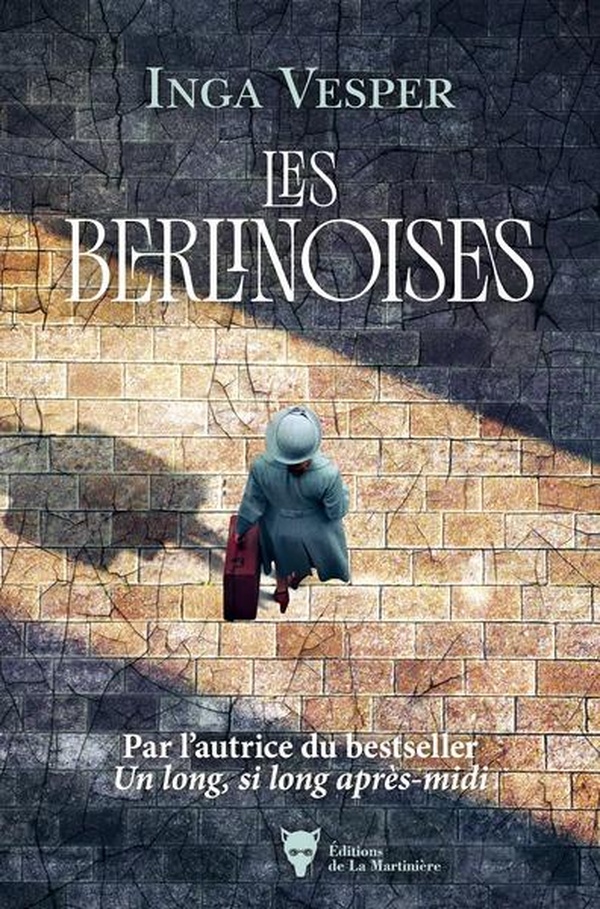Les frères Abel et Caïn version Dexter nordique. Jo Nesbø qui n’a plus que faire de la morale, donne une suite à « Leur Domaine » (2021) où l’on découvrait les deux frangins borderline, Roy et Carl Opgard. À cette époque, ils avaient encore toute notre sympathie. On peut excuser pas mal de choses à des mômes abusés par papa. Cette fois, le romancier norvégien noircit le trait et déclare ouverte, la guerre entre les frères. À nous de voir.
« N’importe qui peut-il devenir meurtrier ? » Roy, le plus jeune du duo, s’interroge faussement, alors qu’il est en route pour faire ce qu’il fait plutôt bien, zigouiller quelqu’un. En l’occurrence, grand seigneur, il donne un peu de temps à sa potentielle victime. En réalité, Roy connaît la réponse à cette question purement rhétorique, lui qui a déjà sept cadavres à son actif. Avec l’aide de Carl, parfois. La nonchalance du bonhomme, véritable porte-voix de l’auteur, est assez bluffante. « J’ai fini ma bière ». Pas de remords, pas de quête de rédemption dans ce deuxième volume, « Les Maîtres du Domaine ». La parole est aux crapules sans foi ni loi.
Non seulement, les Opgard ne se sont pas fait prendre, mais ils ont augmenté le volume de leurs affaires et étendu leurs pouvoirs. Désormais, ils ont un nouvel objectif : agrandir leur hôtel-spa et développer un parc d’attraction. On notera l’esprit grand enfant de Roy qui se passionne pour les joujoux qui font peur comme les montagnes russes. Mais un projet de tunnel menace d’isoler leur village et risque de mettre en péril leurs petites ambitions de propriétaires terriens, hommes d’affaires. Et le gars qui tient leur avenir dans ses mains, c’est le fameux géologue à qui Carl est allé rendre une visite lourde de sens. On est tenté de penser que Nesbø exagère, qu’il vit sur ses acquis, nous refourguer une suite, facile. Mais la maîtrise de la narration nous contredit. « Le soir précédent le jour où j’ai sonné chez Halden pour lui proposer douze millions de couronnes pour un faux rapport, j’étais en Pologne. Plus précisément à Zator, une ville d’environ quatre mille habitants, dans le Sud. Encore plus précisément, je me trouvais à Energylandia, un parc d’attractions, le plus grand du pays, et pour être parfaitement exact, dans un wagon tracté vers de sommet, de Zadra, le plus vaste circuit de montagnes en bois du monde ». La prise de distance vaguement cynique du romancier norvégien à nous raconter ce drame en mouvement est franchement à prendre en considération. La romance bien torchée n’est pas à la portée de tous.
Alors suivons Roy, le narrateur. Le maître-d ’œuvre de cette séquence. Le plus jeune mais le plus fûté. À la vie, à la mort, entre ces deux-là, voilà en gros l’idée que veut nous faire passer ce roublard de Nesbø. Pourtant, il y a déjà eu de sérieux coups de canif. Piquer la nana de son frère, par exemple. Énorme, non ? De l’eau a coulé sous les ponts, Roy qui jusqu’ici se tire de tout, pense aussi que son frère Carl n’a jamais rien su et maintenant que Shannon n’est plus de ce monde, tout ça est mort et enterré. Une autre femme, Natalie, aussi sublime et mystérieuse que la précédente, va venir perturber cet équilibre fragile et rappeler à Roy que la vengeance est un plat qui se mange froid. La mécanique de destruction de l’un par l’autre est en marche. Parce qu’il ne peut y avoir qu’un seul maître dans le royaume d’Os. Oui mais lequel ?
« Les Maîtres du Domaine » de Jo Nesbø, traduit du norvégien par Céline Romand-Monnier, Éditions Gallimard Série Noire, pages, 466 pages, 21 euros.