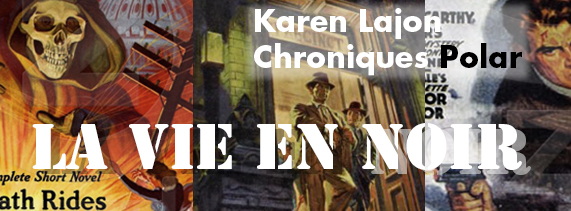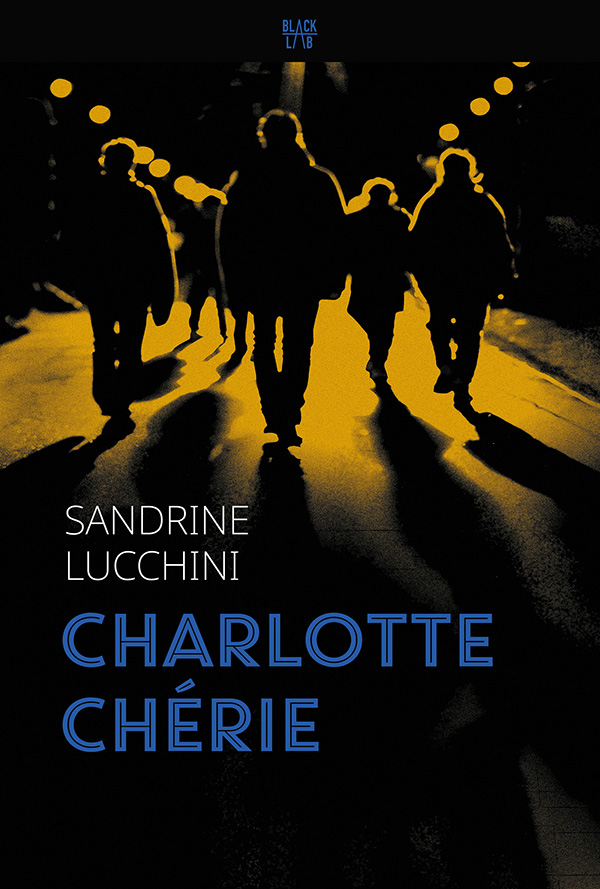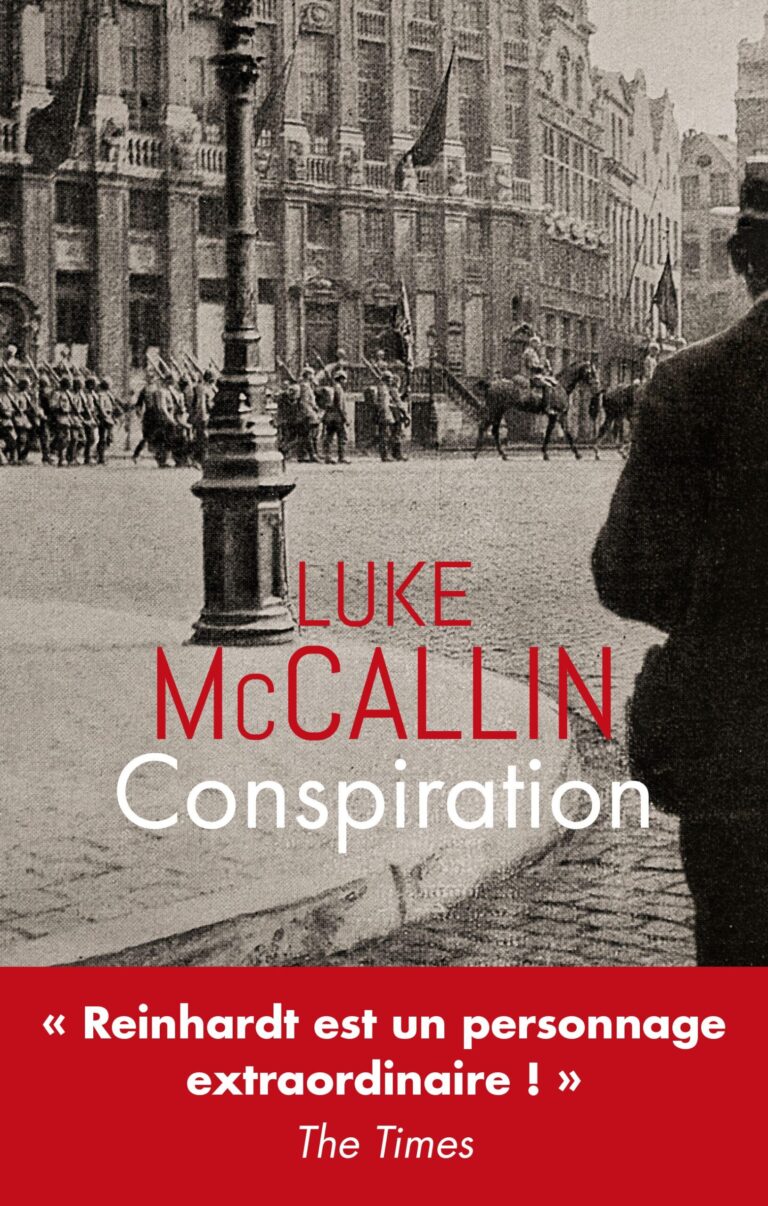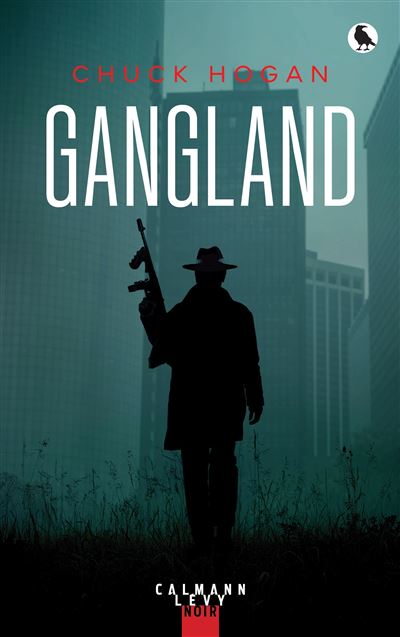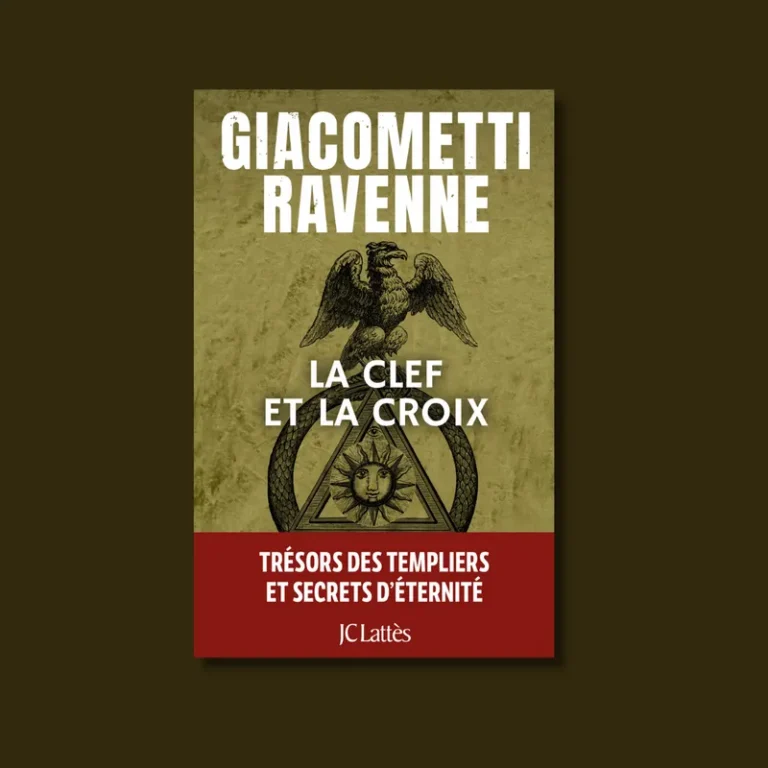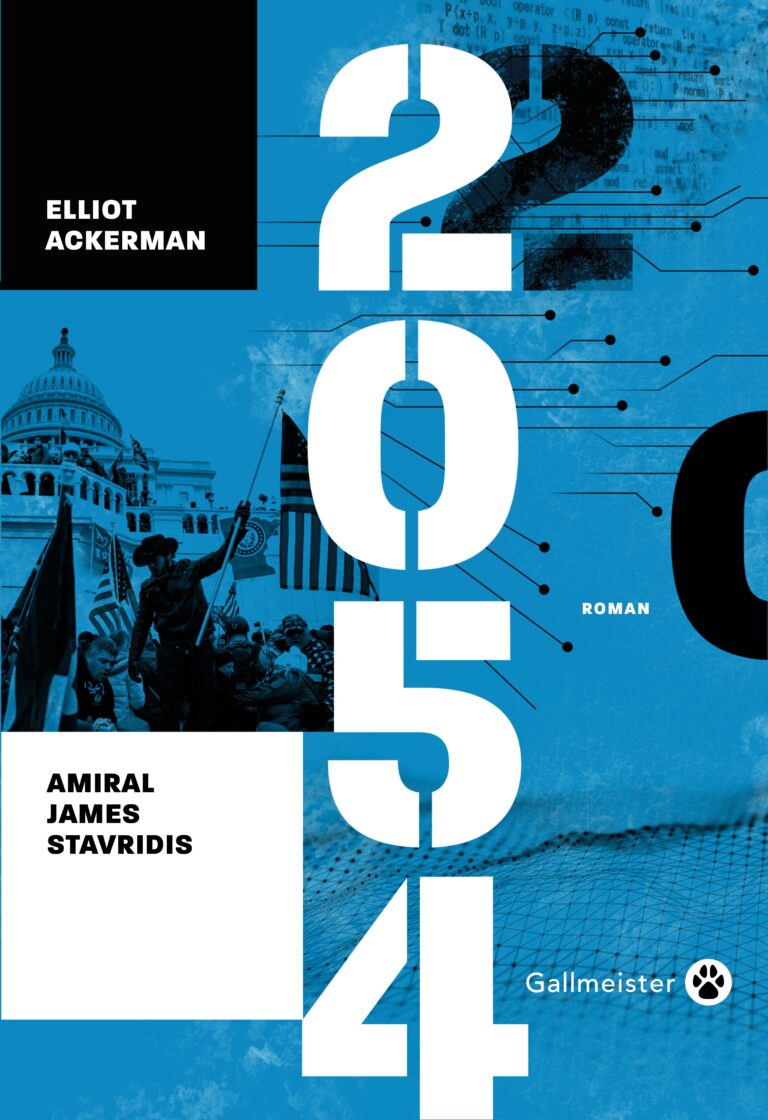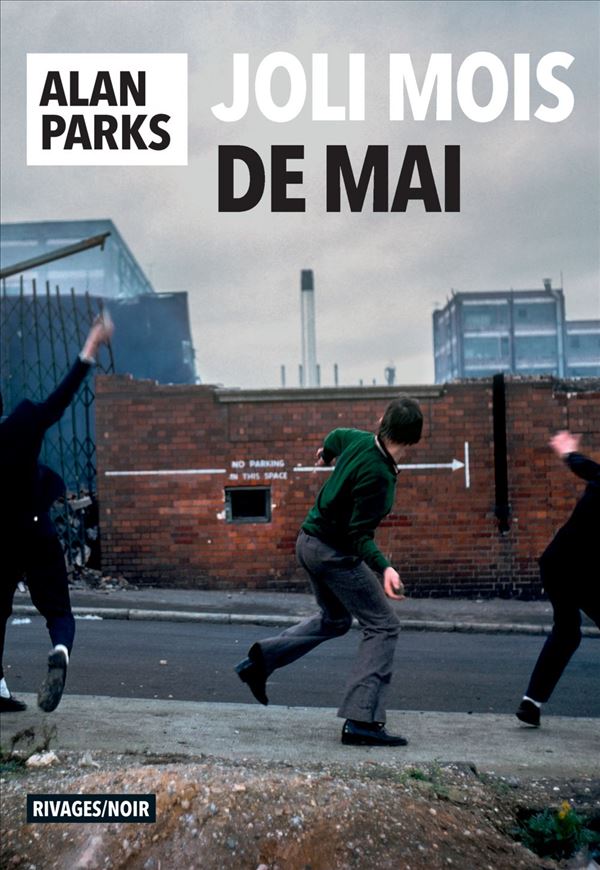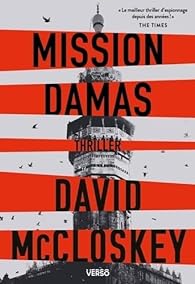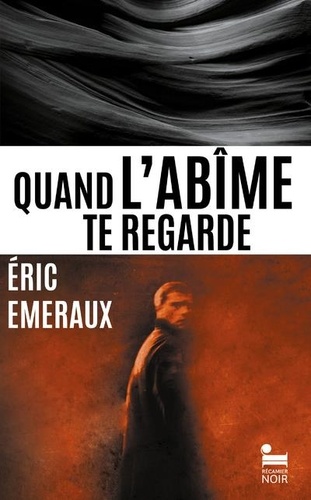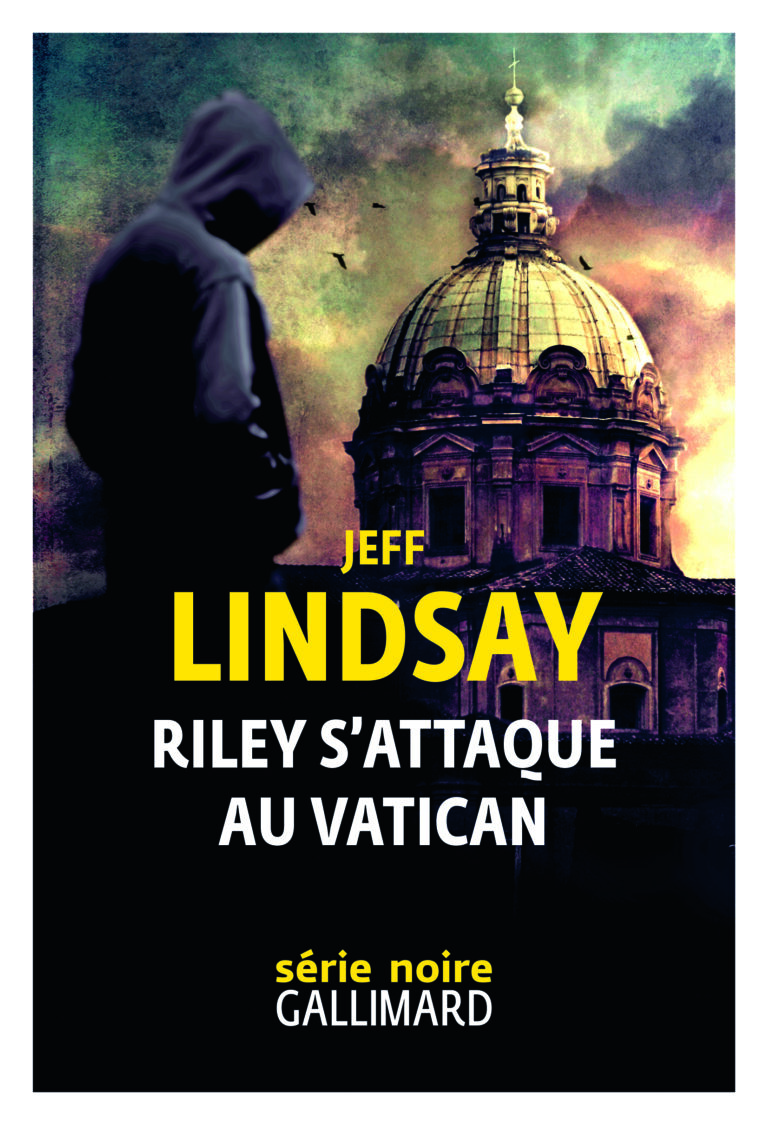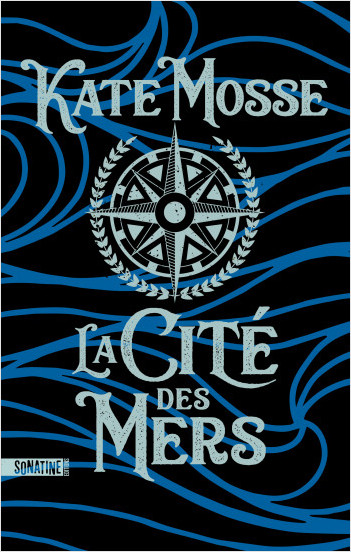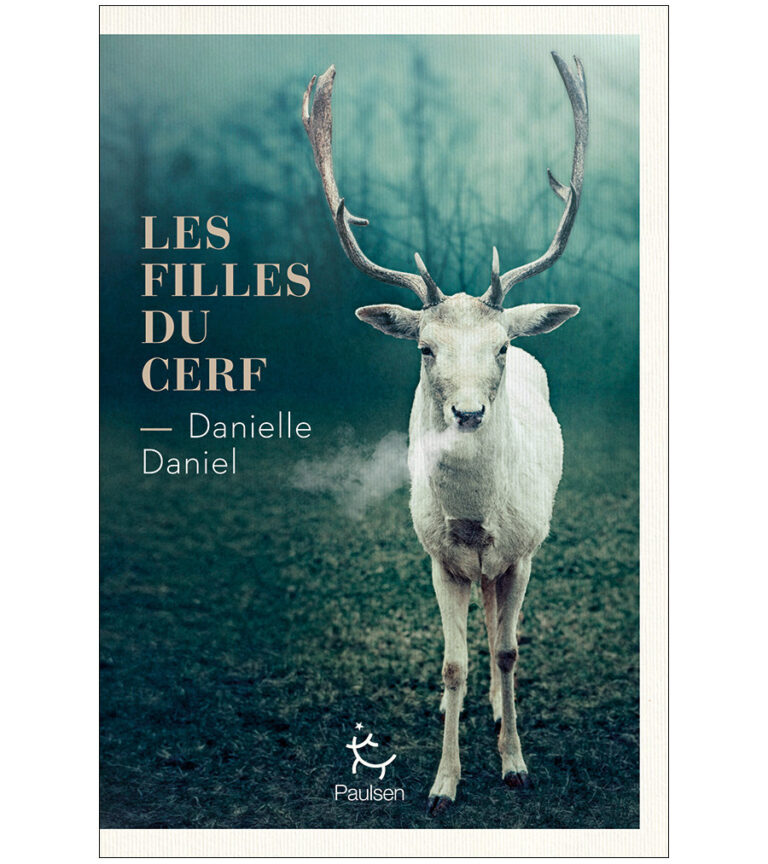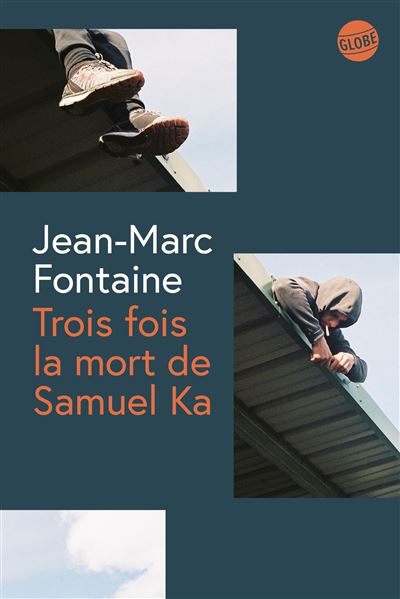Une disparition. Qui inquiète beaucoup Alice Lecoeur, officier de police du Xe arrondissement de Paris mais dont sa direction se moque totalement. En particulier, son chef de groupe, Toubois, homme de Neandertal, misogyne à souhait. Alice enrage et se tord le ventre. Elle connaît les symptômes. Ils lui parlent. Lui disent que cette disparition, c’est pas bon du tout. Au même moment, dans le quartier de Villiers, le corps d’une femme est retrouvé.
Charlotte Bacquet aurait désormais un visage et Alice aurait eu raison. Presque. Parce que le corps n’est malheureusement pas celui de cette Charlotte mais d’Elsa Jobin. Sa mort réveille néanmoins les gars de la Crim. Des images de la vidéosurveillance récupérées au Carrefour du coin ont montré deux hommes vêtus de treillis noirs, de rangers et cagoules, embarquer une femme vers un bâtiment en construction. On comprend que le premier chapitre n’était qu’un véritable contre-pied malin de la romancière Sandrine Lucchini, un leurre lancé à la compréhension du lecteur qui s’était trop vite imaginé encore une fois embarqué dans une énième histoire de dingos sadiques s’en prenant à la gent féminine.
La révolte des mâles a commencé. « Il est temps que le monde comprenne que les femmes sont les esclaves du viol au service des hommes. » Pute, salope, les insultes fusent. Femelle revient aussi beaucoup. Un vocabulaire qu’un cadre de Daech aurait tout à fait pu rédiger. C’est dire. Les mâles de nos sociétés soi-disant civilisées n’ont donc rien à leur envier. Regroupés au sein d’une galaxie digitale opaque qu’on appelle manosphère et qui vient des États-Unis, des messieurs clairement agités, souvent des « incels » des célibataires frustrés, s’en prennent violemment aux femmes sous forme de harcèlement cybernétique. On les appelle aussi les masculinistes. Dans ce deuxième roman, Sandrine Lucchini en profite pour nous faire un petit round-up instructif sur les phénomènes de cette catégorie poids-lourd. À Montréal en 1989, quatorze femmes sont tuées, Isla Vista en Californie en 2014, Canada encore une fois avec huit cadavres ou encore Plymouth en Grande-Bretagne avec cinq femmes abattues dont la propre mère du meurtrier. Mais un détail chagrine néanmoins le capitaine Hippolyte Léon. Le modus operandi ne colle pas du tout avec les « incels ». En général, ils passent de la tuerie de masse au suicide. Or, il y a un meurtre et une disparition. Y aurait-il deux criminels ? Avec un mobile commun, la haine des femmes, mais un mode opératoire différent. Lebon décide de faire appel au psycho criminologue Martin Muller.
Présentons ces lascars à la dérive. Sans grande finesse, l’un se prénomme Stalker, harceleur en Anglais et l’autre Slayer pour tueur. Ils ont vu la lumière au bout de leur propre tunnel de souffrance le jour où ils ont rencontré un homme qui se fait appeler Le Padre. Ils ont prêté serment. Sont passés du virtuel à la réalité et leur vie a pris un sens obscur et violent. Ils portent une chevalière sur laquelle est gravée une orchidée, une fleur associée à la virilité. À quel moment ces hommes ont-ils croisé le chemin d’Alice et de Charlotte ? Quel est leur point commun ? Un psychiatre. Marc Seigneur, fondateur de L’Odyssée Nouvelle, une association à l’extrême-droite de l’extrême-droite. Un rescapé d’une enfance perturbée qui perçoit les femmes comme un danger ultime et absolu.
Sandrine Lucchini est aussi scénariste. Elle a choisi de développer son intrigue sur des chapitres très courts et qui ne traînent pas. Ce qui n’est pas plus mal. Le monde des masculinistes qu’elle décrit est suffisamment vertigineux et déprimant. On se pose quand même la question : à quel moment les rapports homme/ femmes ont-ils déraillé au point de donner naissance à une espèce d’individus masculins dont l’épanouissement personnel passe désormais par la crucifixion du genre féminin sur l’autel d’une virilité morbide.
« Charlotte Chérie » de Sandrine Lucchini, Éditions Black Lab, 284 pages, 21,90 euros.