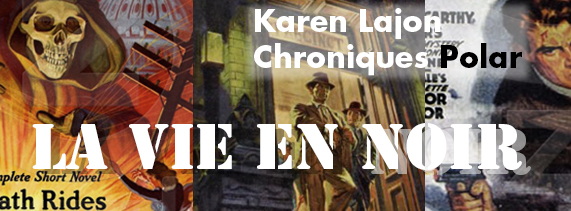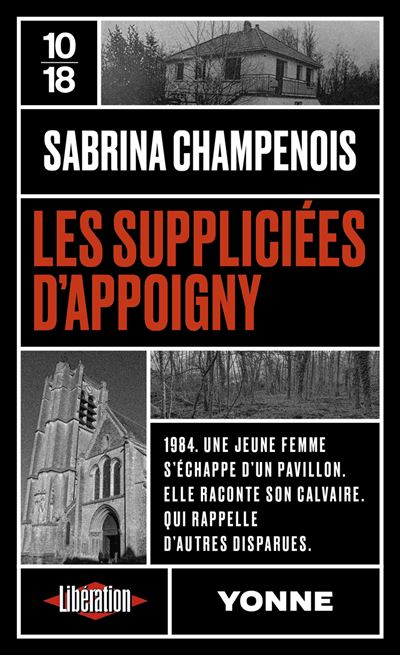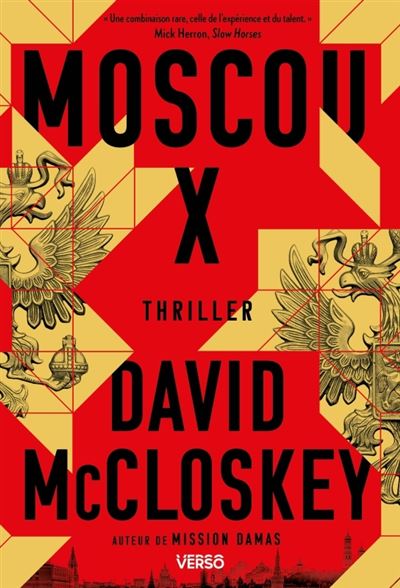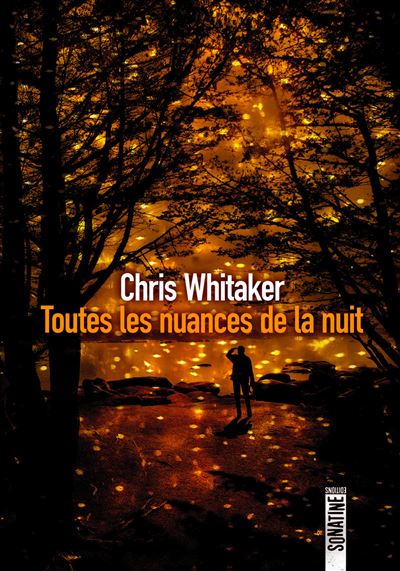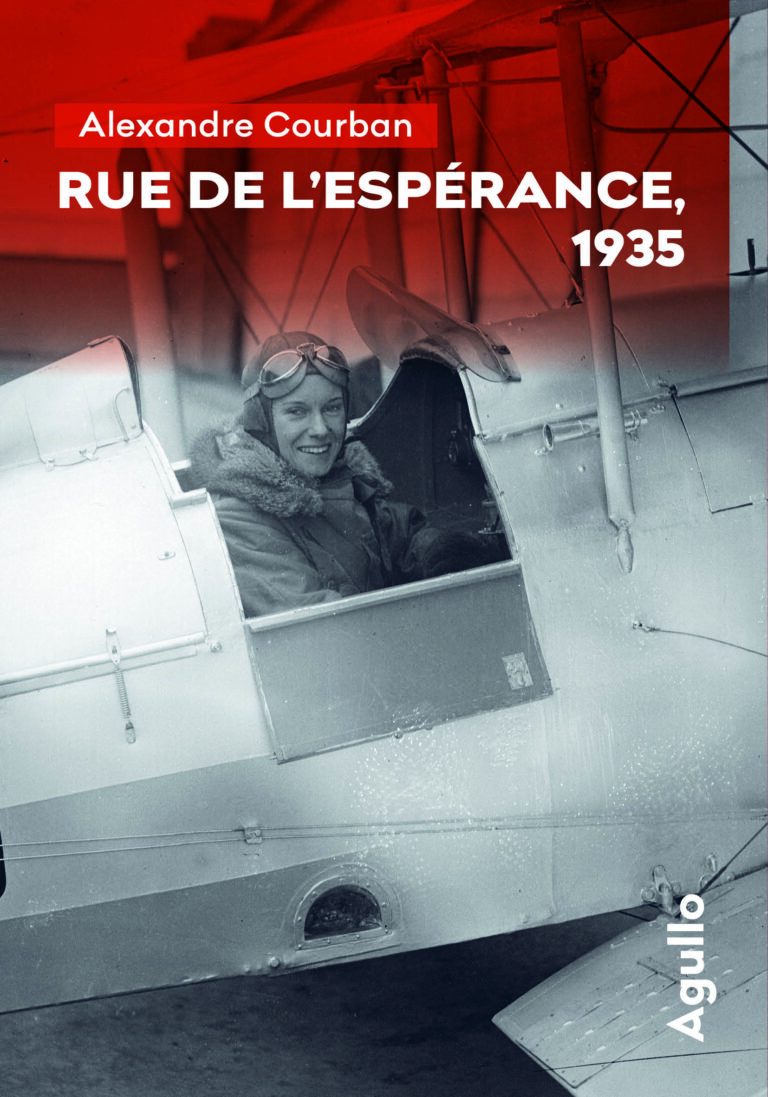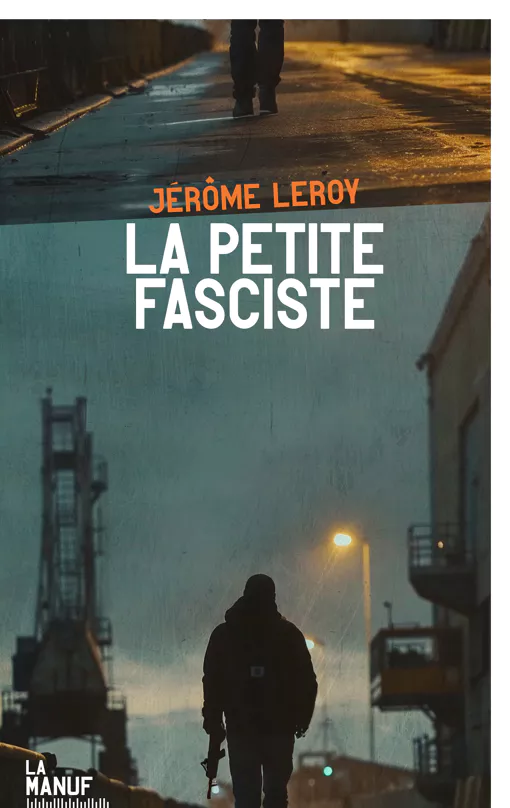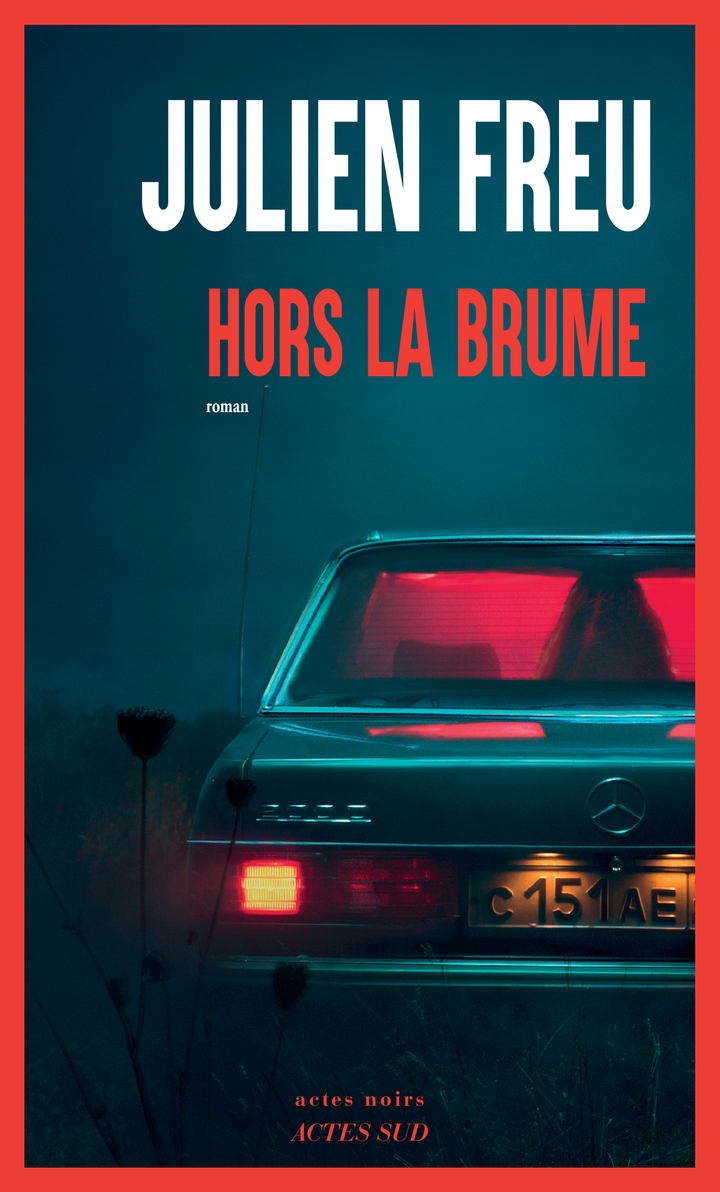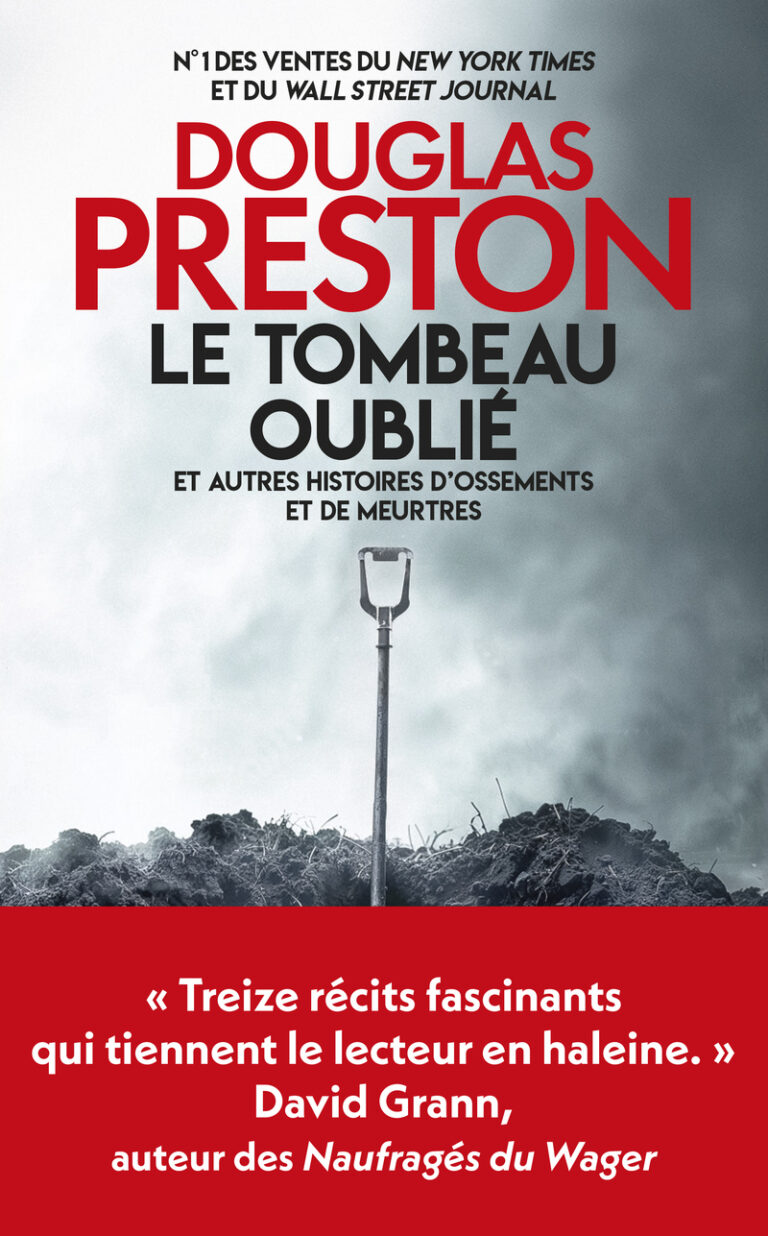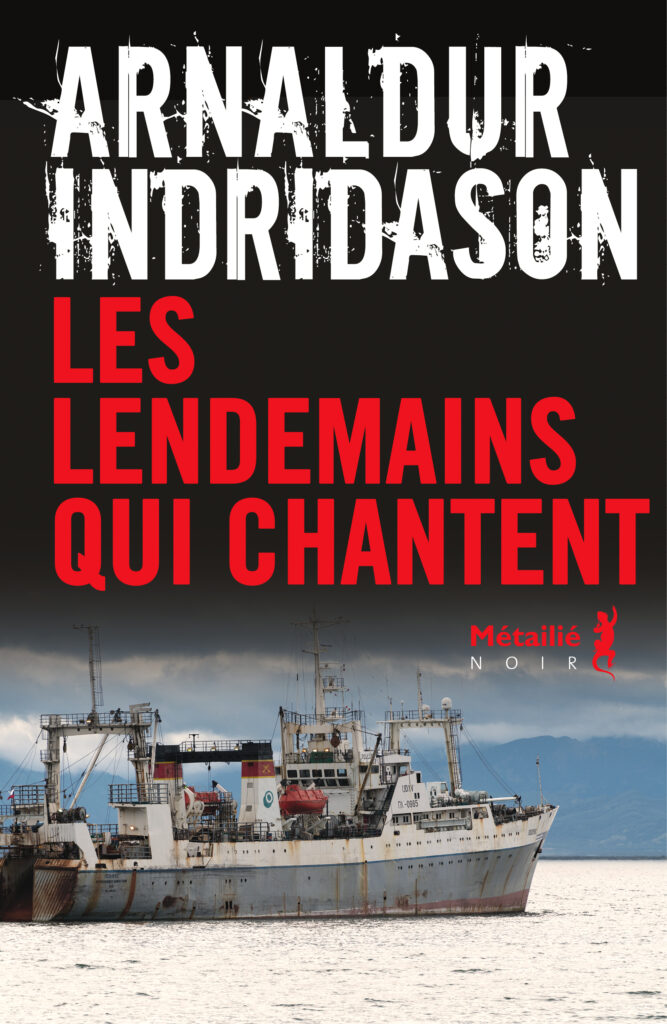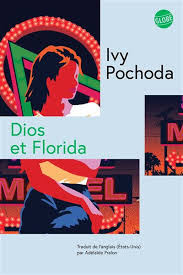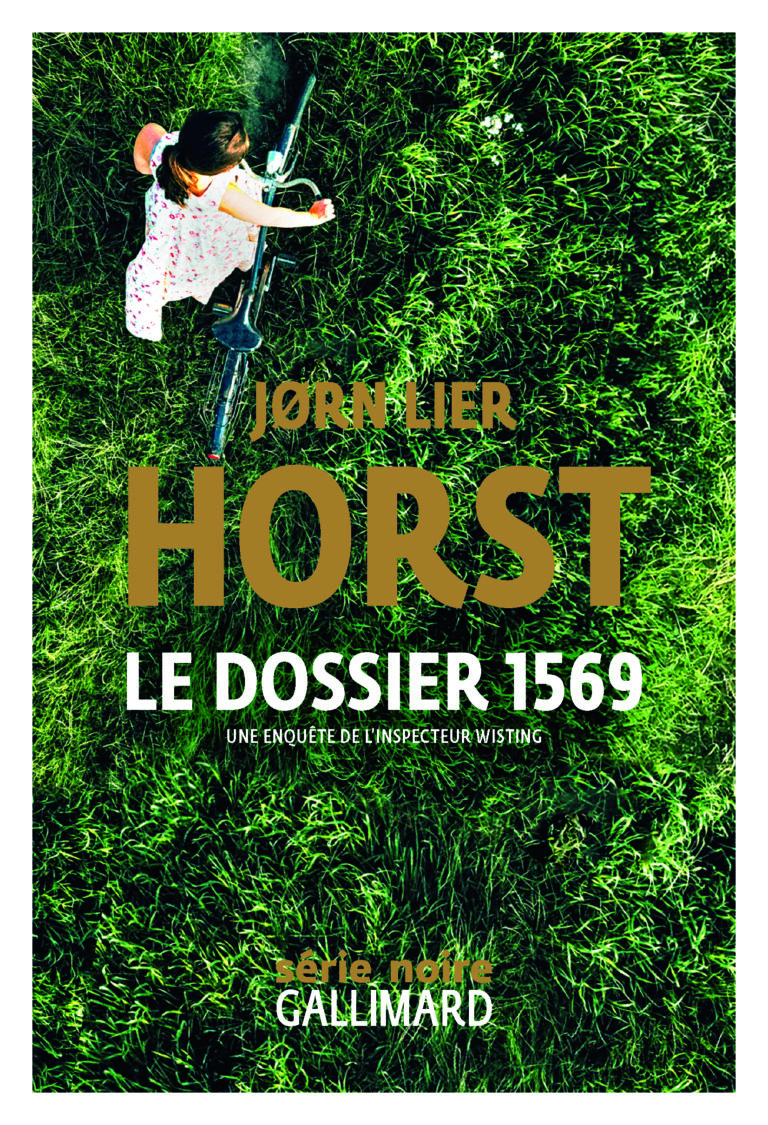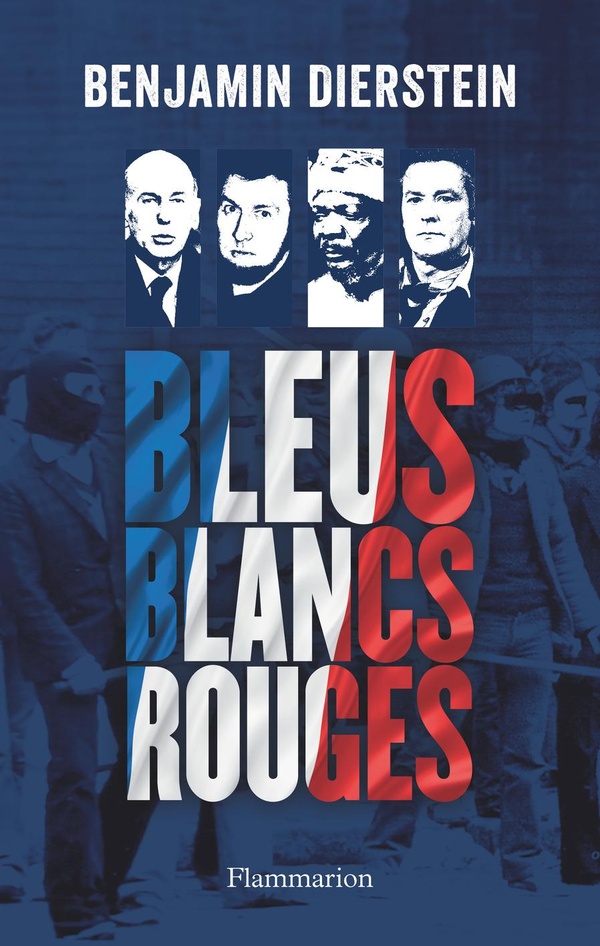Il se passe toujours plein de choses dans les villages. Pas forcément sympathiques. Voire sordides. Comme l’affaire des « Suppliciées d’Appoigny » que nous raconte Sabrina Champenois. Après avoir traité précédemment de quelques grands dossiers froids outre-Atlantique, la collection True Crime 10/18, en collaboration avec Libération, s’intéresse, cette fois, aux faits-divers français. Et c’est la journaliste du quotidien qui ouvre le bal printanier de cette farandole macabre.
1984. Nous sommes dans l’Yonne, la région de Guy Roux, le chouchou, l’entraîneur de l’AJ Auxerre. Celui qui a eu la chance de voir évoluer Djibril Cissé et surtout Éric Cantona sur ses terrains. De la graine de stars. Claude et Monique Dunand vont accéder à une relative notoriété d’un autre genre. Beaucoup moins sexy. Même si tout commence justement par des jeunes filles. Huguette a 18 ans, elle vient de la DDASS. « Elle est un fétu, écrit Sabrina Champenois, elle n’a pas de formation particulière, pas d’appuis, pas de moyens, pas de projets ». Elle est la proie idéale. Les prédateurs savent les repérer. Le couple passe une annonce dans la presse locale. Un miracle pour Huguette qui a dû quitter son foyer parce qu’elle a atteint sa majorité. Elle sera nourrie, logée et s’occupera d’un handicapé. L’affaire est rondement menée, un seul rendez-vous dans un café d’Auxerre et c’est plié. Il n’y a aucune fioritures chez le couple Dunand. Dès son arrivée, Huguette qui croyait avoir son petit logement personnel, atterrit à la cave. La suite est un cauchemar. Tortures, viols et pâté pour chiens en guise de nourriture. Il y a de la complicité dans l’air. Elle est tellement abîmée qu’un généraliste vient l’ausculter. Le verdict est sans appel : « Elle ne sert plus à rien ». Il y aura une deuxième victime. Michaëlla ne pourra pas s’échapper.
1991. L’instruction dure sept ans. Le procès Mazan n’a pas encore eut lieu. Le huis clos est évident. « Raconter leur calvaire au vu et au su de tout le monde leur est impossible, la perspective du procès les hante depuis des mois. Se retrouver face aux Dunand, replonger dans les abysses, revivre ces jours et ces nuits où toute dignité leur a été niée, est un cauchemar ». Normalement, c’est une affaire sans mauvaise surprise, Claude Dunand risque la perpétuité. Cette façon qu’il a de décrire la routine de son quotidien de l’époque va dans ce sens : « Oh, toujours la même chose. Les fouets, les épingles, le tournevis, le transformateur… » Peu de chances d’émouvoir le tribunal. S’il accepte de plaider coupable, c’est pour mieux en rejeter la faute sur Monique. Ce serait elle, l’instigatrice de toute cette folie. Il n’est lui-même qu’une victime. Il ne convainc pas grand monde et prend la réclusion à vie. Logique.
Pourtant, seize ans plus tard (avec la préventive), il est dehors. Claude Dunand bénéficie de la toute nouvelle loi sur la présomption d’innocence, qui lui permet de faire appel de sa condamnation. Son côté prisonnier modèle, le fait qu’il ait soixante-dix ans et qu’il se soit amendé ont plaidé en sa faveur. Comme l’écrit la journaliste, « la libération de Dunand ne choque que ses victimes. » D’autant que la presse nationale a braqué ses projecteurs sur une autre affaire, celle de Émile Louis, le brave monsieur chauffeur de car qui avoue sept meurtres d’handicapés avant de se rétracter. Si les deux affaires ne se rejoignent pas, elles ont des similitudes administratives : « Le parquet d’Auxerre a été dans les deux cas d’une remarquable désinvolture, au minimum ». Ce genre de fait-divers est propice à toutes les rumeurs et toutes les théories du complot. On parle d’un petit carnet noir, de gens hauts placés qui auraient été des visiteurs réguliers du sous-sol de chez les Dunand. C’est d’autant plus facile d’élaborer ce genre de théories que l’un des grands noms politiques de l’époque dans la région de l’Yonne est Jean-Pierre Soisson, et « qu’il intercède en 1990 auprès de son collègue garde des Sceaux, Arpaillange, en faveur de la remise en liberté conditionnelle de Dunand ». De quoi emballer l’imagination.
Et Dunand dans tout ça ? Il est mort de sa belle mort dans son lit. Il s’était même payé le luxe de se remarier – sa dernière femme mourra dans des conditions douteuses-. Il n’a jamais rien ajouter à ce qu’il avait avoué à son procès. Huguette et Michaëlla ont continué à vivre. Ou plutôt à survivre. Leur drame n’a pas particulièrement ému. Elles ont été les dégâts collatéraux d’une justice bordélique et sans âme. Et d’une indifférence de la société.
« Les Suppliciées d’Appoigny » de Sabrina Champenois, Éditions 10/18, Libération, 208 pages, 8.30 euros.