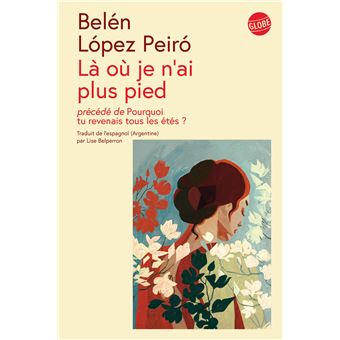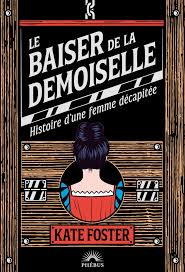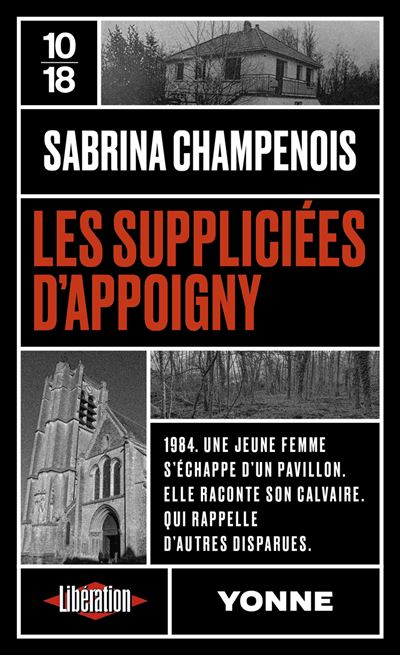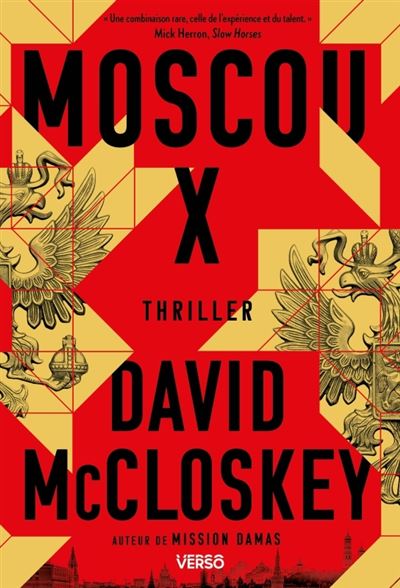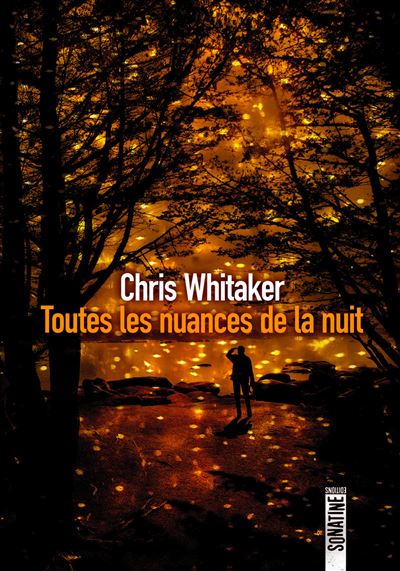L’examen de conscience viendrait-il avec l’âge ? Forcément un peu, quand le fameux sentiment d’immortalité qui caractérise la jeunesse s’est émoussé au fil des années écoulées. Carrément, lorsque son propre enfant est accusé d’avoir commis l’irréparable et qu’une jeune fille en est morte. Le dernier roman de Peter May, dans lequel on retrouve le héros de ses débuts, Fin Macleod, évoque cet état d’esprit si particulier alors que la tragédie a frappé. Mélancolique et fragile comme un vieil homme qui marche au bord de la falaise.
Le décor est toujours là. Splendide, marin, pluvieux et venté. Des Hauts de Hurlevent malmenés par des éléments ingouvernables. Une nature omniprésente dans l’œuvre de cet auteur écossais qui a élu domicile dans l’hexagone. Nous sommes sur l’île de Lewis. Nous sommes là où tout a commencé pour Fin Macleod. Et où tout semble s’achever pour son fils, Fionnlagh, celui qu’il a eu avec Marsaili. Ce dernier est accusé d’avoir tué Caitlyn Black, jeune femme de 18 ans, téméraire amoureuse de son professeur… le fils de Fin. La nouvelle est doublement tragique.
Fin n’est plus policier mais comme le lui rappelle Marsaili, inspecteur d’un jour, inspecteur toujours. S’il n’enquête pas pour son propre enfant, pour qui le ferait-il? Alors lui et sa femme quittent la terre ferme écossaise pour cette île qu’ils pensaient ne pas revoir avant longtemps mais sur laquelle leur fils a décidé de venir s’installer avec femme et enfant. George Gunn, son subordonné de l’époque les attend à l’aéroport et les conduit directement au commissariat. Petite faveur d’un ami à un autre. La rencontre parents/fils est terrible. Fionnlagh nie le meurtre mais revendique son amour pour Caitlin. « Ce n’était pas une enfant, hurle-t-il à sa mère. Je sais que les gens diront que douze ans de différence entre nous c’était mal. Mais nous savions que non. Dans vingt ans, personne n’aurait trouvé à y redire ». La colère submerge Fin. L’incompréhension s’installe. Alors qu’ils quittent leur fils et roulent en direction de Ness, le bourg principal de l’île, « tout ce qui leur avait été familier paraissait désormais étranger, comme s’ils n’étaient revenus que pour troubler les jours heureux et gâcher les bons souvenirs. C’était douloureux parce qu’ils en retiraient un sentiment de perte. Perte de l’innocence, du bonheur, de l’appartenance ». Mais de quelle innocence, au fond ? Celle du fils? Celle du père? Parce que lui aussi, Fin, a des choses à se reprocher.
Voilà ce qu’elle provoque cette île, elle l’oblige à remonter le fil du temps. Celui de souvenirs enfouis, celui des fautes. Un nom lui revient en mémoire, Niall Black, le fils de l’homme le plus riche de Lewis, celui qui possède une ferme piscicole avec des cages et des milliers de saumons enfermés. Que l’on fait passer pour des saumons sauvages parce que ceux-là rapportent gros. Les gamins sont à un âge où l’on fait des conneries. Fin n’aime pas ce passé où l’un de ses camarades est mort. Lui le policier intègre, qu’a-t-il fait enfant?
C’est une course contre la montre. Il lui faut essayer de trouver des preuves qui innocentent son fils. Il se heurte au mur de la science qui ne ment jamais. À celui de son propre enfant qui avoue avoir tué celle qu’il a eu la folie d’aimer. La mer possède ses propres mystères. Encore des cages, d’autres saumons, une association d’écologistes. La fougue d’une jeune femme voulant dénoncer les méchants. Le roman de Peter May est empreint de nostalgie douloureuse, d’une volonté sourde et incontrôlable de solder des comptes, comme de faire face à ce que l’on est devenu. Des ombres noires enveloppent Fin Macleod. Se laissera-t-il submergé ? Trouvera-t-il la paix en sauvant son fils et lui-même ?
« Loch noir » de Peter May, traduit de l’anglais (Écosse) par Ariane Bataille, Éditions Rouergue Noir, 366 pages, 22,80 euros.